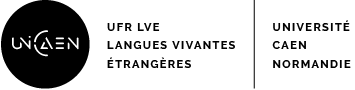Service du travail obligatoire - Des mois entre parenthèses
Né en 1922, Louis Pesnel suit ses études à Bayeux lorsque le conflit éclate. À l’arrivée des Allemands en Normandie, en 1940, le jeune homme rejoint sa famille dans le Cotentin, à Montfarville. Il y exerce alors les deux activités familiales : le travail en mer et celui de la terre. L’auteur nous livre ici un témoignage en deux parties, correspondant aux grandes périodes de son existence durant la Seconde Guerre mondiale. Le premier chapitre est le résultat d’une enquête opérée en 1995 concernant le STO (Service du Travail Obligatoire). Institué par une loi datée du 16 février 1943, le STO vise à répondre aux nouvelles exigences allemandes concernant l’envoi de main-d’œuvre sur le territoire du Reich. Conformément à cette loi, qui impose aux Français (de sexe masculin, nés dans les années 1920, 1921 et 1922) un service de travail de deux ans outre Rhin, Louis Pesnel quitte sa Normandie en mars 1943 pour rejoindre un camp de travailleurs à Wilhelmshaven, importante ville portuaire de Basse-Saxe. Ce questionnaire, reprenant les grandes étapes de la vie du requis en Allemagne, permet de mettre en lumière les conditions du départ, le quotidien des travailleurs en Allemagne, les relations avec les Allemands, jusqu’à son retour en Normandie en décembre 1943, suite à l’obtention d’une permission. En décidant de ne pas regagner l’Allemagne, Louis Pesnel ouvre une nouvelle page de son histoire : l’ancien requis devient alors réfractaire. Cette vie « entre parenthèses » du réfractaire est retracée en 1998. Caché dans un premier temps dans les fermes du Bessin, il rejoint Montfarville et son Cotentin pour y vivre les « semaines fiévreuses » marquées par le Débarquement et l’arrivée des troupes Alliées.
QUESTIONNAIRE STO
I. Situation avant le départ
Situation de la famille :
Père marin-pêcheur, retraité de la Gendarmerie, ancien combattant 14-18 et rappelé en 39-40 sur un dragueur de mines à Dunkerque, libéré avant la Débâcle à cause de l’âge.
Mère exploitant un hectare de culture maraîchère, avec l’aide de ma grand-mère paternelle. Deux sœurs, l’une mon aînée, l’autre ma cadette. Aucune activité syndicale, politique ou religieuse.
Situation personnelle :
Âgé de 20 ans et célibataire.
Situation professionnelle :
Inscrit maritime no 2423 du Quartier de Cherbourg, naviguant avec mon père sur le « Saint Louis » basé à Barfleur (pêche côtière) et travaillant à mi-temps dans les champs avec ma mère.
Lieu de résidence en 1939-1942 :
Chez mes parents, à Montfarville, département de la Manche. Précédemment à Asnelles dans le Calvados.
NB : Jusqu’à la mi-juin 1940, j’étais élève interne du Cours complémentaire « Letot » à Bayeux, où je préparais le concours d’entrée à l’Ecole de Maistrance de Brest, concours auquel je n’ai pu me présenter du fait de l’arrivée des Allemands.
II. Conditions du départ
La Propagande :
En dehors de la radio et de quelques rares affiches sur « la relève »1Avant l’institutionnalisation du STO, Pierre Laval avait inventé le système dit de « la relève ». Celui-ci prévoyait, dès juin 1942 et dans le but d’accroître le nombre de départs volontaires pour l’Allemagne, l’envoi d’ouvriers en contrepartie du retour en France de prisonniers de guerre. L’échec de cette mesure poussera le gouvernement français à en adopter de nouvelles., la propagande était inexistante dans mon coin de Val-de-Saire. Par ailleurs, j’étais trop occupé pour lire le journal.
En revanche, l’un des trois seuls jeunes « collabos » du secteur a tenté de me recruter pour l’entreprise Todt2Entreprise créée par Fritz Todt pour réaliser les grands travaux, notamment en Normandie le Mur de l’Atlantique et la construction des plates-formes de lancement des « armes de représailles » de type V1 (cf. ici même note no 22).. J’ai refusé d’éviter l’Allemagne bombardée pour devenir volontaire à Cherbourg, ce que mes parents auraient peut-être préféré.
Le recensement et la convocation :
En ce qui me concerne, il s’agissait d’une réquisition visant les jeunes marins-pêcheurs du Cotentin : ce fut donc l’Inscription maritime qui servit d’intermédiaire.
1er mars 1943 : Sur avis du syndic de Barfleur, nous nous sommes présentés au bureau de l’Inscription maritime de Cherbourg où nous avons été informés de notre prochain départ pour l’Allemagne.
17 mars 1943 : Réception, par l’intermédiaire de l’Inscription maritime, d’un ordre en date du 15 mars émanant de la Feldkommandantur 722 de Saint-Lô, signé Gebhardt et non contresigné par la Préfecture, m’enjoignant [de] me présenter le 18 mars au bureau de placement allemand de Cherbourg.
NB : De deux choses l’une, ou l’Inscription s’était rendue coupable de collaboration passive ou la Préfecture de la Manche s’était hypocritement défaussée sur elle d’une besogne peu reluisante.
18 mars 1943 : Nous nous présentons en groupe (les pêcheurs de Barfleur) au bureau de placement allemand de Cherbourg, où nous recevons chacun une feuille de route.
19 mars 1943 : À la Perception de Quettehou, chacun perçoit une indemnité d’équipement de mille francs.
NB : Pour bénéficier de cette indemnité – ô combien nécessaire – nous avions dû, la veille, signer un imprimé qui ne modifiait en rien la réquisition dont nous étions victimes : puisque désignés, pour aller travailler en Allemagne, par la Commission franco-allemande « instituée en application de la loi du 16 février 1943 sur le service obligatoire du travail ».
Remarque importante : dans notre secteur, et d’ailleurs dans le reste du Cotentin, aucun marin-pêcheur n’a pris la tangente 3Sur les 1889 réfractaires de la Manche identifiés, seuls 25 appartiennent à la catégorie des marins-pêcheurs. M. BOIVIN, Les Manchois dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale : 1939-1945, Tome 3, L’Occupation : l’ordre allemand, le régime de Vichy et la collaboration, Marigny, Eurocibles, 2004, p. 314.. La raison en est que nous étrennions le système du STO avec, nous semblait-il, l’aval de notre administration. À l’époque, aucune « planque » ne nous fut proposée. Quant aux Résistants, ils se tinrent cois.
La visite médicale :
Elle eut lieu le 11 mars 1943 dans les locaux de la Mairie de Quettehou.
Le souvenir en est imprécis. Nous étions assez peu nombreux. Il n’y avait pas de médecins allemands. Cela ressemblait fort à un conseil de révision, la rigolade en moins.
Le départ :
C’est le lundi 22 mars 1943, de très bonne heure, que nous nous sommes retrouvés à la gare de Cherbourg accompagnés ou non par des proches. Les Allemands contrôlaient la gare et le quai, où seuls les « requis » étaient admis sur présentation de leur feuille de route.
Vu l’heure matinale, pas de manifestation organisée. Cependant, les « requis » dans les wagons, les parents de l’autre côté de la clôture ne cachaient pas leur irritation d’avoir été séparés plus vite que prévu ; des cris de protestation fusaient. L’atmosphère était tendue et triste. La cohésion régnait entre nous, qui attendions des jours difficiles.
III. Le voyage
22 mars : Arrivés à Paris à 10 h 50, nous [nous] sommes dirigés sur la caserne de la Pépinière : hébergement, contrôles divers, distribution de chaussures à semelles de bois.
23 mars : Départ vers midi, en direction d’Aix-la-Chapelle où nous arrivons le soir. Hébergement loin de la gare.
24 mars : Nous rejoignons Hanovre où, dans une halle immense, nous sommes marqués, par destination, au moyen de macarons de diverses couleurs. C’est là que j’ai été séparé de mes camarades de Barfleur et que je me suis trouvé dans un autre lot de marins-pécheurs du Cotentin, ceux-là dirigés sur Wilhelmshaven au lieu de Bremerhaven, d’après le bouche à oreille...
25 mars : De Hanovre, nous gagnons Brème, puis Oldenburg où nous passons la nuit après avoir avalé un bol de boisson chaude à base de chicorée.
26 mars : Arrivée à Wilhelmshaven, terme d’un voyage dont la destination nous était inconnue au départ.
Puis l’installation dans un camp de travailleurs où nous resterons les seuls STO, contrôle et mise en fiche. Nous avons été réceptionnés, pas accueillis.
NB : Les conditions de voyage furent normales en ce qui concerne le matériel roulant ; et nous n’avons pas souffert de froid. Pour l’hygiène, c’était différent : pas assez de points d’eau ; et latrines de masse dans certaines gares. Parfois l’hébergement était sommaire et il nous arriva de dormir à même le parquet d’une cantine.
Mais ce furent les corvées de valises répétées à chaque halte importante – choc en retour de la générosité parentale – qui sapèrent le plus notre moral. Ainsi, comme nous l’avions fait de Paris à la frontière, à chaque arrêt en gare, nous avons encore chanté la Marseillaise en arrivant à Aix-la-Chapelle ; mais, dans cette ville, les douleurs musculaires et l’essoufflement nous rendirent muets en moins d’un kilomètre de portage sans repos.
IV. La vie en Allemagne
Le travail et la vie quotidienne :
À partir du 26 mars 1943, mon domicile provisoire sera : Reichsbahnlager no 1. Peterstraße Wilhelmshaven. Avec un jeune Français d’Etrépagny (Eure), je partage un petit local de 3,20 mètres x 1,80 mètre, non chauffé, et meublé d’une table branlante, de deux tabourets, d’une armoire-vestiaire et de lits superposés en bois, avec paillasses. Les autres marins-pêcheurs sont logés ensemble dans un dortoir de la même baraque : ils sont originaires de Fermanville, Réville, Saint-Marcouf-les-Gougins, Ravenoville, Saint-Germain-des-Vaux...
Notre camp hébergeait uniquement des ouvriers des chemins de fer : environ 120 cheminots hollandais en uniforme de velours côtelé, quelque 10 Belges et Italiens, 8 Français sous contrat et notre groupe de 12 pêcheurs STO vêtus de bourgerons de toile avec pantalons assortis.
Sans clôture côté route, le camp était composé de trois bâtiments provisoires : entre notre baraque, qui constituait une extension[,] et le bâtiment d’administration où logeait le Lagerführer, un baraquement de très grandes dimensions – dans lequel nous fûmes tous transférés le 26 septembre 1943 : il y faisait moins froid, mais c’était infesté de punaises – réunissait les services de bouche et d’hygiène ainsi que quatre ou cinq dortoirs de 40 places en lits superposés. Il y avait aussi un abri enterré – pour les cas d’urgence – qui ne pourrait protéger que des éclats, et un bassin rectangulaire rempli d’eau. Le tout situé à la limite nord-ouest de la ville et à environ vingt minutes de la gare de Wilhelmshaven.
Le voisinage présentait un aspect varié : quartier pavillonnaire à l’est, casernes à l’ouest, champs au nord et, au sud, des terrains vagues avec des ateliers provisoires.
Le Travail pour la Reichsbahn4Compagnie nationale des chemins de fer allemands. commença dès le 27 mars au matin. Pris en main par un chef d’équipe à casquette trois étoiles, ancien combattant costumé et irascible, nous fûmes, en tant que manœuvres, initiés sur le tas au dur métier de cheminot : pose et entretien des voies avec, en prime, des corvées de débardage concernant des rails et des traverses, aussi bien que du mâchefer, des matériaux de construction ou des métaux de récupération. Notre équipe, forte d’une soixantaine d’hommes, devait assurer l’entretien de la ligne sur environ quinze kilomètres y compris la gare.
Le salaire mensuel variait en fonction du temps de travail. Pour les cinq premiers mois, et en marks : 106,54 en avril ; 132,10 en mai ; 128,18 en juin ; 128,37 en juillet ; 120,64 en août5Michel Boivin avance que le salaire mensuel des requis de la Manche est compris entre 100 et 200 marks pour environ dix à douze heures de travail par jour. M. BOIVIN, op. cit., p. 243.. Ce n’était pas suffisant pour envoyer de l’argent en France.
Un repas avec soupe était servi au camp tous les soirs ; le dimanche, le repas était servi, au choix, le midi ou le soir. Quand nous travaillions à proximité de la gare, la cantine des employés allemands nous était accessible le midi, autrement nous préparions une gamelle à réchauffer ou un repas froid. Nous étions bien nourris.
Si, contrairement à beaucoup d’ouvriers du STO, nous n’avons jamais souffert de faim, c’est que, à l’instar des cheminots hollandais dont nous étions en quelque sorte les supplétifs, nous recevions les mêmes tickets d’alimentation que les Allemands travailleurs de force, jusque et y compris les suppléments pour fête légale ou pour bombardement. Ce fut là notre grande chance.
NB : Mes camarades de Barfleur qui, eux, travaillaient à Wesermünde (Bremerhaven) dans une conserverie de poisson, souffrirent de sous-alimentation : l’un d’entre eux en mourut à son retour en France, en 1945.
Les soins médicaux laissaient parfois à désirer. Victime d’une forte angine qui m’obligea à cesser le travail du 22 au 29 avril 1943, je dus le dimanche 24 – encore très fiévreux – me rendre chez le médecin pour ne pas avoir affaire à la police : il se débarrassa de moi avec un collutoire et il me fallut insister beaucoup pour obtenir un arrêt de travail. Dans le même temps, mon compagnon de baraque – en rupture de vaccination – était hospitalisé pour diphtérie : il fut bien soigné. Durant mon séjour, il n’y eut pas de visite médicale de contrôle ; mais nous étions rarement malades6Michel Boivin a retrouvé 91 actes de décès de requis dans les registres d’état civil des communes de la Manche. L’historien note que « 42,5 % des décès sont dus à la maladie (tuberculose, appendicite, diphtérie, méningite) » (op. cit., p. 243). Mal soignées, ces maladies parfois bénignes deviennent en effet fatales. En outre, les bombardements causèrent 26,2 % des morts originaires de la Manche en Allemagne..
C’est la caisse maladie de la Reichsbahn à Oldenburg qui assurait la couverture sociale. À la suite de mon angine, je reçus très rapidement quinze marks en dédommagement de la perte de salaire, pour cinq jours d’absence effective.
Les alertes étaient fréquentes de jour comme de nuit. Quand elles survenaient pendant les heures de travail, l’ordre d’arrêt était donné par le chef d’équipe, même pour une simple préalerte. En cas d’alerte majeure, le chantier ayant déjà été mis en ordre par sécurité, nous nous dirigions vers l’abri le plus proche ; il en était du moins ainsi dans le secteur de la gare qui était le plus exposé. Avec les Hollandais et d’autres, nous avions accès aux grands abris après les Allemands et les Italiens.
NB : Connue pour son port militaire, la ville de Wilhelmshaven disposait d’abris excellents, contrairement à d’autres plus peuplées, telles Hambourg, Hanovre ou Aix-la-Chapelle.
Pour rencontrer « les femmes STO », il eût fallu qu’elles existassent. À l’époque du moins, cette sous-catégorie ouvrière n’était pas représentée à Wilhelmshaven. Sans doute, en cherchant bien, eût-on pu trouver ici ou là une Française recrutée sous contrat volontaire : ça ne nous intéressait pas. Nous étions d’ailleurs suffisamment fatigués pour ne pas gaspiller notre temps libre à « courir la gueuse », alors qu’il nous fallait, en plus de soins d’hygiène, assurer le lavage et le raccommodage des vêtements, le courrier à la famille7L’envoi de courrier n’étant pas limité jusqu’au début de l’année 1944, les requis envoient de façon régulière des plis en France. et la préparation des casse-croûte.
Pas de propagande visant les requis du STO ou les autres Français du camp de la Reichsbahn. Cela provenait peut-être de la personnalité du Chef qui se montrait envers nous d’une grande tolérance. Au cours de l’été 1943, il nous arriva d’assister à des séances de variétés organisées dans d’autres camps de travailleurs : il n’y eut pas plus de discours que de distribution de tracts ou de brochures.
Début octobre 1943 cependant, la salle de cantine fut tendue de drapeaux nazis, côté estrade, pour une « séance d'information » en vue d’un éventuel recrutement immédiat dans la Waffen-SS. Il y eut plusieurs allocutions, de la bière servie sur les tables, et un débat, sans le moindre résultat ! De toute évidence, c’étaient les Hollandais qui étaient visés puisqu’il n’y avait pas traduction en français.
Il n’était pratiquement jamais question de politique au camp. La confiance était réciproque entre les cheminots hollandais et les pêcheurs STO : elle était mitigée entre nous et les Français sous contrat volontaire ; elle était nulle avec les Belges qui nous paraissaient trop proches des Allemands.
NB : Sur le lieu de travail, les Hollandais n’hésitaient pas à intervenir en notre faveur quand ils nous voyaient en difficulté ; au contraire des Belges flamingants qui mouchardaient à l’occasion.
Les Allemands :
D’après mon expérience, il n’y avait pas de véritable répression propre aux Français du STO. Ce qui n’exclut pas la sévérité excessive de certains individus : dont notre premier et durable chef d’équipe Trumpf qui ne supportait aucun arrêt, et qui en vint à nous interdire, non seulement de parler, mais aussi de chanter et de siffler en travaillant. Devenu sa bête noire, je dus supporter, pendant des semaines, insultes et gesticulations ; tandis que mes camarades se transformaient en esclaves. Je finis en quarantaine. Isolé pendant un mois à quelque cinquante mètres de l’équipe.
Les Allemands ne faisaient aucune différence entre les ouvriers français en fonction de leur statut. Les Français sous contrat ne jouissaient pas à ce titre d’un quelconque privilège. L’un d’entre eux, membre de l’équipe Trumpf, s’étant aventuré dans la zone portuaire interdite, fut surpris essayant d’entrer en contact avec un groupe de « bagnards » dont l’un l’avait interpellé en français. Arrêté aussitôt, il fut conduit à la prison toute proche, interrogé et frappé ; puis il fut jeté dans une cellule où il vécut une nuit de cauchemar ; un détenu mourut près de lui, et le couloir retentissait parfois de piétinements et de cris.
Après quatre semaines de travail forcé en bord de mer, ce « volontaire » nous revint en boitillant, blessé au talon droit par un éclat d’obus de D.C.A. : n’ayant pas eu accès aux abris, il n’avait pu que s’allonger à plat ventre sur le sable. Inutile d’insister sur son amertume...
Il n’y avait rien de surprenant à ce que soit contrée toute infraction à la règle, mais l’ignorance était souvent au départ de la faute. Ainsi, ayant omis de solliciter un laissez-passer pour rendre visite à mes camarades de Barfleur cantonnés à Wesermünde (Bremerhaven), je fus refoulé à Blexen, sur la rive gauche de la Weser. Sur le trajet de retour, je fus arrêté à Rodenkirchen, fouillé et interrogé, puis reconduit en compartiment spécial à Wilhelmshaven, escorté par un très soupçonneux gendarme des chemins de fer. Après contrôle près du camp par la police de la gare, je fus promptement relâché.
NB : Cet incident, survenu le 13 juin 1943, me rendit plus circonspect. Muni cette fois d’une autorisation en bonne et due forme, je retrouvai mes Barfleurais pour vingt-quatre heures les 8 et 9 août 1943.
C’est le 3 décembre 1943 que nous comprîmes vraiment à quel point notre situation était enviable, comparée à celle d’autres catégories de travailleurs étrangers.
Depuis sept semaines, nous avions perdu sans regret notre vieux nazi de chef d’équipe et nous étions employés plus à l’ouest, dans le secteur de Sande, sous les ordres d’un civil quadragénaire qui nous laissait davantage le temps de respirer.
On se proposait ce jour-là de remplacer, entre le passage de deux trains, tout un embranchement avec ses aiguillages, ce qui excédait les forces de notre équipe habituelle. Aussi nous avait-on adjoint – pour la translation du très lourd ensemble préfabriqué – un groupe de plus de soixante ouvriers des territoires de l’Est marqués Ost. encadrés par quelques Allemands.
Dès le début de l’opération, la brutalité des ordres, les menaces de coups de manche de pioche, la crainte exprimée par les visages de nos compagnons d’un jour, nous impressionnèrent tant que nous réagîmes d’instinct par une attitude hostile à l’endroit des gardes qui alors se calmèrent quelque peu. Pour nous, Hollandais et Français, il était clair que ces ouvriers de l’Est étaient maltraités jour après jour, et qu’ils acceptaient leur sort comme une fatalité.
Quand le groupe de renfort fut reparti et que nous eûmes parachevé l’ouvrage, nous fîmes part de notre indignation à notre nouveau chef d’équipe qui, lui-même, nous paraissait ébranlé. Il nous fit comprendre qu’il ne pouvait pas intervenir et qu’il en était désolé...
Les contacts extérieurs :
Les habitants de Wilhelmshaven nous ont paru nourrir une sourde hostilité envers les étrangers, hostilité suscitée ou entretenue par des affiches du genre « silence ! les oreilles ennemies vous écoutent ! ». C’était peut-être simplement de l’indifférence.
Incidemment cependant, un signe favorable parvenait jusqu’à nous. Tel ce geste d’une Allemande qui, sans se faire connaître, me fit remettre un pain – ainsi qu’à deux de mes camarades – le 17 juillet 1943. Ou, tout aussi insolite, sur un quai de gare, la rencontre d’un civil allemand qui, après avoir expliqué son passé de répétiteur d’allemand à l’Université de Bordeaux dans les années vingt, tenait à dire qu’il aimait la France et les Français. Apprenant qu’il travaillait à la direction des Douanes, je lui avais parlé du saccage de nos colis familiaux par ses contrôleurs ; et il m’avait promis son aide en cas de récidive. Je fis une seule fois appel à lui, après quoi les « saccageurs » ne firent plus de zèle.
Les signes d’hostilité caractérisée étaient également peu nombreux : cailloux lancés d’une passerelle sur notre équipe par une bande de gamins ; ou colère d’un ancien combattant de « 14-18 » voulant nous en faire voir parce qu’on avait été dur pour lui en France durant sa captivité. Ou encore cette commerçante qui, obligée d’honorer mes tickets d’alimentation, m’avait proposé des fruits pourris au grand amusement de ses clients…
D’une manière générale, nous n’intéressions pas les Allemands, et nous cherchions d’autant moins le contact qu’il y avait entre nous la barrière de la langue. C’est ainsi qu’aucun membre de notre groupe de STO n’eut jamais l’occasion d’entrer dans un logement.
Les bombardements devaient bien avoir quelque influence sur le moral de la population mais, pour celle-ci, il s’agissait moins – en 1943 – d’une intensification que de la poursuite des attaques aériennes : son attitude à notre égard n’avait pas de raison d’évoluer.
Le premier raid avait été subi dès le 3 septembre 1939 – jour même de la déclaration de guerre – et avait été suivi de nombreux autres, au fil des années, compte tenu de l’importance de Wilhelmshaven dans le dispositif allemand de guerre sous-marine8Chantier naval et port d’attache des U-Boote (sous-marins), Wilhelmshaven est l’un des points névralgiques de la marine du Reich.. À l’issue du conflit, plus de cent mille bombes, dont près de 90 000 engins incendiaires, étaient tombées du ciel : 17 % sur les installations portuaires, 83 % sur la ville.
Quand nous arrivâmes, fin mars, les ruines étaient déjà fort nombreuses. Les dégâts ne firent qu’augmenter avec l’attaque nocturne du 26 juillet 1943 qui frappa plus directement le port militaire et, surtout, le bombardement au phosphore du 3 novembre 1943, réalisé en plein après-midi, qui porta l’incendie et la destruction dans la majeure partie de la ville. Ces deux raids importants étaient à mettre à l’actif de formations américaines. D’autres attaques avaient eu lieu : le 21 mai de jour, le 11 juin de nuit.
Après notre départ en décembre, les raids aériens devaient reprendre de plus belle, R.A.F. et US-Air Force se partageant la tâche. Le dernier gros bombardement fut mené le 30 mars 1945 par l’aviation américaine, soit cinq mois après le « coup de grâce » asséné par les Britanniques le 15 octobre 1944 (cf. Rolf Uphoff, « Wilhelmshaven im Bombenkrieg », 1992, Holzberg Vertag, Oldenburg). D’après l’auteur cité, la population, rassurée par la solidité des abris, ne céda pas à la panique et n’eut à déplorer, si j’ose dire, que moins de 500 morts.
Il nous arrivait parfois d’approcher des « Russes » sur les voies de garage ou dans la partie « marchandises » de la gare de Wilhelmshaven.
Côté voies de garage : des femmes employées au nettoyage des rames de l’express Wilhelmshaven-Wiesbaden ou d’autres trains de voyageurs. Ces femmes, plutôt jeunes et souriantes, étaient surveillées de près par des cheftaines allemandes en costume de la Reichsbahn. Comme les toilettes de la gare leur étaient strictement interdites – par mesure d’hygiène ! – ces ouvrières n’avaient plus d’autre recours que d’utiliser celles d’un wagon...
Côté marchandises : des prisonniers de guerre employés à charger ou décharger des wagons. Ces hommes, apparemment bien nourris, et débrouillards, avaient un moral élevé. À leur demande mimée, il n’était pas rare que nous entamions tel tas de traverses ou tel tas de sable plutôt que tel autre, pour leur laisser le temps de déplacer discrètement leurs réserves de « patates ».
En 1943, les prisonniers français – dont nous croisions de loin [en] loin de petites colonnes – nous faisaient bonne impression ; même si la liberté leur manquait, ils avaient fière allure. Dans certains cas ils se considéraient eux-mêmes comme des privilégiés.
Pour mémoire, je note la situation pénible et ridicule des prisonniers italiens après l’éviction de Mussolini. En septembre 1943, étant sur le quai de la gare de Mariensiel que jouxtait un petit camp, j’ai vu des soldats allemands soumettre leurs prisonniers italiens à l’exercice de « la pelote »9Exercices physiques, souvent disciplinaires ou vexatoires. dans une cour boueuse, et ce, sous le regard d’autres soldats italiens attendant le train du bon côté des barbelés : eux toujours alliés des Allemands comme faiseurs de brouillard.
Entre tous les prisonniers de guerre, les plus malheureux étaient sans nul doute les Yougoslaves : ils passaient vêtus de bleu horizon, le visage émacié et les yeux creux, sans un regard, indifférents à ce qui se passait autour d’eux. Leur condition ne devait guère différer de celle des Déportés...
Et justement, des hommes en pyjama rayé, nous en avons aperçu au grand jour – mais de loin – dès le 27 mars 1943, lendemain de notre arrivée, et les jours suivants, période de déblaiement des ruines provoquées par le grand bombardement du 22 mars 1943. À nos questions, il nous avait été répondu qu’il s’agissait de « bagnards », criminels de droit commun. Ce n’est qu’en 1945 que j’ai pu faire le rapprochement avec les victimes des camps nazis...
NB : En novembre 1993, je suis retourné à Wilhelmshaven où j’ai acheté un livre édité en 1992 et traitant des bombardements subis par la ville. En encart était jointe une vue aérienne mosaïque[,] composée à partir de clichés pris d’une altitude de 6000 mètres, par l’aviation de reconnaissance américaine, le 6 novembre 1944.
Et c’est seulement maintenant, en réexaminant cette vue aérienne, que je trouve la preuve de l’existence à Wilhelmshaven d’un « KZ10 Konzentrationslager : camp de concentration. » qui, à vol d’oiseau, n’était pas à plus d’un kilomètre du Reichsbahnlager.
Implanté évidemment en zone interdite, le camp de concentration comptait suffisamment de baraquements pour recevoir environ trois mille personnes dans un espace très réduit. On n’en finit pas de découvrir l’horreur que l’on a côtoyée, et ignorée en toute bonne foi...
NB : Il s’agissait en fait de l’un des principaux « Kommandos » extérieurs du Camp de Neuengamme.
Pour en revenir au camp de travailleurs des chemins de fer, nous n’y disposions d’aucun équipement pour activités sportives. Pas de radio et pas davantage de phonographe ou d’orchestre... Quant au cinéma, nous aurions pu tenter notre chance en ville le dimanche mais, outre que nous n’avions nulle envie d’être rabroués par les Allemands, les films n’étaient pas sous-titrés en français ; il n’y avait pas non plus de bibliothèque. En plus de huit mois de présence, je ne détins que deux livres – et seulement pendant une semaine, une grammaire anglaise et le vocabulaire de même niveau, prêtés par un jeune stagiaire allemand en échange d’une leçon de français.
Dans la baraque, en cas de temps libre le dimanche, nous avions recours aux divers jeux de cartes ou [à] un jeu de dames. Un « Russe blanc » naturalisé français m’apprit à jouer aux échecs. À l’extérieur, au cours des pauses et par temps sec, un Hollandais féru d’arts martiaux nous initiait aux techniques du judo et de l’aïkido, ce qui, à tout prendre, était moins brutal et plus efficace que l’habituelle lutte libre en faveur chez les matelots.
Je me suis efforcé d’apprendre l’allemand au moyen d’un petit dictionnaire de poche « Langenscheidt » dont le modèle est toujours réédité. Ayant mémorisé des centaines de mots, je butais malheureusement sur la syntaxe et la pratique me manquait, faute de partenaires. Ceci étant, je parvenais dès juillet 1943 à me faire comprendre « en petit-nègre », assez bien néanmoins pour devenir le porte-parole de mes camarades pêcheurs. C’était important dans la mesure où nous parvenions ainsi à nous dégager partiellement de la tutelle peu sincère de notre interprète belge...
La correspondance était libre, la censure s’appliquant au hasard comme partout à l’époque. Si tous [les envois] ne parvenaient pas à destination du fait des bombardements sur la Ruhr, nous recevions des colis au gré des possibilités familiales. En 1943, le trafic postal n’était pas encore très gravement perturbé.
Au sous-titre « Les Allemands », j’ai abordé – quant à la répression – la question des étrangers. Je puis rappeler ici ce que j’ai laissé entendre au chapitre IV (sous-titre « Le travail et la vie quotidienne ») : les rapports étaient cordiaux avec les Hollandais, assez bons avec les deux Italiens et médiocres avec les Belges.
J’y ajoute une anecdote concernant des militaires italiens cantonnés dans une caserne du voisinage et dont la tâche consistait, en cas d’alerte confirmée, à dispenser du brouillard artificiel sur l’agglomération. Le soir du 8 septembre 194311Date de l’annonce de l’armistice signé entre l’Italie et les Anglo-Américains., des soldats italiens passablement éméchés vinrent bruyamment, bouteille de « Chianti » à la main, nous offrir de trinquer à la fin de « leur » guerre, initiative d’autant plus intempestive qu’ils ne nous adressaient jamais la parole. Le lendemain, ils ne nous connaissaient plus, penauds, après avoir été repris en main par les Allemands. Le rapprochement franco-italien n’avait duré qu’une soirée...
Les occupants du Reichsbahnlager étaient tous logés à la même enseigne, tant pour les paillasses à punaises que pour l’alimentation. C’était aussi le cas pour les permissions dont le régime était plus libéral qu’ailleurs : droit au congé tous les trois mois dans le pays d’origine pour les ouvriers mariés, tous les six mois pour les ouvriers célibataires. Telle était la règle au printemps 1943 ; mais c’était trop beau pour durer.
La résistance :
Il n’y avait pas de résistance organisée dans notre camp de travailleurs. Et je n’ai jamais été contacté par qui que ce soit de l’extérieur pour participer à une quelconque activité antinazie.
Les Hollandais m’ont toujours paru hostiles aux Allemands tout en respectant, en professionnels, les consignes de travail. Leur esprit de résistance se manifesta lors de la séance de propagande pour la Waffen-SS ; toutes les questions qu’ils posèrent aux recruteurs furent autant d’habiles objections destinées à susciter une fin de non-recevoir.
Dans notre groupe de STO, personne n’était heureux d’être en Allemagne, mais nous ne pouvions guère aller au-delà d’une résistance passive.
N’essayant même pas d’apprendre l’allemand, tant était fort l’espoir d’un prochain retour, mes camarades avaient pour souci majeur de ne pas se faire remarquer par notre « hurleur en chef », d’où un certain sommeil de leur esprit frondeur. De mon côté, en tirant sur la corde de l’incompétence sans atteindre le point de rupture, j’avais obtenu l’avantage non négligeable d’être désigné en priorité chaque fois qu’un artisan attaché à la gare avait besoin d’un ou plusieurs manœuvres. Chacun se défendait à sa manière.
Encadrés et surveillés comme nous l’étions, interdits de zone portuaire et affectés à l’entretien des voies, il ne pouvait d’ailleurs pas être question pour nous de résistance active. Le travail de l’équipe étant sans cesse contrôlé, qu’aurions-nous pu saboter ?
Dérisoires étaient les menus méfaits dont, par exemple, je me rendais moi-même coupable [à] moindre risque : tuiles cassées par feinte maladresse lors de manutentions, ou bien, lorsque la voie traversait le bas pays et que j’étais en quarantaine à l’écart de l’équipe, éclisses jetées au canal de drainage, avec les boulons, des coussinets et des tire-fond. C’était une sorte de protestation silencieuse, sans portée réelle puisque le pire était prévu : des rails en réserve le long du ballast ainsi que, près de chaque petit pont métallique, le matériel nécessaire à sa reconstruction rapide.
L’unique fois où, accompagné d’un camarade, j’entrai dans un débit de boissons, c’était pour tenir le pari stupide, que j’avais lancé, de dire « crève Hitler ! » en guise de salut. Heureusement, la confusion auditive fonctionna bien. L’ânerie ne fut pas rééditée.
Et si, le mercredi 14 juillet 1943, je fus le seul Français du Reichsbahnlager à ne pas se rendre au travail pour cause de fête nationale, je dois reconnaître que le chef de camp ne me dénonça pas à la police comme il était pourtant tenu de le faire. C’est à peine si je fus réprimandé : ce qui donna à réfléchir à mes camarades pêcheurs. En vérité, nous étions des garçons ordinaires, isolés et inorganisés.
V. Le retour
Dès notre arrivée en pays frison, notre grand objectif fut d’effectuer le voyage en sens inverse, réaction commune à tous les expatriés involontaires.
Convenablement nourris, et relativement rassurés quant à notre sécurité, nous [nous] focalisions sur le retour en France. Sans trop de nervosité au début, car l’on nous avait laissé espérer un départ au bout de six mois de présence pour les célibataires, trois mois seulement pour les chargés de famille. Il nous suffisait de songer à la longue captivité déjà endurée par les prisonniers de guerre pour prendre notre mal en patience.
À partir de juin pourtant, l’atmosphère s’était quelque peu dégradée. Le 30 mai, nous avions appris que les démarches entreprises par la Marine marchande (ministère de tutelle de l’Inscription maritime) auprès des Autorités allemandes s’étaient avérées vaines : la réponse étant qu’il n’y avait « plus d’exemption pour notre catégorie ». Ce qui signifiait aussi – a contrario – qu’il y avait bel et bien eu possibilité d’exemption au moment du départ, opportunité que le Quartier maritime de Cherbourg n’avait pas su saisir ou avait tout simplement ignorée, et maintenant il était trop tard !
Signe avant-coureur d’un malaise plus grave, la permission des pêcheurs mariés fut reportée du 24 juin au 15 juillet, dans le cadre d’un avertissement général motivé par l’accroissement du nombre des ouvriers qui « oubliaient » de rentrer en Allemagne à l’issue de leur congé en France. En l’occurrence, nous avions été unanimes pour demander à nos amis en partance de ne tenir aucun compte du chantage exercé par les Allemands, lequel consistait à lier les futurs départs au retour des permissionnaires12Dès septembre 1943, les autorités allemandes réduisent le nombre des permissions. La raison de cette baisse est le non retour en Allemagne d’une partie des bénéficiaires de ces permissions. L’étude sur les requis de la Manche montre que, des 758 requis rentrés en permission, 67,7 % ne sont pas retournés en Allemagne.. Cette pression psychologique n’étant pas suffisante, elle allait faire place début septembre, soit moins de deux semaines avant le départ escompté, à un avis de suppression pure et simple des congés. La mesure était d’autant plus inquiétante qu’elle visait les Français en particulier.
Placé devant la nécessité d’agir, c’est vers la mi-octobre que je pris l’initiative de faire le siège du service du personnel de la gare de Wilhelmshaven sans passer par l’intermédiaire de l’interprète belge et sans en informer notre chef de camp.
J’eus la chance de tomber sur un chef de bureau plutôt conciliant dont j’obtins un premier rendez-vous, avec autorisation de quitter le travail en temps utile, ce qui impressionna beaucoup notre chef d’équipe. Et je pus alors, dans un allemand rudimentaire, exposer notre cas : « Pêcheurs du secteur de Cherbourg – région au climat tempéré – nous avons été conduits ici sous la contrainte. L’hiver approche et nous ne disposons pas d’autres vêtements de travail que nos bourgerons de toile, nous deviendrons donc improductifs dès les premiers froids. Nous demandons à recevoir un habillement comparable à celui des cheminots hollandais. »
Après avoir écouté patiemment, mon interlocuteur me fixa une autre entrevue, puis une autre, puis une autre encore, en présence chaque fois de personnages différents et mieux placés dans la hiérarchie. C’est au cours de ces rencontres – à l’ambiance parfois tendue – qu’une solution se fit jour, non sans avoir été discrètement favorisée par la fille du chef de bureau, qui était aussi sa secrétaire. Faute d’approvisionnements disponibles, les « responsables » décidèrent, à titre exceptionnel, de nous laisser partir en France pour en rapporter des vêtements chauds. Nous étions début novembre et j’avais obtenu en quelques semaines, de façon inespérée, la promesse d’un départ avant la mi-décembre ! Les heures et les heures passées à grappiller des mots dans le dictionnaire « Langenscheidt » n’avaient pas été perdues.
À ce stade, l’interprète belge reprit l’affaire en main au nom du chef de camp et s’occupa des formalités : tirage au sort pour la désignation des partants, préparation des listes renseignées, etc. Il parvint même à marchander trois permissions supplémentaires au tarif de cinq cents grammes de chocolat par congé : transaction dont lui aussi tirait bénéfice.
Grâce à quoi, le 11 décembre 1943, nous étions huit « pêcheurs-cheminots » à partir pour la France, en laissant seulement deux des nôtres à Wilhelmshaven.
NB : Les deux répondants furent renvoyés au pays un mois plus tard, en janvier 1944, dans l’un des derniers trains de permissionnaires : personne n’étant rentré, ils étaient devenus des témoins gênants. Eux-mêmes allaient bientôt disparaître dans la nature.
Fin janvier 1944, il n’y avait donc plus un seul marin-pêcheur STO au Reichsbahnlager dont les autres ouvriers – je pense surtout aux camarades hollandais – devaient n’être libérés que le 6 mai 1945 à l’arrivée d’une division blindée polonaise, placée sous haut commandement britannique.
Partis le 11 décembre au matin, nous parvenions à rallier Paris le 12 décembre 1943 dans la soirée, après un voyage coupé de fréquents arrêts, parmi lesquels :
– Oldenburg, où nous quittâmes l’omnibus régulier ; et où nous reçûmes un viatique de 160 RM13 R eichs m ark. avant de monter dans un train spécial formé à l’initiative de la Direction « Weser-Ems » de l’Arbeitsfront14En Allemagne, en mai 1933, les syndicats sont interdits et remplacés par le Front allemand du travail (Deutsche Arbeitsfront, DAF)..
– Quelque part dans la Ruhr (entre Bottrop et Oberhausen ?) où, pour cause d’alerte majeure, nous fûmes bloqués au beau milieu d’une gare de triage environnée d’installations industrielles. En cas de bombardement, nous aurions été aux premières loges.
– Venlo, à la frontière hollandaise, pour un contrôle sévère. Tous les ouvriers étant descendus sur le quai avec leurs bagages, ceux qui reconnaissaient détenir des documents écrits ou imprimés – en infraction aux instructions reçues – devaient se regrouper avant d’être renvoyés dans leur camp d’origine. Après un dernier avertissement, menaçant cette fois les contrevenants du camp de représailles, les permissionnaires passèrent dans un sas, à la sortie duquel les policiers choisissaient ceux qui seraient soumis à la fouille. Pendant ce temps, des militaires accompagnés de chiens inspectaient le train d’un bout à l’autre de la rame : aussi bien le toit et les bogies que les compartiments ; rien ne pouvait leur échapper, ni personne.
– Châlons-sur-Marne enfin, où, après une dernière vérification des papiers, on nous remit 3200 francs en contrepartie des 160 RM. L’on nous remit aussi des tickets d’alimentation pour une période de quinze jours.
Et, le 13 décembre 1943 au crépuscule, je retrouvais ma famille à Montfarville. J’étais en bonne santé.
Au cours des journées qui suivirent, je pus apprécier le changement survenu en neuf mois dans l’état d’esprit et l’attitude même de la population. Maintenant que toutes les catégories socioprofessionnelles pouvaient subir la réquisition du STO, une réelle volonté d’apporter de l’aide avait remplacé la gêne inquiète du mois de mars. C’était d’ailleurs plus sensible dans mon village qu’à Barfleur, petit port de pêche qui avait davantage souffert du départ des « requis » à l’orée du printemps.
NB : Mes camarades marins-pêcheurs de Barfleur, dont j’avais été séparé par le sort le 25 mars 1943 à Hanovre, ne rentrèrent en France qu’après avoir été libérés par les Alliés en 1945.
Dix jours après mon retour, la veille de Noël, je quittais Montfarville – une fausse carte d’identité en poche – pour rejoindre Le Tronquay, dans le Calvados. Permissionnaire défaillant, selon l’expression consacrée, je devins « réfractaire » à compter du 28 décembre 1943 (titulaire de la carte no 36-14 du 20 février 1958).
Par décision no 5 prise le 5 juillet 1957 par l’office départemental des A.C.V.G.15 Anciens Combattants et Victimes de Guerre. du Calvados, j’ai été reconnu « personne contrainte au travail en pays ennemi » pour la période du 22 mars au 27 décembre 1943.
NB : Mon ancien Livret professionnel maritime, lequel était tenu et mis à jour par l’Inscription, précise, à la date du 22 mars 1943 et dans la colonne « Apostilles diverses » : « débarqué d’office étant requis pour aller en Allemagne ».
Additif au QUESTIONNAIRE STO
La réserve des Allemands :
Je reviens d’abord sur l’attitude des Allemands à notre égard : pas franchement hostile, plutôt distante et soupçonneuse dans la majorité des cas. Nous nous trouvions, il est vrai, dans une ville dépendant presque exclusivement de l’activité militaire, avec de surcroît une forte emprise de la NSDAP16 N ational s ozialistische D eutsche A rbeiter p artei : parti national socialiste des travailleurs allemands dirigé par Hitler. sur la population au travers de la défense passive. Chacun était ou se croyait surveillé.
Et, lorsqu’on nous venait en aide, c’était avec une grande discrétion : ce fut vrai pour la généreuse inconnue, comme pour cette boulangère silencieuse qui me donna un pain gratuitement et sans tickets alors que j’étais seul dans sa boutique, à l’heure de la fermeture.
À la cantine de la gare, où nous étions acceptés le midi, nous étions aussi bien traités que les clients allemands employés des chemins de fer, et ce malgré nos vêtements de travail délavés.
Une fois pourtant, un vieil homme, assis dans la resserre d’une ferme de la Reichsbahn en cours de reconstruction, sortit de sa réserve. Après avoir vérifié qu’il n’y avait près de lui que des Français, il esquissa le salut nazi puis il dit « Hitler ! » d’un air dégoûté et cracha par terre. J’avais d’abord cru à une simple réaction contre la guerre. Je pense, à présent, que son geste exprimait son écœurement devant l’inhumanité de l’entreprise hitlérienne. La ferme, en effet, était toute proche du « KZ » dont elle n’était séparée que par un bosquet, et lui, contrairement à nous, ne pouvait pas l’ignorer...
Un hargneux chef d’équipe :
II se nommait Trumpf et il avait participé à la Première Guerre mondiale. J’en ai déjà parlé, mais deux anecdotes préciseront son profil psychologique.
Un jour que nous travaillions côté gare de marchandises, une colonne de prisonniers français vint à passer à proximité et l’un d’entre nous reconnut parmi eux l’un de ses cousins du Cotentin, et le héla. Immédiatement, le soldat allemand de tête fit stopper la colonne afin de permettre la rencontre. C’était sans tenir compte de Trumpf qui s’interposa menaçant entre l’ouvrier et le prisonnier, tout en admonestant le soldat d’escorte qui remit aussitôt sa troupe en marche.
Un autre jour, furieux de voir le chantier de nouveau perturbé par une alerte, il refusa ostensiblement de se rendre à l’abri comme tout un chacun et s’installa sur un muret avec sa serviette à casse-croûte, dénonçant ainsi ce qui était à ses yeux un excès de précautions.
Un chef de camp bienveillant :
A contrario, je tiens à insister sur la nature conciliante de notre Lagerführer, dont j’ai pourtant oublié le nom. C’était un quadragénaire tranquille qui, à l’occasion, savait ne pas sévir et qui parfois même nous tirait d’embarras. Quelques exemples suffiront à le distinguer : le règlement interdisait expressément toute inscription sur les cloisons des baraquements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et une amende de 5 RM était prévue pour la moindre infraction. Ce qui ne nous empêch[a] pas, mon camarade Pinchedez et moi, de décorer notre « carrée » au moyen de crayons de couleur, nous exposant ainsi à une lourde sanction pécuniaire. La faute ne devint publique que le dimanche 1er août 1943 quand, devant quelques badauds allemands, je terminai l’ouvrage en dessinant, sur le panneau extérieur de la porte, un liseron géant peuplé de papillons, non sans avoir au préalable inscrit « ASILE » au-dessus du chambranle.
Contre toute attente, il n’y eut pas de sanction. Le chef de camp vint examiner la décoration délictueuse et nous ordonna de ne plus y toucher. Après quoi il lui arriva à plusieurs reprises d’entrer chez nous sans frapper pour faire apprécier à des amis l’originalité des occupants de l’ASILE...
Une autre fois, au cours d’un jeu un peu dangereux entre pêcheurs STO autour de l’abri d’urgence, le conduit d’aération en poterie fut malencontreusement cassé net à mi-hauteur par l’impact d’une demi-brique. L’une des cuisinières fut témoin de la scène et ne pouvait faire autrement que d’en informer son patron. Or le conduit d’aération fut remplacé sans que nous soyons mis en cause.
Un matin où je n’étais pas parti au travail faute de semelles à mes chaussures, le Lagerführer poussa même la générosité jusqu’à me donner une paire de ses souliers de ville pour m’éviter de plus graves ennuis : moins de quinze jours plus tard, les chaussures de secours avaient rendu l’âme sur le ballast.
Et, le jour où il me remit la permission tant attendue, il me fit comprendre qu’il n’était pas dupe de ma promesse de retour en me lançant un très dubitatif « Junge, Junge ! » (Eh bien, mon vieux !), qui signifiait en l’occurrence : « Je n’en crois rien ».
Les prisonniers « de sortie
Mon camarade Pinchedez, qui avait l’habitude de sortir en ville, revint un soir accompagné de deux Français vêtus de vestes civiles et de pantalons d’uniforme. Prisonniers et membres d’un commando de vitriers stationné dans les parages, ils « sortaient » plusieurs fois par semaine avec l’accord des sentinelles, fréquentaient les bars et rentraient au « LAG » en temps utile. Ce statut privilégié s’expliquait par la mise en place dans leur mini-camp d’une sorte de coopérative : les prisonniers fabriquaient des coffrets de marqueterie, la matière d’œuvre étant fournie par leurs gardiens, les bénéfices faisant l’objet d’une répartition équitable. La vente se faisait sous le manteau (de prisonnier), les vitriers ayant, par la force des choses, de nombreux contacts avec la population.
À la recherche du « STO » moyen :
Chercher à définir l’ouvrier STO moyen serait aussi illusoire que de vouloir représenter la France en une seule carte postale. Les uns, dont je suis, ont eu de la chance, les autres non, et la statistique ne saurait rétablir l’équilibre.
Les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête devraient, s’ils étaient suffisamment nombreux, refléter des situations très variées, vécues en fonction de parcours aléatoires. S’ils étaient regroupés, puis analysés en vue d’une synthèse, on aboutirait inévitablement à une nouvelle trahison de la vérité.
Second additif à ma réponse au « QUESTIONNAIRE STO »
Le travail :
« Aushilfsarbeiter » – littéralement « travailleur auxiliaire » –, je faisais partie, avec mes camarades marins-pêcheurs, d’une main-d’œuvre d’appoint dépourvue de qualification.
Spécialisés peu à peu dans la pose et l’entretien des voies, il nous suffisait de connaître le maniement de quelques rares outils : la fourche pour nourrir et dégager le ballast, la pioche pour bourrer les traverses métalliques ou de bois, le grand té pour serrer ou desserrer les tire-fond, la pince à deux hommes pour apporter ou enlever les rails, le cric pour soulever l’ensemble rails-traverses, le bélier pour aligner la voie... La discipline d’équipe était nécessaire à notre propre sécurité quand il s’agissait de charger un wagon plat en y projetant les rails à bout de bras.
Au hasard des jours, il nous arrivait de déblayer une rue, de creuser une tranchée pour remplacer une canalisation détériorée, de démonter une baraque, de décharger un wagon de briques ou un wagon de tuiles, de pelleter du poussier, de charger avec difficulté de la ferraille de récupération. Quand la chance nous souriait, nous étions appelés à aider des maçons ou des couvreurs, voire des téléphonistes pour planter leurs poteaux...
Toutes ces activités mettaient à mal pantalons et bourgerons de toile, nos vêtements de travail ; et davantage encore nos chaussures qui exigeaient chaque mois un ressemelage complet au prix fort.
La nourriture :
Le travail était souvent pénible, mais nous étions nourris en conséquence et j’ai déjà insisté sur la chance qui fut la nôtre à cet égard.
En France déjà, comme marins-pêcheurs, nous recevions les tickets d’alimentation réservés aux travailleurs de force ; en tant que cheminots de la Reichsbahn, il en fut de même à Wilhelmshaven.
Ce n’était pas un mince avantage, si l’on en juge par l’attribution qui nous était accordée chaque semaine, après déduction des tickets de matière grasse, de viande, de pâtes et d’œufs retenus pour les repas servis à la cantine du camp : 2500 g de pain de seigle, 500 g de pain de mie, 250 g de sucre, 200 g de confiture ou d’ersatz de miel, 100 g de fromage, 400 g de saucisson, 90 g d’ersatz de café, fruits ou lait écrémé selon la saison.
NB : 1. En sus, distribués en nature, 3 petits verres d’alcool et 30 cigarettes.
2. Pour Pâques, en supplément : un paquet de biscuits, une boîte de macédoine de légumes, deux oeufs durs et une petite bouteille de genièvre et des pralinés.
3. Afin de soutenir le moral de la population, un supplément alimentaire était accordé en cas de bombardement : 300 g de pain de seigle, 30 g de beurre ou margarine, 50 g de saucisson.
À cela s’ajoutaient les denrées contenues dans les colis que nous faisaient parvenir nos familles, pour ce qui me concerne, au rythme de deux expéditions par mois. Mes parents se démenaient pour acheter sans tickets des aliments non périssables : bien que travaillant en Allemagne, je restais donc partiellement à leur charge.
Les abris :
Bien avant d’arriver en gare de Wilhelmshaven, nous fûmes intrigués par l’existence de grands bâtiments à toit conique qui parsemaient l’espace urbain et ressemblaient à de colossales tours de défense moyenâgeuses. Nous eûmes tôt fait d’apprendre qu’il s’agissait d’abris, et les meilleurs dans leur catégorie.
Chacun de ces abris-tours pouvait accueillir environ six cents personnes, assises pour la plupart. D’une solidité à toute épreuve – vu leur forme et l’épaisseur des parois – ils offraient une protection maximale. Ce qui n’empêchait pas les femmes et les enfants de crier leur frayeur au premier fracas des bombes, quand les circuits électriques étaient perturbés par l’écho des impacts et que le mastodonte se balançait lentement au gré des larges ondulations du sous-sol tourbeux.
En dehors des tours – qui pouvaient bien être au nombre de deux douzaines en 1943 – les abris les plus sûrs se répartissaient surtout dans les quartiers d’habitation pavillonnaire et présentaient l’aspect d’imposantes maisons jumelées. C’est dans un tel bâtiment que nous trouvions refuge en cas d’alerte de nuit, après l’avoir rejoint dans l’obscurité en évitant d’être heurtés par les voitures d’enfant poussées au pas de course par des mères affolées...
D’autres vastes abris, enterrés ceux-là donc plus classiques, complétaient ce dispositif de protection civile, mais le bruit courait qu’ils ne résistaient pas aux torpilles aériennes, exemple de Brème à l’appui.
Quant à l’abri de terre du Reichsbahnlager, ce n’était qu’un pis-aller utilisé seulement par les retardataires et les moins débrouillards.
Utiliser la correspondance ?
Le problème se pose de savoir si les souvenirs sont fiables ou si, devenus une histoire que l’on se raconte à soi-même, ils ne réclament pas une confirmation écrite.
Des preuves officielles existent certes, mais elles sont très peu nombreuses à pouvoir être produites par les intéressés : dans mon cas personnel, la convocation et le titre de permission. Les autres pièces justificatives seraient à rechercher dans les archives de diverses administrations françaises ou allemandes, si elles n’ont pas été sinistrées ou mises au pilon...
Devant la pénurie de documents, on pourrait être tenté de recourir à la correspondance conservée dans les familles, mais, pour qui afficherait un souci d’objectivité, ce ne serait là qu’un expédient, car les informations contenues dans les lettres étaient dans bien des cas inexactes ou conjecturales.
En toute hypothèse, elles ne pouvaient pas être absolument sincères puisqu’il fallait tenir compte, d’une part du danger représenté par la censure d’un État totalitaire, d’autre part et surtout du risque d’alarmer inutilement les parents. On insistait donc, par principe, sur l’aspect neutre et rassurant des choses. Toutefois, le souci majeur qui était de rentrer en France transparaissait en leitmotiv dans les lettres, avec parfois l’allusion à une future clandestinité en cours de préparation.
DES MOIS ENTRE PARENTHESES
Certaines périodes de l’existence, parce qu’elles sont mal définies et anarchiques, sont vécues comme des vacances, bonnes ou mauvaises. Ce qui les caractérise est leur manque d’uniformité, leur instabilité. C’est justement cette précarité qui prévalut entre mon retour du STO, en décembre 1943, et mon engagement dans la gendarmerie en octobre 1944.
I. Séjour calvadosien
Je n’étais rentré d’Allemagne que depuis dix jours lorsque, le 23 décembre 1943, je quittai Montfarville pour gagner le Calvados où de bons amis de mes parents avaient, à leurs risques et périls, accepté de me donner asile.
Mon titre de permission étant encore valide, le voyage ne posait pas problème. Aucun contrôle de police ne vint d’ailleurs troubler ma quiétude sur le trajet Valognes – Littry, via Bayeux où je passai la nuit.
Le lendemain j’arrivai au « Titre », écart de la commune du Tronquay où habitait la famille d’accueil. En amis généreux, Charles et Marie Langlois s’étaient proposés pour me « camoufler » dans l’isolement de leur petite ferme bocagère. Je les connaissais depuis ma prime jeunesse, ayant passé chez eux, mais à Longues-sur-Mer, mes premières vacances d’écolier. De leurs trois enfants, seule Simone – la benjamine – vivait chez ses parents. L’aîné des fils s’était marié à Carentan, le cadet se trouvait à Châtel-Guyon, en zone dite « libre », où il était chauffeur du Général de La Porte-du-Theil17Général français, proche du maréchal Pétain, responsable des Chantiers de la jeunesse. Jugé insubordonné par l’Occupant, il est arrêté dans son bureau à Châtel-Guyon le 4 janvier 1944, quelques heures après avoir été démis de ses fonctions..
Le surlendemain 26 décembre, je me rendis à Balleroy chez M. Mouche – lui aussi ami de mes parents – un gendarme qui tenait à jouer un rôle dans la chaîne de solidarité. Il s’était chargé du placement dans une exploitation agricole, assez proche de sa résidence pour qu’il puisse me prévenir à temps en cas d’investigations allemandes. Rendez-vous fut pris pour le vendredi 7 janvier.
Au jour dit, je rejoignis M. Mouche sur un chemin de La Bazoque, petite commune située au sud-ouest de Balleroy, où j’étais censé trouver gîte et couvert. Après avoir marché un moment, nous entrâmes dans la cour rectangulaire d’une ferme d’élevage à l’aspect cossu et rassurant. Les brèves présentations et les recommandations appuyées ne durèrent que quelques minutes : mon ami tenait à rejoindre au plus vite son chef de brigade.
Le patron, M. Ch…, était un homme de taille moyenne, trapu et sanguin. Il me mit tout de suite au travail en disant que je devais d’abord gagner mon souper. Quand j’en eus terminé de la préparation des betteraves fourragères destinées aux bestiaux, il m’indiqua l’endroit où je pourrais dormir : dans le coin libre d’un vaste grenier à blé, deux « couches » de propreté douteuse, couvertes de peaux de moutons. « Il y a de la place pour quatre et vous n’êtes que trois. » À cette époque de l’année en effet, l’exploitation fonctionnait à effectif réduit et il ne restait que deux ouvriers à demeure : l’un d’origine polonaise, l’autre né en Algérie. Des journaliers seraient embauchés après l’hiver.
Disposant d’un viatique de 3000 francs, je m’en ouvris à M. Ch… en lui demandant de conserver la somme pour plus de sûreté. Du coup l’homme se ravisa, m’invita à le suivre à la maison et obtint de son épouse qu’elle mette une chambre à ma disposition. Un tel revirement en disait long sur la mentalité de mon employeur.
Je ne m’attarderais pas à La Bazoque, M. Ch… était un paysan aisé, tout à la fois vaniteux et madré qui s’enorgueillissait de sa situation. Syndic de la commune pour la répartition des engrais et des semences, il aimait répéter avec suffisance qu’il se sentait, sur ses terres, comme dans une principauté.
Il n’avait pas tout à fait tort. Protégé par les gendarmes à cause des clandestins qu’il utilisait à l’occasion, il ne craignait rien des Allemands, qui venaient régulièrement se ravitailler chez lui, où ils étaient reçus en amis.
Supportable à jeun, il se montrait « pesant » sous l’emprise de l’alcool quand la journée s’avançait. Son langage exprimait alors la brutalité et le mépris. Sa femme avait visiblement peur de ce tyranneau campagnard.
Je reçus mon compte de vexations diverses de la part d’un malotru qui, pourtant, paraissait très respectable le dimanche quand, avec son épouse et sa fille, il se rendait à la messe dans son élégant tilbury.
Lorsque, le 12 janvier au matin, je lui demandai de l’accompagner à Littry, afin de rentrer chez mes amis, il comprit qu’il était allé trop loin. Son ton redevint presque aimable, mais le mal était fait. Je n’avais pas eu le temps de connaître vraiment les deux autres travailleurs, seul le Polonais m’avait aidé de ses conseils. Mais je regrettai la gentillesse de Mme Ch… et la candeur de sa fille.
À peine avais-je quitté mon ex-patron sur le marché de la mine, à Littry, que je rencontrai M. Mouche, surpris et fâché de me trouver là. Après m’être expliqué, je rentrai au Tronquay où je fus de nouveau très bien accueilli. Tout était à recommencer car il me fallait trouver un nouveau point de chute, ce qui paraissait bien difficile. En attendant, j’allais m’occuper à des tâches hivernales : il y a toujours du bois à scier ou à fendre, des ronces à éliminer, des bêtes à soigner.
Charles Langlois travaillait trois jours par semaine chez Armand Langlois, maire de Campigny, qu’il appelait « Maître Armand ». Le 24 janvier, mon ami m’annonça que je viendrais avec lui le lendemain à Campigny où je pourrais travailler à mon aise comme jardinier. Ayant pratiqué la culture maraîchère à Montfarville, cette solution me convenait parfaitement.
Le 25 janvier, j’allais m’installer dans un local dépendant d’un grand jardin légumier entouré de murs, tel qu’il en existe dans toutes les grandes fermes du Bessin. Comme j’attendais d’être reçu, un gendarme arriva à bicyclette pour repartir au bout de quelques minutes. C’était un membre de la brigade de Bayeux qui venait d’informer le maire de l’imminence de visites domiciliaires allemandes visant à capturer les clandestins, et il avait ajouté que le jeune homme aperçu dans la cour ne semblait pas être un ouvrier agricole.
Le maire de Campigny était désolé mais, dans ces conditions, il ne pouvait donner suite à son projet. En revanche, il s’engagea à me procurer des tickets d’alimentation aussi longtemps que je serais l’hôte de mes amis Langlois.
Revenu pour la seconde fois au Tronquay, je ne voulais pas mettre mes protecteurs plus longtemps en difficulté. Mme Binard, la future belle-mère de Simone, se faisait l’écho de bruits inquiétants : certaines personnes supportaient mal la présence de certains camouflés ici ou là, alors que les prisonniers de guerre se morfondaient toujours en Allemagne.
Après avoir prévenu ma famille par téléphone, je regagnai le Val-de-Saire le 29 janvier en compagnie du « Père Charles ». Ayant embarqué en gare du Molay-Littry, nous comptions sur un voyage aussi calme qu’à l’aller. Dès Lison pourtant, nous constatâmes que des porteurs de valises étaient interpellés sur le quai par des policiers en civil traquant le marché noir.
Quand le train s’arrêta à Neuilly-la-forêt, dernière station du Calvados, nous étions curieux de savoir si le contrôle persistait. Nous fûmes bientôt fixés. Longeant la rame à contre-voie, le chef de gare attirait l’attention des voyageurs d’un petit choc sur la vitre en disant : « La Gestapo est dans le wagon ! » Le convoi s’ébranla de nouveau. Ce ne fut pas un civil en manteau de cuir qui se présenta, mais un militaire à plaque de la Feldgendarmerie. Mon compagnon ne l’intéressait pas vu son âge. C’est à moi qu’il s’adressa : « Papier bitte ! Où travaillez-vous ? »
Pour la première fois il me fallait utiliser ma fausse carte d’identité. Je me levai et répondis que je travaillais près de Carentan, à Sainte-Mère-Église où j’étais apprenti charcutier. Avais-je été très convaincant ? Le militaire était-il pressé, ou très compréhensif ? Toujours est-il qu’il n’attendit pas que j’en aie fini d’extirper mes papiers de l’une des poches de mon blouson. Le « brave homme » avait fait demi-tour et refermé la porte du compartiment. Rétrospectivement, j’en pousse encore un « ouf ! » de soulagement. En gare de Carentan, une bonne douzaine de personnes descendirent, qui étaient manifestement en état d’arrestation.
Le reste du voyage ne fut troublé par aucun incident. À Valognes m’attendait Mme Leproist, une commerçante revenant du marché ; elle me ramena à Montfarville dans sa camionnette.
II. Semaines calmes
Il ne fallait pas se voiler la face, ce retour à Montfarville était un constat d’échec. Le plan mis au point par mes parents et leurs amis s’était avéré fragile. Il semblait aussi hasardeux de se cacher dans le Calvados que dans la Manche. De toute manière, tout clandestin mettait en danger les gens qui l’abritaient.
Mes parents étant décidés à en assumer le risque, j’allais rester sous leur toit où je vivais cloîtré. L’un de mes premiers actes fut de détruire mes faux papiers et d’en aviser la personne qui me les avait généreusement procurés. Louis Ernest Perrault, né le 3 janvier 1925 à Sainte-Mère-Église, redevenait Louis Marius Pesnel, né le 14 septembre 1922 à Montfarville. La tentative de rajeunissement avait échoué.
L’isolement serait tout relatif, puisque vécu au sein de ma famille, qui me renseignerait sur les nouvelles et les rumeurs locales. Pour tout le monde – ou presque – j’étais reparti en Allemagne à l’issue de ma permission. Je n’étais plus dans la commune, je n’avais pas de carte d’alimentation. Personne ne devait m’apercevoir.
L’inactivité allait bientôt me peser plus que prévu car, même en hiver, le travail à couvert est des plus réduits à la campagne. L’on vient vite à bout d’un peu de bricolage, de la préparation des semences et de l’organisation détaillée des travaux à venir.
Aussi longtemps que la saison serait aux frimas, les semaines s’ébranleraient en douceur. Mais tout deviendrait différent au retour du printemps.
Rien n’est aussi débilitant que de nier sa propre existence alors que le soleil ranime la nature. La sensation d’enfermement paraît d’autant plus démoralisante qu’on se l’impose à soi-même comme une sorte d’autopunition. Sans doute mes parents étaient-ils soulagés de me savoir près d’eux, loin des bombes qui tombaient sur l’Allemagne, mais je les voyais également soucieux de ce qui pouvait m’advenir à domicile.
De mon côté, j’avais tout loisir de réfléchir à l’absurdité de certaines situations. Contraint au STO, je m’étais senti plus utile à mes camarades de Wilhelmshaven qu’à la Reichbahn qui m’employait. Je ne m’étais pas conduit en esclave. À Montfarville, j’en étais réduit à me cacher et à me taire. À l’âge de l’impatience, il est pénible de ronger son frein, de se sentir hors-jeu interminablement.
Tuer le temps par des relectures, par des révisions prolongées. Suivre les informations en essayant de faire la part de l’exagération ou du non-dit. Tenter de deviner… progression des Alliés en Italie, mais liquidation par la Wehrmacht du maquis du plateau des Glières18Ce maquis, situé en Haute-Savoie, composé de quelques centaines de maquisards, est attaqué à la fin du mois de mars 1944 par les forces allemandes. Durant cette bataille, une centaine de maquisards y laisseront la vie. ; heurs et malheurs.
Des semaines, des semaines qui paraissent de plus en plus longues. Mes parents s’inquiètent de me voir miné par la réclusion, passant de l’excitation à l’abattement. C’est ma mère qui va prendre la décision : début avril, elle annonce au voisinage que je suis rentré d’Allemagne comme malade. Les gens la croient ou ne la croient pas. Peu importe, chacun fera « comme si ».
D’ailleurs, quand je reparais au grand jour, personne ne me questionne. Sans doute remarque-t-on qu’on ne me voit jamais à Barfleur ou au bourg de Montfarville, et que j’évite soigneusement la proximité des uniformes. Personne n’en parle. En ces temps troublés, la curiosité ne s’exprimait pas à voix haute.
Je me rendrai presque chaque jour dans notre champ de « La Planque » – le bien nommé – mais en empruntant toujours des « chasses » : chemins de terre encaissés, à l’époque encore bordés de haies. J’y reprendrai mes habitudes de travail, seul ou en compagnie de ma mère et de mémère Daireaux, marcheuse émérite.
Plus question de s’ennuyer. Il faut récolter les choux-fleurs tardifs ainsi que les choux prompts de Tourlaville. Il faut bêcher ici, préparer ailleurs la terre pour les semis après labour superficiel. Il faut assurer les plants de pommes de terre et le repiquage des salades. C’est l’enchaînement et la diversité des jours avec, en prime, le calme intérieur. Je vis toujours en marge, mais cette fois d’un cœur léger. Maintenant que je ne suis plus confiné au logis, je me sens protégé par la verdure. Après l’inquiétude, la sérénité…
III. Semaines fiévreuses
Vers la mi-mai, il devint clair que les Alliés préparaient bien l’action de grande envergure annoncée depuis longtemps : à savoir, l’ouverture d’un nouveau front, en plus du front italien.
Non seulement nous étions informés de la multiplication des raids « terroristes »19Terme utilisé par les autorités de Vichy pour désigner les bombardements et les attaques alliées sur le territoire français. C’est ce terme que nous retrouvons également sur bon nombre d’affiches de propagande. sur les villes françaises avec destruction des gares, en même temps que la recrudescence des bombardements massifs sur l’Allemagne, mais la machine de guerre cessait de nous ignorer. Dans notre Val-de-Saire tranquille – pour ne pas dire endormi – le ciel s’animait peu à peu d’incursions aériennes de courte durée visant la colline de « La Pernelle », seul objectif militaire d’importance stratégique. Les « veuves noires », chasseurs-bombardiers Lightning20Chasseur américain à double fuselage, armé d’un canon de 20 mm et de quatre mitrailleuses, qui peut transporter dix roquettes. à double fuselage[,] s’assuraient une maîtrise incontestée et lâchaient leurs roquettes sur l’aire fortifiée.
Distante de Montfarville de 5 kilomètres à vol d’oiseau, « La Pernelle » fut bombardée sept fois en mai, dont cinq fois dans la seconde partie du mois. Le processus allait en s’accélérant et les avions mitraillaient au sol tout convoi de véhicules. Le doute n’était plus permis : l’attaque était imminente.
Si le travail des champs continuait, la pêche était réduite à sa plus simple expression. Les postes de radio ayant été déposés en mairie sur ordre de l’Occupant, nous ne captions plus la BBC et les nouvelles crédibles devenaient rares.
Chaque famille avait préparé un abri de fortune en espérant ne jamais l’utiliser. Le nôtre se trouvait au fond du jardin. J’avais creusé pendant une vingtaine d’heures dans un sol très compact pour réaliser une tranchée en forme de T, saine et bien aérée, protégée par d’épais panneaux de cale recouverts d’un amoncellement de terre.
Nous attendions que l’orage éclate. Le 2 juin, « La Pernelle » fut de nouveau bombardée la nuit, puis deux fois en plein jour le samedi 3 juin. Ce jour-là, une voisine qui revenait de Barfleur rapporta la réflexion d’un soldat allemand qui, chez le boucher, avait lancé aux clientes : « Ne riez pas trop Mesdames ! Vos amis anglais se préparent dans leurs bateaux ! La semaine prochaine, Barfleur Kaputt ! ». Les avions revinrent à deux reprises dans la matinée du 5 juin. L’ambiance devenait électrique.
Nous venions de nous coucher, le soir du 5 juin, quand « La Pernelle » fut attaquée. Il n’était pas encore 23 heures. Les bombes explosaient sur la colline parsemée de fusées éclairantes. Les quatre projecteurs de DCA installés l’avant-veille à Montfarville balayaient le ciel nocturne, l’arsenal anti-aérien jouait sa partition à contretemps. L’action étant bien ciblée, il n’y avait pas lieu de se rendre à l’abri.
Plus tard encore dans la nuit, mon père me réveilla. On entendait toujours des avions, mais ceux-ci bourdonnaient en altitude : un bruit qui ne cessait pas. Et dans le lointain, plein sud, perdurait à l’horizon un rougeoiement insolite, en même temps que des grondements sourds se répercutaient confusément jusqu’à nous.
Et ce fut le matin du 6 juin, la révélation au lever du jour, l’incroyable ! Des fenêtres du grenier, l’on apercevait une imposante armada de navires divers surmontés de ballons captifs, la mer couverte par l’énorme convoi se dirigeant vers le sud. Plus qu’un convoi : une marée de bateaux !
Bientôt, de l’autre côté de la maison, déboulèrent en nombre et à très basse altitude, dans un bruit assourdissant, notre cohorte d’avions bimoteurs marqués de cinq bandes alternées et tirant chacun un planeur en remorque. Protégés par des chasseurs, eux aussi fonçaient vers le sud.
De petits groupes d’Allemands passaient, le casque orné de feuillage, décontenancés devant ce déferlement de puissance. Tirer sur les avions et planeurs qui étaient réellement à portée de fusil, ils ne s’en avisèrent pas, ou beaucoup trop tard ; car il n’y eut qu’un passage d’une telle hardiesse.
Quant aux petites batteries côtières de Barfleur, elles ne prirent pas le risque de se distinguer par quelques coups au but en ouvrant le feu sur un ennemi d’une supériorité aussi écrasante. De son côté, la chasse américaine omniprésente qui tournoyait au-dessus d’elles leur rendit la politesse en ne les prenant pas pour cible. « Gentlemen[’s] agreement » ou accord tacite ? Le bruit courut a posteriori que le responsable allemand avait voulu éviter la destruction de Barfleur, pour remercier la population d’être venue spontanément en aide, quelques jours plus tôt, à un groupe de soldats blessés victimes d’un mitraillage aérien.
En ce 6 juin, un point était acquis pour nous : le Débarquement était en cours dans le sud, entre la dune et les Veys – future Utah Beach. Ce fut vite confirmé. Et nous apprîmes avec soulagement que les Alliés avaient également pris pied sur la côte du Calvados, entre les Veys et l’embouchure de l’Orne, zone qui nous était bien connue. Les nouvelles se propageaient de bouche à oreille à partir de « quelqu’un qui possédait un poste à galène ». La libération nous paraissait toute proche, tant l’optimisme nous habitait. Seule inquiétude : la météo peu favorable à l’atterrissage des engins amphibies sur les plages.
Il reste que, pour nous, le 6 juin ne fut pas « le jour le plus long » ; ce fut le plus beau des jours. Ni le jour de la délivrance effective, ni celui de la capitulation allemande ne seront porteurs de la même charge émotionnelle, et de très loin.
Le 7 juin au matin, je m’occupais au grenier quand me parvint le bruit caractéristique d’avions volant en formation. Il s’agissait d’une escadrille de bombardiers type Marauder – une dizaine environ – venant de la mer et se dirigeant vers l’ouest à une altitude approximative de 1500 mètres. Je ne les regardai qu’un instant, le temps de comprendre qu’ils venaient de se soulager de leurs lourds projectiles.
Bien que m’étant tout de suite lancé dans l’escalier pour tenter de gagner le jardin, je n’étais parvenu qu’au premier étage au moment de l’impact. La maison fut ébranlée par l’onde de choc, à tel point que l’une des fenêtres s’ouvrit d’elle-même.
Je vis l’énorme quantité de terre soulevée par les bombes retomber au ralenti sur le village de l’Église avant que ne se dissipe la fumée des explosions. C’était la batterie de projecteurs, distante de près de 600 mètres, qui était l’objectif du raid. Nous apprîmes bientôt que la réussite était complète et qu’on ne déplorait aucune victime parmi la population. La commune de Montfarville ne connut pas d’autre attaque.
Ce jour-là encore, « La Pernelle » reçut son lot de bombes et quelques obus de marine. Mais les canons de 105 mm et de 170 mm ne répondaient plus.
Les jours suivants, il ne se passa rien de notable en dehors de la présence intermittente de l’aviation alliée. Les convois maritimes ne naviguaient plus aussi près de la côte et paraissaient moins fournis. Les nouvelles du sud étaient imprécises et parfois contradictoires. À 25 kilomètres de chez nous, c’était la guerre, et notre bout de terre était redevenu calme. Il allait le rester, en apparence.
En fait, les Allemands envisageaient déjà leur repli sur la place forte de Cherbourg qui devait être tenue coûte que coûte ; et ils s’organisaient en conséquence. D’ailleurs, il nous semblait que le corps expéditionnaire piétinait le dos à la mer et qu’un revers était encore à craindre. Nous prenions aussi conscience de l’ampleur des destructions subies par les villes normandes.
Après quelques journées de repos forcé, les cultivateurs avaient repris le chemin des champs. Il fallait sarcler et biner les surfaces légumières, assurer la fenaison dans les prés. De temps à autre, comme pour mieux se rendre compte de l’activité des fourmis humaines, un chasseur US descendait en vrombissant avant de remonter en chandelle dans l’azur. Chacun trouvait normal de jouir ainsi d’une sorte d’immunité.
L’on n’apercevait plus guère les Allemands qui paraissaient d’ailleurs nous ignorer et ne prenaient aucune mesure de police à l’encontre des habitants, en dehors du couvre-feu. La défense côtière restait amorphe, [par] mauvaise orientation ou par attentisme. La batterie de l’armée de terre installée au nord de Barfleur, à Gattemare, sur la commune de Gatteville, n’utilisa pas ses quatre canons de 155. Non loin d’elle, la batterie de marine de la pointe de Néville, dite « Blankensee », n’influera pas davantage sur le cours des événements.
Mais la fièvre était dans nos cœurs, justement parce que rien ne bougeait plus chez nous. Nous constations que les Américains hésitaient à occuper le Val-de-Saire côtier avant d’avoir conquis les collines formant le socle vertébral du Cotentin. Les Allemands allaient s’appuyer sur elles pour réussir leur retraite programmée sur Cherbourg, ce qui expliquerait leur manque d’initiative dans la phase finale où la tactique resta, de leur part, purement défensive.
Nous avions su que la ville de Bayeux avait été libérée intacte, contrairement à d’autres cités de moindre importance. Nous apprenions que les Alliés mettaient en place des appontements d’un type nouveau21Sachant qu’il sera difficile de s’emparer d’une ville portuaire dans un court délai, les Alliés entrevoient, dès 1942, de créer des « ports artificiels ». Ces Mulberries (nom de code donné aux ports artificiels) sont formés de vieux navires sabordés et d’immenses blocs de béton reliés par des jetées flottantes ; ils émergent ainsi devant les plages de Saint-Laurent-sur-mer et Arromanches. Ils permettront aux gros bateaux de décharger leur matériel. Entre le 19 et le 22 juin, une tempête ravage le Mulberry de Saint-Laurent, et endommage très fortement celui d’Arromanches., et que des fusées V122 Vergeltungswaffe eins : arme de représailles no 1. Missile à guidage réglé dont le premier envoi, le 12 juin 1944, touche le sud de l’Angleterre. En raison de sa proximité avec les centres urbains anglais, le Cotentin est une base privilégiée pour l’implantation des rampes de lancement. Bon nombre d’entre elles seront copieusement bombardées et rapidement rendues inactives. tombaient sur Londres. À partir du 16 juin, le vent s’installa au nord-est et fraîchit dans les jours suivants : de quoi nourrir de grandes inquiétudes pour l’acheminement des renforts.
C’est dans la nuit du 18 au 19 juin que les troupes allemandes évacuent très discrètement la partie nord du canton de Quettehou afin de mieux défendre Cherbourg et l’aérodrome de Maupertus. Le 19 juin, plus d’Allemands à Barfleur ou à Montfarville. Dans l’après-midi, une patrouille motocycliste venant de Tocqueville surgit à Barfleur, dans la rue Saint-Thomas, abondamment pavoisée en l’honneur des Américains. Les éclaireurs allemands n’en croient pas leurs yeux et font aussitôt demi-tour, persuadés de la proximité de l’ennemi.
Le 20 juin, le groupe de cavalerie américain, qui a pris Saint-Vaast et Quettehou le 19, occupe le reste du canton. De « La Bretonne » à Barfleur, nous sommes une bonne vingtaine de gens de tous âges à nous être engagés sur la route côtière D1 à la rencontre d’une avant-garde beaucoup trop timorée. Nous sommes bientôt près des GI’s que nous remercions du geste et de la voix. Nous leur disons que les Allemands sont partis depuis plus d’une journée. Sans doute le savent-ils, car ils ne marquent aucune surprise.
Autre chose les intéresse : « Que pensez-vous du Général Giraud23Cette anecdote est intéressante à double titre. Premièrement, elle montre l’intérêt allié porté à l’opinion publique normande et française. Sur de nombreux sujets (les bombardements, le ravitaillement, ici la politique), la population sera interrogée afin de sonder l’état d’esprit du moment. Deuxièmement, la référence au général Giraud est révélatrice des envies alliées. Roosevelt, considérant de Gaulle comme un apprenti dictateur, s’efforce de placer en première ligne un dirigeant, qu’il trouve en la personne de Giraud. Conseillé, Giraud, se résout à rencontrer de Gaulle et ils forment ensemble le Comité français de la libération nationale le 30 mai 1943. Très vite il s’efface au profit de son homologue avant de démissionner de son poste de commandant en chef des troupes françaises d’Afrique du Nord. Il nous faut tout de même noter qu’à la date du questionnement de Louis Pesnel (le 20 juin 1944), de Gaulle a d’ores et déjà installé en Normandie (depuis sa visite du 14 juin 1944) un commissariat général de la République, avec à sa tête François Coulet. Le devenir de de Gaulle ne laisse plus de doute. ? » s’enquiert un lieutenant. Du tac au tac, je lui réponds que nous préférons le Général de Gaulle ! C’est du galop cavalier… Sur le half-track de tête, le jeune officier crayonne sur son carnet. Des soldats jettent chewing-gum et cigarettes vers les paires de mains qui se tendent, les nouveaux arrivants étant de plus en plus nombreux. De chaque côté de la route, d’autres GI’s passent méthodiquement la berne24Bas-côté de la route, en patois normand, d’après le Dictionnaire du français régional de Basse-Normandie de René Lepelley. à la « poêle à frire ».
Nous venons d’être libérés ! Un plaisir à savourer, à ruminer ? À Montfarville comme à Barfleur, l’Occupation aura duré quatre années jour pour jour.
Dans la matinée du 21 juin, la curiosité m’amena sur la route D 901 qui, de Barfleur, s’étire plein ouest en direction de Cherbourg. À bicyclette, je dépassai Tocqueville sans encombre sans rencontrer le moindre militaire, seulement quelques civils. S’il n’y avait pas eu de ballet aérien et l’écho de bombardements multiples, j’aurais pu douter de la réalité de la guerre. Ce n’est qu’à l’approche de Saint-Pierre-Église que se firent distinctement entendre le martèlement sec de l’artillerie légère et les hoquets indisciplinés des armes automatiques.
Je stoppai à un kilomètre de la bourgade, dans le secteur de la Lande Michaud, près d’un groupe de blockhaus situé au nord de la départementale. « Ils ont pris Saint-Pierre, mais ils se battent dans les Hauts », affirma un gars paraissant bien renseigné. Effectivement, des bruits d’escarmouches nous parvenaient du sud-ouest, en direction de Théville.
Je pouvais repartir tranquille, le reflux se poursuivait. Ce qui m’avait le plus surpris, lors de cette reconnaissance à distance respectueuse, c’était la faible épaisseur de la zone de combat, une simple ligne de feu, un ruban de terrain « flottant » où les adversaires devaient être au contact et constamment en mouvement. Les Allemands décrochaient sur Cherbourg, sans panique et sous la pression américaine qui ne leur laissait aucun répit. Il faudra attendre encore six jours avant que toutes les défenses du grand port militaire normand ne soient tombées. Quelque 39 000 Allemands de toutes armées y seront faits prisonniers.
Comme j’allais repartir en sens inverse, un individu me proposa de l’accompagner dans l’enceinte fortifiée toute proche abandonné[e] par les Frisés25Terme péjoratif utilisé pour désigner les soldats allemands.. On y trouverait, disait-il, du matériel coûteux à récupérer, et, pour ce genre de travail, mieux valait être deux… L’entreprenant quidam dut chercher un autre complice.
Tout danger immédiat étant écarté, notre anxiété subsistait quant aux autres parties du front bas-normand, en particulier à cause de l’échec de l’opération « Epsom » à l’ouest de Caen. L’armée allemande, très déterminée, opposait aux forces alliées une résistance farouche. De plus, les dégâts considérables subis lors de la tempête du 18 au 21 juin menaçaient l’approvisionnement des divisions débarquées.
Nous nous intéressions aussi à l’activité supplétive du port de Barfleur, devenu pour quelques semaines, avec Saint-Vaast-la-Hougue, un site animé par le débarquement de denrées alimentaires et d’équipements militaires. Les « Liberty ships », incapables de venir à quai en raison de leur tirant d’eau, s’échouaient en pleine mer au milieu du havre. Le débardage s’opérait sans retard au moyen d’une marée de « ducks », véhicules amphibies qui recevaient du cargo les palanquées destinées aux camions GMC à ridelles en attente à proximité des cales. Il eût été difficile d’imaginer une telle profusion de marchandises diverses.
Mais les tâches matérielles imposaient quotidiennement leurs contraintes. À la terre, juin et juillet sont des ogres de travail.
Distraction régulière et très suivie : une jeep du service de presse de l’armée U.S. passait de commune en commune, une fois par jour et à heure fixe, pour informer la population de vive voix, une version moderne de nos anciens tambours municipaux. Nous étions assoiffés de nouvelles. Après la mi-juillet, ce fut l’annonce de l’opération « Goodwood » au sud de Caen – un demi-échec – puis celle de l’attentat contre Hitler26Cette tentative d’assassinat intervient le 20 juillet 1944. Fomentée par des membres de l’entourage d’Hitler, la tentative se solde par un échec, le Führer n’étant que très légèrement blessé. Bon nombre de témoins font référence à cet événement : le martèlement dans la presse et l’espoir d’une fin prochaine étant deux raisons explicatives de ce phénomène..
Dans la matinée du 25 juillet, je travaillais à « La Planque » lorsque j’aperçus, volant très haut dans le ciel bleu, des forteresses se dirigeant vers le sud en formations serrées et nombreuses. Les bombardiers lourds se comptaient par centaines ; j’en dénombrai plus de mille. Ce jour-là, 5000 tonnes de bombes allaient être déversées à l’ouest de Saint-Lô, sur un couloir d’une superficie de douze kilomètres carrés. C’était le début de l’opération Cobra27Embourbés dans une « guerre des haies », les stratèges américains entreprennent une opération afin de percer une brèche dans la ligne défensive allemande. Cette opération, qui débute le 25 juillet 1944, a comme nom de code « Cobra ». Avant cette attaque, les Alliés procèdent à la stratégie habituelle du tapis de bombes. qui serait déterminante pour la suite de la guerre.
Dès les premiers jours du mois d’août, la réussite de la percée d’Avranches augurait bien des combats à venir. La cuirasse défensive avait enfin cédé. Mais, avec le temps qui passait, nous venait l’envie de participer, s’il n’était pas déjà trop tard. Nous étions plusieurs, à Montfarville et Barfleur, à vouloir nous engager dans la Marine nationale. À Cherbourg, où nous nous présentâmes dans l’enceinte de l’arsenal, on nous affirma que la Flotte n’avait nul besoin de jeunes recrues : une déception qui m’atteignit profondément.
IV. En attente d’avenir
La fin de non-recevoir opposée par la Marine m’avait soudain plongé dans le doute quant à mes lendemains professionnels. Jusque-là, j’avais cru – en me prévalant d’une première inscription au concours d’entrée à l’École de maistrance en 1940 – que je pourrais, par dérogation, être autorisé avec d’autres à suivre les cours à titre exceptionnel. Je constatai qu’il n’en était rien. Je n’avais plus qu’à m’orienter vers une autre voie, mais laquelle ?
Depuis que je vivais à Montfarville j’avais consulté bien souvent le « guide des carrières Carus » dont la conception visait d’ailleurs moins à éclairer le lecteur sur les qualités innées ou acquises adaptées à l’exercice de tel ou tel métier qu’à présenter des formations par correspondance préparant à divers concours administratifs ou brevets techniques.
La navigation n’étant plus à ma portée, et le sort incertain des instituteurs remplaçants ne me tentant guère, j’aurais bientôt à porter mon choix sur un emploi de fonctionnaire dans les Postes, les Chemins de fer, les Ponts et chaussées ou la Reconstruction qui, sans doute, offriraient de larges débouchés. Sans oublier l’arsenal de Cherbourg qui était le premier employeur de la région.
Mais cela supposait que l’on soit revenu partout à la vie normale, que l’État ait été réorganisé, que la France ait été entièrement libérée. Nous n’en étions pas encore là. En août 1944, les habitants du Cotentin étaient toujours isolés dans leur presqu’île ; aucune démarche n’était possible, la précarité se prolongeait.
En attendant, l’ouvrage ne manquait pas. Plusieurs milliers de choux à planter, du sarclage au rabot dans les rangs de poireaux, des semis de salade, des haricots à cueillir verts pour la vente, des pommes de terre à récolter : il y fallait des bras et de la persévérance. En septembre, il faudrait arracher les carottes et récolter encore haricots, oignons et pommes de terre ; puis biner les choux-fleurs avant de passer à d’autres occupations.
L’on voyait davantage de soldats américains, en majorité des hommes de couleur occupés au transport et à la surveillance du matériel. Les militaires étant hébergés dans des camps de toile, les rapports avec la population restaient superficiels.
Pendant ce temps, les événements se succédaient. Rentrés en possession de notre radio, nous suivions le développement des opérations : la contre-attaque allemande sur Mortain, puis son échec28Regroupés à Rancoudray, les Allemands lancent une contre-offensive le 7 août 1944 au matin, réunissant sept divisions dont quatre Panzer. Cette opération, dite « Lüttich » (« Liège »), a comme objectif de percer vers Avranches et ainsi de pouvoir couper en deux les lignes américaines qui poursuivent leur pénétration en direction de la Bretagne. Bénéficiant de l’effet de surprise et du brouillard, les Allemands parviennent à reprendre Mortain. Mais, quelques heures plus tard, le soleil ayant eu raison du brouillard, les chasseurs bombardiers alliés entrent en action, causant de sérieux ravages dans les lignes allemandes. La tentative de contre-attaque allemande échoue grâce aussi à l’arrivée de renforts américains. ; le galop américain en direction du Mans, puis d’Alençon et d’Argentan ; l’avance simultanée des Anglais ; le débarquement allié en Provence29Survenue le 15 août 1944, l’opération Anvil, rebaptisée Dragoon, devait permettre aux Alliés de prendre pied sur la côte méridionale du pays afin de pousser vers le nord et opérer une jonction avec les troupes débarquées de Normandie. À l’instar de ce témoignage, ce débarquement allié est mentionné dans les écrits normands, certes de façon très brève. ; les Allemands chassés de Normandie ; les plus grandes villes libérées : Paris et Marseille fin août, Lyon début septembre.
À Barfleur, le débarquement de « divers » avait été abandonné dans la première quinzaine de juillet. Et les pêcheurs avaient repris le rythme des marées, munis provisoirement d’un sauf-conduit américain venu remplacer l’Ausweiss allemand.
Mon père, qui lui aussi avait repris la mer, dut mettre ses filets au sec. Encore mobilisable, il venait d’être rappelé dans la gendarmerie et affecté à la brigade de Saint-Vaast-la-Hougue. C’est lui qui, en octobre 1944, m’annonça qu’on y recrutait de jeunes auxiliaires. Je ne balançai pas : saisissant la perche tendue par le hasard, je m’engageai sans plus attendre.
C’est ainsi que se termine, par une ouverture sur la vraie vie, cet entre-temps chaotique traversé en spectateur attentif, ces mois entre parenthèses marqués au coin de l’espoir, de la chance et de la liberté.
- 1. Avant l’institutionnalisation du STO, Pierre Laval avait inventé le système dit de « la relève ». Celui-ci prévoyait, dès juin 1942 et dans le but d’accroître le nombre de départs volontaires pour l’Allemagne, l’envoi d’ouvriers en contrepartie du retour en France de prisonniers de guerre. L’échec de cette mesure poussera le gouvernement français à en adopter de nouvelles.
- 2. Entreprise créée par Fritz Todt pour réaliser les grands travaux, notamment en Normandie le Mur de l’Atlantique et la construction des plates-formes de lancement des « armes de représailles » de type V1 (cf. ici même note no 22).
- 3. Sur les 1889 réfractaires de la Manche identifiés, seuls 25 appartiennent à la catégorie des marins-pêcheurs. M. BOIVIN, Les Manchois dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale : 1939-1945, Tome 3, L’Occupation : l’ordre allemand, le régime de Vichy et la collaboration, Marigny, Eurocibles, 2004, p. 314.
- 4. Compagnie nationale des chemins de fer allemands.
- 5. Michel Boivin avance que le salaire mensuel des requis de la Manche est compris entre 100 et 200 marks pour environ dix à douze heures de travail par jour. M. BOIVIN, op. cit., p. 243.
- 6. Michel Boivin a retrouvé 91 actes de décès de requis dans les registres d’état civil des communes de la Manche. L’historien note que « 42,5 % des décès sont dus à la maladie (tuberculose, appendicite, diphtérie, méningite) » (op. cit., p. 243). Mal soignées, ces maladies parfois bénignes deviennent en effet fatales. En outre, les bombardements causèrent 26,2 % des morts originaires de la Manche en Allemagne.
- 7. L’envoi de courrier n’étant pas limité jusqu’au début de l’année 1944, les requis envoient de façon régulière des plis en France.
- 8. Chantier naval et port d’attache des U-Boote (sous-marins), Wilhelmshaven est l’un des points névralgiques de la marine du Reich.
- 9. Exercices physiques, souvent disciplinaires ou vexatoires.
- 10. Konzentrationslager : camp de concentration.
- 11. Date de l’annonce de l’armistice signé entre l’Italie et les Anglo-Américains.
- 12. Dès septembre 1943, les autorités allemandes réduisent le nombre des permissions. La raison de cette baisse est le non retour en Allemagne d’une partie des bénéficiaires de ces permissions. L’étude sur les requis de la Manche montre que, des 758 requis rentrés en permission, 67,7 % ne sont pas retournés en Allemagne.
- 13. R eichs m ark.
- 14. En Allemagne, en mai 1933, les syndicats sont interdits et remplacés par le Front allemand du travail (Deutsche Arbeitsfront, DAF).
- 15. Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
- 16. N ational s ozialistische D eutsche A rbeiter p artei : parti national socialiste des travailleurs allemands dirigé par Hitler.
- 17. Général français, proche du maréchal Pétain, responsable des Chantiers de la jeunesse. Jugé insubordonné par l’Occupant, il est arrêté dans son bureau à Châtel-Guyon le 4 janvier 1944, quelques heures après avoir été démis de ses fonctions.
- 18. Ce maquis, situé en Haute-Savoie, composé de quelques centaines de maquisards, est attaqué à la fin du mois de mars 1944 par les forces allemandes. Durant cette bataille, une centaine de maquisards y laisseront la vie.
- 19. Terme utilisé par les autorités de Vichy pour désigner les bombardements et les attaques alliées sur le territoire français. C’est ce terme que nous retrouvons également sur bon nombre d’affiches de propagande.
- 20. Chasseur américain à double fuselage, armé d’un canon de 20 mm et de quatre mitrailleuses, qui peut transporter dix roquettes.
- 21. Sachant qu’il sera difficile de s’emparer d’une ville portuaire dans un court délai, les Alliés entrevoient, dès 1942, de créer des « ports artificiels ». Ces Mulberries (nom de code donné aux ports artificiels) sont formés de vieux navires sabordés et d’immenses blocs de béton reliés par des jetées flottantes ; ils émergent ainsi devant les plages de Saint-Laurent-sur-mer et Arromanches. Ils permettront aux gros bateaux de décharger leur matériel. Entre le 19 et le 22 juin, une tempête ravage le Mulberry de Saint-Laurent, et endommage très fortement celui d’Arromanches.
- 22. Vergeltungswaffe eins : arme de représailles no 1. Missile à guidage réglé dont le premier envoi, le 12 juin 1944, touche le sud de l’Angleterre. En raison de sa proximité avec les centres urbains anglais, le Cotentin est une base privilégiée pour l’implantation des rampes de lancement. Bon nombre d’entre elles seront copieusement bombardées et rapidement rendues inactives.
- 23. Cette anecdote est intéressante à double titre. Premièrement, elle montre l’intérêt allié porté à l’opinion publique normande et française. Sur de nombreux sujets (les bombardements, le ravitaillement, ici la politique), la population sera interrogée afin de sonder l’état d’esprit du moment. Deuxièmement, la référence au général Giraud est révélatrice des envies alliées. Roosevelt, considérant de Gaulle comme un apprenti dictateur, s’efforce de placer en première ligne un dirigeant, qu’il trouve en la personne de Giraud. Conseillé, Giraud, se résout à rencontrer de Gaulle et ils forment ensemble le Comité français de la libération nationale le 30 mai 1943. Très vite il s’efface au profit de son homologue avant de démissionner de son poste de commandant en chef des troupes françaises d’Afrique du Nord. Il nous faut tout de même noter qu’à la date du questionnement de Louis Pesnel (le 20 juin 1944), de Gaulle a d’ores et déjà installé en Normandie (depuis sa visite du 14 juin 1944) un commissariat général de la République, avec à sa tête François Coulet. Le devenir de de Gaulle ne laisse plus de doute.
- 24. Bas-côté de la route, en patois normand, d’après le Dictionnaire du français régional de Basse-Normandie de René Lepelley.
- 25. Terme péjoratif utilisé pour désigner les soldats allemands.
- 26. Cette tentative d’assassinat intervient le 20 juillet 1944. Fomentée par des membres de l’entourage d’Hitler, la tentative se solde par un échec, le Führer n’étant que très légèrement blessé. Bon nombre de témoins font référence à cet événement : le martèlement dans la presse et l’espoir d’une fin prochaine étant deux raisons explicatives de ce phénomène.
- 27. Embourbés dans une « guerre des haies », les stratèges américains entreprennent une opération afin de percer une brèche dans la ligne défensive allemande. Cette opération, qui débute le 25 juillet 1944, a comme nom de code « Cobra ». Avant cette attaque, les Alliés procèdent à la stratégie habituelle du tapis de bombes.
- 28. Regroupés à Rancoudray, les Allemands lancent une contre-offensive le 7 août 1944 au matin, réunissant sept divisions dont quatre Panzer. Cette opération, dite « Lüttich » (« Liège »), a comme objectif de percer vers Avranches et ainsi de pouvoir couper en deux les lignes américaines qui poursuivent leur pénétration en direction de la Bretagne. Bénéficiant de l’effet de surprise et du brouillard, les Allemands parviennent à reprendre Mortain. Mais, quelques heures plus tard, le soleil ayant eu raison du brouillard, les chasseurs bombardiers alliés entrent en action, causant de sérieux ravages dans les lignes allemandes. La tentative de contre-attaque allemande échoue grâce aussi à l’arrivée de renforts américains.
- 29. Survenue le 15 août 1944, l’opération Anvil, rebaptisée Dragoon, devait permettre aux Alliés de prendre pied sur la côte méridionale du pays afin de pousser vers le nord et opérer une jonction avec les troupes débarquées de Normandie. À l’instar de ce témoignage, ce débarquement allié est mentionné dans les écrits normands, certes de façon très brève.
- Numéro: TE364
- Lieu: Mémorial de Caen