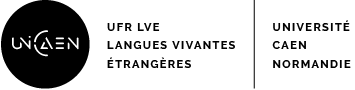La guerre du facteur de Cetica
Avertissement
Quand j’ai commencé à interviewer mon oncle Gilberto Giannotti, ou peut-être devrais-je dire à bavarder avec lui, je n’avais pas d’idée précise quant au nombre de choses qu’il me raconterait et j’ignorais combien de faits, plus ou moins importants, il me révélerait. C’était au début du mois de janvier 1998, il était tout d’abord quelque peu réticent à l’idée de parler devant un micro mais il s’y est peu à peu habitué, et il advenait même, si certains soirs j’étais en retard, qu’il téléphone pour me réclamer, pressé qu’il était de raconter. Et c’est ainsi que tous les soirs nous passions quelques heures ensemble : lui, il parlait, et moi, j’écoutais, enregistrant tout. Il y avait toujours avec nous sa sœur Gabriella qui intervenait de temps en temps pour approuver ce que Gilberto racontait, pour ajouter quelque chose ou encore pour dire « non, ça non, il vaudrait mieux ne pas le dire », mais elle était immédiatement réduite au silence : il voulait toujours tout me raconter, même si certains faits étaient un peu dérangeants ou délicats. Sept ou huit mois sont passés de cette façon, mois pendant lesquels j’ai recueilli beaucoup d’évocations et de souvenirs de mon oncle. Après cette première étape, j’ai commencé à retranscrire tout ce qu’il m’avait dit, et, jour après jour, en relisant le tout, Gilberto avait toujours quelque chose à commenter, à corriger ou à ajouter car de nouveaux détails et de nouveaux souvenirs lui revenaient perpétuellement à l’esprit. Nous avons avancé ainsi jusqu’au 7 août 1999, jour qui précéda sa mort 1 Né à Strada in Casentino le 17 février 1916, Gilberto Giannotti est donc mort dans son village natal le 8 août 1999. et je me rappelle que ses derniers récits concernaient Don Giovanni Bozzo. Je suis sûr d’une chose : Gilberto n’avait de ressentiments pour personne et les longues conversations que nous avons eues m’ont convaincu qu’il a voulu se souvenir et parler de ces événements pas uniquement pour revivre et retracer avec moi le voyage de sa vie, mais également parce qu’il voulait que la mémoire de ces faits et le souvenir de sa famille, de ses amis, de ses connaissances et même de ses adversaires d’antan ne s’évanouisse pas, reste toujours parmi nous, dans nos esprits et nos cœurs.
Le texte publié ici est extrait de la partie centrale du livre Mi ricordo che… de Gilberto Giannotti2 G. Giannotti, Mi ricordo che… Memorie, storie, lettere di Gilberto Giannotti, sous la direction de G. Ronconi, Castel San Niccolò (AR), Edizioni Fruska − Gianni Ronconi, 2001 (publiée en un nombre limité d’exemplaires, cette édition est désormais épuisée)., partie qui évoque en particulier la période de la Seconde Guerre mondiale. Les souvenirs, racontés par mon oncle dans le parler toscan de son village et fidèlement retranscrits dans le livre susnommé, ont été en revanche italianisés dans cette nouvelle édition, afin de pouvoir être lus par tous et être également plus facilement traduits en français et en allemand.
La guerre éclate3La première fois que Gilberto a fait son service militaire, il est resté dix mois à Pérouse dans l’infanterie, du début du mois de mars jusqu’à la fin décembre 1938, où il travaillait comme dactylographe. En mai 1940, il a été mobilisé comme téléphoniste et planton, destination Arezzo, tout d’abord dans la caserne Piave, puis au District où il est resté jusqu’en mars 1942, date à laquelle il a été libéré pour la seconde fois. En juillet 1943, il a été de nouveau rappelé mais après le 8 septembre il est retourné chez lui.
Le 10 juin 1940 la guerre éclata. Je me souviens parfaitement que c’était un lundi parce qu’il y avait le marché à Strada. J’avais eu une permission le samedi d’avant et j’étais sur le point de rentrer à Arezzo. Il était déjà presque midi, j’étais sur la place à attendre de pouvoir monter dans le minibus de Francioni, pour aller à Porrena puis pour rentrer à la caserne, au moment où Mussolini a commencé son discours dans lequel il annonçait aux Italiens que l’Italie entrait en guerre. Francioni4 Francioni était le propriétaire de l’entreprise qui assurait le service des bus, c’est-à-dire de transports de personnes, de Strada in Casentino jusqu’à Porrena, où Gilberto pouvait prendre le train qui l’emmenait à Arezzo. avait alors un minibus très petit, on y montait à l’aide d’une petite marche, et je me tenais là, prêt à mettre un pied dessus, quand au même moment j’entendis depuis la radio Mussolini qui disait : « Peuple italien, prends les armes… » Là-bas, devant la mairie, il y avait naturellement tous les fascistes de Strada avec leurs chefs qui écoutaient à la radio le discours du Duce, ces fanatiques exaltés, tous en faveur de l’entrée en guerre. C’est alors que moi, avec un pied sur la marche du minibus, je leur dis : « Alors, qu’est-ce que vous attendez ! Moi j’y vais, vous voyez, j’obéis à Mussolini et vous vous restez là ? Il vous a appelé et vous ne venez pas ? » Sur quoi, je monte à l’intérieur. Écoute bien, juste là, à côté, il y avait beaucoup de fascistes, parmi eux un épicier de Strada – un qui, au moment opportun, a retourné si vite sa veste que lors des derniers mois de la guerre son fils était partisan, et c’est sans doute mieux que je n’ajoute rien d’autre – et l’épicier rétorqua : « Écoutez-le, lui, il dit toujours la même chose ! Il n’y a vraiment rien à faire avec celui-là ! » S’ils avaient pu, ils m’auraient frappé. Mais Francioni, lui, démarra et partit.
Comme je l’ai appris par la suite, ce jour-là, Cameo de Casanini, un homme grand, cria d’une voix forte à un certain moment, après le discours de Mussolini, seul et au milieu de tous ces gens fous de joie à l’annonce de l’entrée en guerre : « À bas la guerre. » Tous ces fascistes ne l’ont bien sûr pas bien pris et auraient voulu le passer à tabac, en bons fanatiques et arrogants qu’ils étaient, mais, comme il y avait trop de monde à ce moment-là, ils n’ont rien fait. J’ai aussi appris que, le soir même, deux ou trois personnes sont allées chez lui pour le menacer, pour lui faire ravaler ce qu’il avait dit, mais ils n’ont rien pu faire, il est resté fidèle à ses idées.
Mussolini déclara à l’entrée en guerre : « J’ai besoin d’un mort pour pouvoir m’asseoir à la table des négociations, pour être à la table des vainqueurs et pour le partage de l’Europe. » Mais en vérité il n’y eut pas un seul mort, ni même trois ou quatre. Notre commune donna très tôt beaucoup de morts dans ces guerres fascistes. En effet, le premier mort de la guerre d’Afrique, en 1935, venait de Valgianni, c’était un bersaglier. Et le premier mort de la guerre en Albanie, en avril 1939 s’appelait Giuseppe Ghedini, le pharmacien d’ici, de Strada, qui avait été appelé au combat. La guerre n’avait pas encore été déclarée, mais quand il est parti de Bari pour une mission, son avion s’est écrasé, sans doute à cause d’une manœuvre ratée. Nous avons été les premiers à l’apprendre à Strada, Corrado Landi et moi, puisque le soir où le télégramme du ministère est arrivé avec l’annonce de sa mort, nous étions dans le bureau de poste, parce qu’ils nous avaient donné l’ordre de rester au télégraphe pour être prêts immédiatement si des nouvelles de la guerre arrivaient. Quand la dépouille arriva à Strada, il y eut des funérailles solennelles avec toutes les autorités et, si je ne me trompe pas, il me semble qu’Italo Balbo lui aussi est intervenu.
Une autre personne importante qui est venue à Strada pendant le fascisme, c’est Starace. Le secrétaire du Parti national fasciste. Et à propos de ça, il y a quelque chose de drôle à raconter. Quand Starace est arrivé à Arezzo, les fascistes l’ont soulevé pour le porter en triomphe. Ce qu’il y a d’étrange c’est que, au lieu d’être content, il ne voulait pas et il s’est mis à hurler : « Reposez-moi, reposez-moi ! criait-il. – Non, non, disaient-ils en continuant de le porter. – Non, non, reposez-moi, je ne veux pas, insistait-il. – Non, non. Je vous ai dit de me reposer. Vous m’avez écrasé une couille. » À ce moment-là, ils l’ont posé et lui, il dit : « Je vous avais dit de me poser. Vous m’avez pris par une couille5 En italien nous avons l ’ expression vulgaire « Mi avete preso per un coglione » qui joue sur l ’ ambiguïté du sens : prendre quelqu ’ un pour/par un couillon [NdT]. ! » Et ils disaient tous : « Non, non. Ce n’est pas vrai. – C’est vrai je vous dis, c’est vrai, vous m’avez pris par une couille. » Tout ça c’est passé à Arezzo. Je ne me souviens plus s’il a été porté en triomphe à Strada mais peut-être que non.
Une lettre de Federica
Pendant toute la période où j’étais à Arezzo, à la maison ils n’ont rien fait d’autre que de m’écrire : papa, Annina, Aurora, Giannetto, même Federica6 Annina était la tante de Gilberto et vivait avec lui. Giannetto, Aurora et Federica étaient les frère et sœurs de Gilberto. L’oncle Gigi vivait également avec eux. Gilberto avait une autre sœur, Leda, et bien sûr sa mère, Lisa., qui était alors à l’école primaire, et ce même si je rentrais presque tous les samedis, avec ou sans permission :
11 octobre 1940, Année XVIII, je t’envoie ce petit carnet en même temps que mon souvenir affectueux et sincère. Lis-le attentivement, il a été spécialement fait pour vous qui combattez pour notre Italie. Tu le liras, n’est-ce pas ? Bravo ! Je suis toujours près de toi avec le cœur et je désire tellement pouvoir vite te serrer dans mes bras. Quelle joie cela serait si tu pouvais rentrer après avoir rapporté une grande victoire ! Je prie toujours pour ça et particulièrement pour que la Madone veille sur toi et te protège. Toi n’oublie pas non plus de t’en remettre à Dieu, et prends garde de ne pas l’offenser par le péché. Plein de baisers de ta petite sœur.
Federica a écrit cette petite lettre quand elle était en CM2. Par cette lettre, on voit clairement ce que l’on disait aux enfants à l’école, ce qu’on leur suggérait d’écrire. En primaire tout particulièrement, les institutrices faisaient toutes de la propagande pour le fascisme, et peut-être que pour certaines il n’y avait pas d’autre choix, si elles voulaient continuer à enseigner. C’était un perpétuel lavage de cerveau pour pousser les enfants à penser ce qui était le mieux, selon eux. Mais à la chute du fascisme, il y a eu des sanctions contre ces institutrices et, en effet, on a empêché quelques-unes d’entre elles d’enseigner pendant un certain temps. Ces sanctions ont également été appliquées contre tous ceux qui s’étaient donné beaucoup de mal, comme quelque « squadrista »7 Le « squadrista » est un membre violent d ’ un groupe de choc fasciste [NdT]. ou quelque fanatique exalté. Que veux-tu, on a subi tant et tant de choses que l’on ne pouvait certainement pas toutes les laisser passer, comme ça, comme si de rien n’était. Puis, peu à peu, les choses ont changé et tout est rentré dans l’ordre, aussi parce que l’amnistie a été déclarée. Et en effet, même ces institutrices de Strada sont retournées enseigner. Et tu sais qui l’a déclarée, cette amnistie ? Togliatti !
Le fait que cette lettre ait été inspirée et contrôlée par l’institutrice, tu peux aussi le voir à la façon dont on lui a fait écrire la date, Année XVIII de l’ère fasciste. Je ne l’ai jamais écrite ainsi et je suis sûr que chez nous personne ne l’a jamais écrite de cette façon. On voit qu’à l’école ils avaient fait un petit carnet à envoyer aux soldats, mais sois certain que cela devait être une exaltation du fascisme et de la guerre. Et puis, réfléchis, en étant à Arezzo, comment je pouvais me battre pour la victoire ?
La visite à Sangallo et le début de la contrebande
Cela faisait déjà quelque temps que je cherchais un moyen d’être libéré quand, enfin, vers le mois de février 1942, j’y suis parvenu. C’est arrivé lorsque j’ai passé la visite médicale pour mes dents, qui étaient toutes cariées depuis un bon moment à cause de la pyorrhée, cela s’est passé à Florence, à l’hôpital Sangallo. Une fois sorti de Sangallo, ce jour-là je suis resté à Florence et comme il a commencé à faire un froid de canard, je suis allé au magasin de Freschi pour me réchauffer et, là-bas, j’ai rencontré Chiarini.8 Freschi était un camionneur qui, chaque jour, transportait des marchandises du Casentino à Florence et vice-versa. Puis, le soir même, j’ai pris le train pour Arezzo. Le lendemain matin j’ai obtenu ma libération et je suis retourné chez moi.
De ce jour-là et jusqu’à ce qu’ils me rappellent, on a tous essayé de se débrouiller du mieux possible comme le faisaient bien évidemment toutes les autres familles. Mais il y avait peu de marchandises en tout genre en circulation et c’est ainsi que la contrebande a commencé. En effet, pour emmener presque tous les produits d’une province à une autre, il fallait une autorisation, à Arezzo on devait la demander à la Sepral, un bureau de la préfecture. Ces autorisations concernaient presque tout et il me semble que seuls les fruits et les légumes en étaient exclus. En plus, il y avait les personnes chargées de contrôler que les marchandises qui n’avaient pas eu l’autorisation ne soient pas transportées en contrebande. À Strada, ceux qui contrôlaient étaient surtout Rino et Gegio Ferretti9 Ils s’appelaient tous les deux Ferretti mais n’étaient pas de la même famille., deux malheureux qui n’étaient pas méchants, même s’ils étaient fascistes. Et avec Gegio, nous étions amis depuis longtemps : si tu savais le nombre de champignons que mon père a achetés chez lui ! Tous les deux surveillaient tout particulièrement le camion de Freschi, parce qu’il faisait toujours des allers-retours vers Florence et, pour ceux qui voyageaient tout le temps, c’était beaucoup plus facile de trouver des vivres à emmener sous le manteau. Et moi aussi, quand je revenais de Florence avec le camion de Freschi, après avoir livré ce qui avait été convenu avec nos clients, par exemple des pommes et des champignons, j’essayais toujours d’emporter quelque chose. Qui sait combien de choses ont été transportées là-dedans et emmenées en contrebande ! En effet, on faisait de la contrebande pour toutes les marchandises qu’on ne trouvait pas, puisqu’elles étaient rationnées, comme le cuir, l’huile, le café, le vin, le pétrole et bien d’autres. Nous, à cette période, on avait un entrepôt au Piazzone10 Le Piazzone est une place de Strada in Casentino tandis que la Giovannina était le nom d’un bar., et on avait l’habitude, en revenant de Florence, de passer d’abord devant le bar de Giovannina puis de décharger, vite fait bien fait, de sorte à faire repartir le plus vite possible Freschi pour Bibbiena.
Une fois, nous avons appris, avant d’arriver à Strada, que Rino et Gegio nous attendaient au bar de la Giovannina. J’avais des marchandises, mais peu. Qu’est-ce que l’on a fait ? Au lieu de passer devant le bar puis de décharger, cette fois on s’est arrêtés d’abord au Piazzone et on a déchargé, très rapidement. Puis Freschi est passé devant le bar de la Giovannina et est reparti pour Bibbiena. Rino et Gegio l’avaient à peine vu qu’ils le suivirent, persuadés qu’il allait décharger, comme il le faisait d’habitude. Ils ne l’avaient d’abord pas vu, parce que, à cette époque, l’éclairage était interdit et on devait voyager les phares couverts d’un rideau ou d’un drap. J’ai attendu que le camion repasse en bas puis, avec calme et en faisant semblant de rien, je me suis dirigé vers la maison. Dès qu’ils me virent, Rino et Gegio comprirent tout de suite comment les choses s’étaient déroulées : « Regarde qui est là. Et le camion ? Peut-être qu’ils nous ont eus », dit l’un des deux, mais ils ne bougèrent pas et ne me dirent rien. Je suis resté silencieux, comme si de rien n’était, et je suis rentré chez moi. Gegio et Rino contrôlaient tout, même la « Sita »11 La « Sita » était le transport public reliant le Casentino à Florence.. Et si parfois ils trouvaient, dans quelque panier ou sac, des produits qui n’étaient pas en règle, sois certain que personne ne disait que cela lui appartenait, et ils n’en trouvaient jamais le propriétaire.
25 juillet 1943
L’ingénieur Spreafico résidait dans une villa, là-haut, au-dessus du bourg. Depuis quelque temps déjà, je lui apportais des produits de l’épicerie, à vélo ou avec le chariot, qui était d’ailleurs très fatigant à pousser le long de cette montée. Trois ou quatre femmes travaillaient comme domestiques dans cette villa, et cet ingénieur devait avoir été un grand ponte de l’armement mais, comme il me l’avait fait comprendre, il ne soutenait pas Mussolini.
Ce jour-là, le 25 juillet 1943, c’était un dimanche, j’arrive et il me dit : « Tu as entendu la radio ce matin ? » Je dis : « Non, je suis sorti rapidement de chez moi et je suis resté dans l’épicerie jusqu’à maintenant. Pourquoi, y a-t-il du nouveau ? » Je voyais bien qu’il ne savait pas quoi faire et puis, quand il n’y eut plus personne aux alentours, il me dit : « Il y a du nouveau, ce soir à onze heures, on annoncera la chute de Mussolini. » Tu comprends, lui, il le savait déjà. Cela prouve qu’il avait des contacts haut placés, sinon comment aurait-il pu le savoir ? Quand je suis retourné à Strada, je ne me souviens plus très bien avec qui j’ai passé la matinée, mais j’ai rencontré Bagnoli et je lui ai dit : « Il y a du nouveau. Mussolini est tombé et ils l’annonceront ce soir à onze heures. » Et lui : « Et tu la sors d’où, celle-là ? Si personne ne le sait, comment pourrais-tu le savoir ? » « Je l’ai entendu quelque part et si je te le dis ça veut dire que celui qui me l’a dit existe. » Bien sûr, on ne pouvait pas répandre bruyamment la nouvelle mais l’après-midi, après que je les ai avertis au sujet de Mussolini, Cicalino, Bruno de Marco et moi on est allés faire la fête au Pizzico, chez Lisa. En rentrant chez nous, on n’arrêtait pas de chanter une chanson dont malheureusement je ne me souviens pas très bien des paroles :
Descendez du trône, lâches
Déposez vos drapeaux
Le soleil de l’avenir se lève
puis il me semble qu’elle faisait comme ça :
Les seigneurs qui ne font rien
Nous ont promis un lendemain
Et un lendemain nous attendons encore…
Le soir même, comme tous les dimanches, il y avait le cinéma et, quand les gens ont commencé à sortir, vers onze heures, ils étaient tous bouche bée d’avoir entendu à la radio que Mussolini était tombé. Il a été arrêté peu de temps après, je ne me rappelle pas quand précisément, et a été transporté, prisonnier, dans les Abruzzes, à Campo Imperatore. C’est là que les Allemands, avec un commando et un avion, sont intervenus pour le libérer, afin de le mettre à la tête de la République de Salò, pour lui faire faire encore plus de dégâts qu’il n’en avait déjà faits. Au moment de sa chute, certains fascistes ont vraiment eu peur, à ce moment-là ils pensaient comme nous que le fascisme était fini. Mais ce sont surtout ceux qui n’étaient pas des fascistes purs et durs qui ont pris peur, ceux qui n’avaient jamais ennuyé personne. Je me souviens même d’avoir accompagné chez lui, dans la localité dite de Prato, l’un d’entre eux, apeuré et terrorisé que quelqu’un l’attende à l’Alberotorto. Mais j’y suis allé volontiers parce que c’était quelqu’un de gentil. Nous étions tous au septième ciel, les miens et moi, ainsi que tous les gens comme nous. Nous pensions vraiment qu’avec la chute de Mussolini le fascisme était fini pour de bon. Alors que le pire était encore à venir.
8 septembre 1943
La seconde fois que j’ai été appelé sous les drapeaux c’était en juillet 1943 et, quand je suis retourné au District, c’était pour me retrouver dans le même bureau où j’avais été pendant si longtemps. Mais cette fois, j’y suis resté peu de temps, seulement quelques mois, jusqu’au 10 septembre, deux jours après le sauve-qui-peut général, même celui du roi. Le 8 septembre 1943, tous à la maison. En effet, ce jour-là, le jour de l’armistice, le roi et Badoglio, qui avait été nommé chef du gouvernement à la place de Mussolini, pensèrent qu’il était préférable de se mettre à l’abri à Brindisi, là où étaient les Alliés, en se fichant complètement de l’Italie et des Italiens. L’armée se retrouva donc sans commandants, ainsi elle connut la débandade, puis la dissolution. Presque tout le monde s’échappa parce que l’important était désormais de se mettre en sécurité, loin des fascistes et des Allemands, alliés de l’Italie jusqu’au jour précédent.
Quand le sauve-qui-peut général a eu lieu, je ne suis pas parti tout de suite, mais je me suis échappé deux jours plus tard, le 10, puisque mon colonel, Chiaja, m’avait demandé d’attendre quelques jours puisqu’il voulait voir ce qui allait se passer. Mais le 10 septembre, les Allemands arrivèrent au District. Ils mirent une automitrailleuse à l’arrêt devant le portail, pour que personne ne puisse sortir, et ils entrèrent. Moi et d’autres de mes camarades, nous avons fui par une porte à l’arrière du District, mais pas le colonel Chiaja, attrapé puis emmené. Quand je suis revenu d’Allemagne, j’ai appris que lui aussi avait été déporté, d’abord en Allemagne puis en Pologne, d’où il est revenu après la guerre. Un jour, le maréchal des carabiniers de Strada me fit appeler puisque le colonel Chiaja lui avait demandé de mes nouvelles. Il pensait que j’avais été fait prisonnier moi aussi et il croyait que le 8 septembre, jour de sa capture, j’avais moi aussi été emmené puis déporté. Je suis allé le voir, à Arezzo, parce que je voulais le rencontrer moi aussi, savoir comment il allait, et je dois dire que nos retrouvailles ont été un moment particulièrement émouvant.
Donc, une fois sorti du District, je suis allé directement dans une installation de l’Enel12 Enel : Ente Nazionale per l ’ Energia Elettrica, entreprise italienne qui correspond à EDF en France [NdT]. , puisque je savais qu’Alfredo Aloigi y était en service. Je me suis ensuite mis en contact avec Landino Landi, qui était à Arezzo chez Severo Mugnaini, pour qu’il m’apporte des vêtements, je voulais m’habiller en civil pour ne pas être pris pas les Allemands. Il ne trouva pas mieux que de m’envoyer un costume de Severo, la veste et le pantalon. Mais comme j’étais petit et maigre et Severo grand et gros, on pouvait en mettre dix comme moi dans le costume, je ne l’ai donc pas mis et je suis parti, habillé toujours en militaire. Je suis parti pour le Casentino avec d’autres, Vito et Zavani, un de La Spezia, ceux avec qui j’étais toujours au District. D’abord à pied, le long du chemin de fer, jusqu’à Giovi, puis là nous avons pris le train pour retourner au Casentino.
La Todt
Mussolini, après avoir été libéré par les Allemands à Campo Imperatore, se réfugia en Italie du Nord sous leur protection et c’est là que, après quelques temps, il créa la République de Salò. C’est pour ça que les fascistes ont diffusé un avis disant que tous les Italiens nés entre 1898 et 1926 devaient se présenter à la milice fasciste13 La milice était une sorte de police fasciste qui fut introduite dans toutes les municipalités. Celui qui faisait partie de cette milice était chargé de la surveillance et du contrôle des citoyens, et plus particulièrement des antifascistes. pour être enrôlés. Mais comme beaucoup ne se présentaient pas, ceux de la milice allaient chercher ceux qui auraient dû se présenter, pour les enrôler de force. Et qu’ont-ils fait pour ne pas se présenter ? Ils sont allés travailler pour la Todt, à Vetrignesi. La Todt était une organisation de travail allemande et c’est à elle qu’avait été confiée la construction de la Ligne gothique. C’était encore elle qui construisait les plates-formes, les tranchées, les fortifications, les fossés antichars, et tout ce qui servirait à combattre les Américains et à les arrêter dans leur avancée, puisque les Allemands étaient persuadés que les Alliés passeraient de ce côté. Et ils payaient également, pour faire en sorte que les gens aillent travailler, mais la majeure partie n’en avait que faire d’être payée, parce que l’important était d’échapper à l’enrôlement obligatoire pour la République de Salò. On était tellement nombreux là-haut, presque tous ceux qui, selon les fascistes, devaient partir pour Salò, la « Repubblichina »14 Diminutif qui a, dans ce cas précis, une valeur dépréciative. On appelle « repubblichini » tous les fascistes de la République de Salò [NdT].. C’est là-haut que l’on a appris ce que les Allemands avaient fait à Vallucciole,15 Le 13 avril 1944 eut lieu, à Vallucciole, localité située dans la commune voisine de Stia, un véritable massacre nazi-fasciste durant lequel furent tués, sans aucune pitié, 108 civils parmi lesquels des femmes, des personnes âgées et des enfants, certains n’ayant que quelques mois. mais pas uniquement les Allemands, parce qu’il y avait certainement parmi eux ceux de la milice fasciste. Après deux ou trois mois passés avec la Todt, on a décidé de retourner à Strada. D’une part, on avait un peu peur qu’ils finissent par nous emmener et d’autre part, on avait tous été terrorisés par ce qu’ils avaient fait à Vallucciole.
Après notre retour à Strada, il me semble que c’était un lundi, une femme de Bibbiena est arrivée – elle a été par la suite assassinée par les résistants – disant que tous ceux qui voulaient être payés pour leur travail à la Todt devaient se présenter à elle à la mairie. C’était sûrement une excuse pour nous reprendre et nous emmener. Mais il me semble qu’ils se volatilisèrent presque tous et que pas même un ne se présenta, ni pour encaisser, ni pour travailler de nouveau à la Todt.
Don Giovanni Bozzo
Les Allemands sont restés ici de façon permanente et pour un bon bout de temps. Pendant toute cette période, ils ont commis beaucoup de méfaits, c’était vraiment une époque terrifiante, on était toujours en danger. Jour après jour, ils essayaient d’attraper quelqu’un pour l’emmener ou d’embêter les femmes, presque toutes restées seules. Et heureusement qu’il y avait un prêtre parmi les salésiens16 Les salésiens, congrégation religieuse fondée par San Giovanni Bosco, installée à Strada dans un grand immeuble appelé par tous « Il Collegio », le pensionnat, étant donné que, avec les prêtres, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui y résidaient comme pensionnaires. Mais le pensionnat était également fréquenté par la majorité des habitants de Strada pour des motifs religieux, des activités scolaires ou récréatives., Don Giovanni Bozzo, qui est intervenu plusieurs fois pour aider la population, sinon imagine comment les choses auraient pu empirer et combien ils auraient pu en tuer. Ce prêtre parlait allemand, c’était le seul dans les environs à parler cette langue, il était toujours en train de discuter avec les commandants allemands, pour les convaincre de laisser les paysans tranquilles et c’est ainsi qu’il est parvenu à bien aider la population. Bien sûr sa connaissance de la langue allemande lui facilitait les choses, mais tout dépendait aussi de son aptitude, on voyait qu’il savait très bien quoi dire et comment le dire.
Il est intervenu chaque fois qu’il le fallait et il a réussi à empêcher de nombreuses représailles. Quand les résistants ont tué un Allemand, au pont du Rio, il est intervenu pour faire relâcher beaucoup de personnes, des jeunes hommes ou des hommes, qui avaient été attrapés et qui auraient probablement connu une triste fin, sans doute fusillés en guise de représailles. Il s’est vraiment donné beaucoup de mal, toujours, chaque fois que c’était nécessaire, au risque même de se mettre en danger, il ne pouvait bien sûr pas savoir comment les Allemands réagiraient à ses demandes perpétuelles de laisser la population en paix. Mais pas même lui n’a réussi à faire quoi que ce soit pour éviter ce qui s’est passé à Cetica.
Renato del Codino se souvient parfaitement comment il a été sauvé, il me l’a raconté plusieurs fois. Il devait avoir dix-huit ou dix-neuf ans et il était tombé malade, je crois que c’était la pleurite. Un jour les Allemands ont fait irruption chez lui tandis qu’il n’y avait que sa mère, Maria, avec lui. Ils voulaient l’emmener puisqu’ils l’accusaient d’être un résistant et toute opposition aurait été sans doute inutile. Ils étaient entrés dans sa chambre et l’avaient déjà mis debout quand, posé sur la table de nuit, ils aperçurent un billet écrit en allemand. Ils l’avaient à peine lu qu’ils le laissèrent tomber et s’en allèrent en courant. Sais-tu ce qui était écrit sur ce billet ? Il était écrit que Renato avait une maladie infectieuse et ne devait avoir de contact avec personne. Et qui est-ce qui l’avait écrit ? Don Bozzo ! Il avait mis au point ce stratagème au cas où les Allemands auraient fait irruption chez lui. Tu vois un peu l’idée qu’il avait eue. Et il n’avait rien dit à Renato ni à sa mère : il avait fait tout ça de son propre chef. Demande-le-lui, à Renato, si tout ça n’est pas vrai ! Tu vois un peu l’homme que c’était !
Il s’est donné tant de mal, il était toujours en train de se déplacer à droite, à gauche, pour aider quiconque était en danger, sa soutane était toujours en mouvement, et pour sûr il en a sauvé des vies. Et c’est justement pour cela que je n’ai jamais compris pourquoi, une fois la guerre finie, le village l’a oublié, pourquoi personne ne s’en est souvenu comme il se doit. Je me trompe ?
Giuseppe Farina
Quand je travaillais pour la Todt, les fascistes n’allaient presque plus ni à Cetica ni dans la montagne à cause des résistants mais ces derniers ont fini par attraper Farina et par le fusiller. Giuseppe Farina avait été maire de Strada et il me semble qu’il venait du Mugello. Avant de venir à Strada il était maréchal mais, quand ces faits se sont produits, je crois qu’il était retraité du grade de lieutenant. Les résistants, ou quelqu’un qui était d’accord avec eux, lui volèrent son uniforme de lieutenant, son sabre et même le trousseau de sa fille. Puis ils envoyèrent quelqu’un lui dire que s’il voulait revoir ses affaires, il devait aller les chercher au pont de Pagliericcio. Et cet imbécile y est allé. Tandis qu’il montait, il rencontra sur le chemin, peu avant Rifiglio, oncle Gigi qui revenait de porter le courrier à Valgianni.
Farina lui dit : « Oh ! Gigi, venez, venez avec moi, vous me tiendrez compagnie. Il doit y avoir les résistants qui m’attendent au pont de Pagliericcio. » Et Gigi : « Mais qu’est-ce que vous allez faire là-bas ? » Et Farina : « Ils m’ont pris mon uniforme et le trousseau de ma fille et ils m’ont dit qu’ils allaient me les rendre. » « Mais, n’y allez pas, repartez avec moi. Faites-moi confiance, n’allez pas au rendez-vous, rentrez chez vous, ce sera mieux. N’allez pas chercher les ennuis », insistait Gigi. Et l’autre : « Il faut que j’y aille, ils m’ont dit qu’ils allaient tout me rendre, ils me l’ont promis. » Il n’y eut rien à faire, Gigi ne réussit pas à le convaincre et Farina alla au pont. Les résistants l’attrapèrent, l’emmenèrent et le fusillèrent dans la sapinière de Cetica, celle qui se trouve le long de la route de Badia. C’était le 28 juin 1944 et je m’en souviens bien puisque le lendemain il y a eu le massacre de Cetica. Et ce jour-là, ces mêmes résistants ont également voulu emmener mon père. Il était allé comme d’habitude à Cetica porter le courrier quand les résistants qui venaient d’attraper Farina sont arrivés à Cetica pour poursuivre vers la Badia, ils sont passés à l’endroit où était mon père à ce moment-là. Quand il les a vus monter avec Farina, il a tout de suite compris qu’ils allaient le fusiller et il a donc essayé de le faire relâcher : « Les gars, qu’est-ce que vous faites ? À quoi ça va vous mener de le prendre ? Mais laissez-le partir, il n’a rien fait de mal. – Vous, taisez-vous, de quoi vous vous mêlez », lui répondirent-ils. Et mon père insistait : « Mais laissez-le, c’est un pauvre bougre qui n’a jamais fait de mal à personne. Laissez-le partir. » Mon père avait raison. Farina était un exalté mais il n’était pas méchant ! Mais après un moment les résistants, vu que mon père insistait tant, ont fini par en avoir également après lui et ils lui dirent : « Si tu insistes tellement, ça veut dire que tu es comme lui. On va faire quelque chose, on va t’emmener toi aussi. Viens avec nous qu’on te règle ton compte à toi aussi » et ils le mirent en joue.
Heureusement qu’Altero était avec mon père, parce que s’il n’avait pas été là, qui sait comment cela aurait fini. Quand il vit que les résistants voulaient emmener mon père, il intervint tout de suite : « Mais qu’est-ce que vous faites ? Vous êtes devenus fous ? Laissez-le, qu’est-ce qui vous passe par la tête ? Il vous dérange ? Il est en train de distribuer le courrier et c’est un antifasciste, un pur et dur. » Heureusement qu’ils ont été raisonnables et qu’ils ont donné raison à Altero. Tout le monde le connaissait à Cetica, il était maréchal ferrant, et ils le connaissaient sûrement eux aussi. Tellement qu’ils se sont laissé convaincre et ont laissé partir mon père.
Représailles
Après chaque attaque des résistants ou même après une seule fusillade, les Allemands, en guise de représailles, ont commencé à faire des rafles et à brûler les maisons. Et même si c’était toujours les résistants qui tiraient, les Allemands se vengeaient toujours sur ceux qui n’avaient rien fait. Comme la fois où les résistants ont tiré sur les Allemands depuis Capezzi, puis, quand ces derniers ont répliqué, ils se sont enfuis. Quand les Allemands sont montés, il n’y avait plus personne et heureusement bien sûr, parce que s’ils avaient trouvé quelqu’un, ils lui auraient tiré dessus sans aucun doute, mais, pour se venger, ils ont tout brûlé. Toutefois, lors de leur réplique, les Allemands avaient blessé Stella, et la grosse erreur a été de l’emmener à l’hôpital de Poppi. Il y avait les Allemands là-bas et, quand ils ont découvert qu’il avait été blessé par une de leurs armes, ils l’ont emmené à Campaldino, près du fleuve Arno, et l’ont fusillé avec d’autres résistants. Comme je te l’ai déjà dit, en guise de représailles, les Allemands avaient aussi raflé des hommes, qu’ensuite Don Bozzo a heureusement réussi à faire libérer.
Moi aussi une fois j’ai failli faire un attentat à côté de Strada, au pont du Rio, où il y avait toujours une automitrailleuse allemande de stationnée. Un soir on est partis, moi, Cicalino et d’autres de Strada, avec deux ou trois grenades, on est allés jusque là-bas et on s’est cachés sous le petit pont. On voulait tirer dessus, on voulait faire quelque chose. Mais finalement on n’a rien fait puisque Lisa, la mère de Clara, nous implora de rester tranquilles, elle avait peur qu’ils brûlent sa maison, là-bas, au Pizzico. On lui a fait confiance et on n’a rien fait, mais finalement sa maison était destinée à être brûlée parce que, après quelques jours, les Allemands lui ont mis le feu en représailles de la mort d’un de leurs soldats, tué justement à côté du pont du Rio. Et même dans la localité du Prato, où les résistants avaient tiré sur un side-car, les Allemands ont brûlé quelques maisons.
Mais c’est à Pratarutoli et à Cetica que les Allemands ont commis les représailles les plus atroces et terrifiantes qui soient, le 29 juin, justement le jour de la fête de saint Pierre et de saint Paul. La veille, les résistants avaient assassiné Farina mais, même si cela a été un motif de plus pour justifier ce qu’ils ont fait après, les Allemands et les fascistes ont organisé ce massacre pour se venger de quelques attaques des résistants. Ces derniers, quelques jours auparavant, avaient tué deux Allemands au pont du Rio, deux Allemands qui portaient, semble-t-il, la Croix rouge au bras. Ces représailles ont été une chose effrayante et pendant ces quelques jours les Allemands, mais selon moi les fascistes aussi étaient avec eux, ont tué un grand nombre de personnes. Ils ont commencé à Pagliericcio, où ils ont tué un Grifoni, qui n’était pas rentré chez lui à temps. Puis, le long de la route, ils ont tué les Municchi, un garçon de quinze ans et son père, et à Pratarutoli cinq autres personnes. Là-bas, ils ont également commencé à mettre le feu aux maisons. Ils sont ensuite arrivés à Cetica, où ils en ont tué beaucoup, certainement plus d’une dizaine. Parmi eux, deux ou trois étaient de Cetica, et heureusement que presque tous les habitants s’étaient déjà enfuis, avertis par le bruit des premiers coups de feu de Pagliericcio et de Pratarutoli, tandis que ceux qui avaient été tués étaient des résistants qui avaient essayé de se défendre. Ils ont ensuite commencé à tout faire sauter et brûler, à détruire beaucoup de maisons, mais celles des fascistes, même s’il n’y en avait pas beaucoup à Cetica, ils n’y ont pas touché. Et d’après toi, comment auraient-ils fait pour savoir quelles maisons appartenaient ou non aux fascistes, si les fascistes du coin ne les avaient pas accompagnés ? Le soir du même jour, quand les fascistes sont retournés vers Strada, les résistants les ont attaqués à côté du pont de Pagliericcio et en ont tué quelques-uns.
Le lendemain, ma mère est allée à pied à Cetica pour avoir des nouvelles de mon frère, Giannetto, parce qu’on savait qu’il était avec les résistants dans le Pratomagno. Elle a appris là-haut qu’il n’était pas à Cetica, mais quand elle est redescendue, ses cheveux étaient devenus tout blancs, terrorisée qu’elle était par les scènes terrifiantes qu’elle avait vues. Les jours suivants, les Allemands, avant de partir vers le nord, ont brûlé et miné des tas de maisons à Prato, à Rifiglio, à Pagliericcio et dans tant d’autres endroits, partout ils ont continué à tuer des gens, beaucoup de gens, que des innocents, comme à Montemignaio. Et au fur et à mesure qu’ils partaient, ils ont miné et détruit tous les ponts. Il me semble que seul l’ancien pont de Cetica est resté debout dans les environs.
Bombardement à Casa Patriarca17 Maisons séparées par une route et proches de la rivière Solano.
Quand le bombardement a Casa Patriarca a eu lieu, le 25 juillet 1944, Don Bozzo a été parmi les premiers à se précipiter là-bas et peu après, même Alfredo, ton père, est arrivé. Au moment où les bombes sont arrivées, il allait à Garliano en passant de ce côté-ci du fleuve, en empruntant un sentier à travers les bois, et quand il vit ce qui était arrivé, il traversa tout de suite la rivière pour aller porter secours. C’était un bombardement américain et il devait toucher la maison de Sabatini, celle qui se trouve à côté de la rivière Solano, parce que s’y trouvait un commando allemand de SS : on voit bien que quelqu’un avait informé les Américains. Les bombardiers se sont trompés et seulement quelques bombes, parmi celles qu’ils ont lancées, sont tombées sur la maison visée, on en a même retrouvé une grosse qui n’avait pas explosé dans la rivière, mais ces bombes ont surtout atterri sur une autre maison, celle de Giovanni Folli, qui se trouvait de l’autre côté de la route. Bien sûr, personne ne s’y attendait, sinon ils auraient pu descendre dans la cave, qui aurait certainement résisté, mais ils n’y sont pas allés ou trop tard. À cause de ce bombardement, deux enfants Folli sont morts, Cécilia et son petit frère Pietro, ainsi que la bonne et son fils. Giovanni Folli est resté mutilé de la main tandis que sa mère, Luisa, et sa tante, Antonietta, s’en sont sorties indemnes.
Déporté
Le 6 août 1944, c’était un dimanche, les Allemands nous ont emmenés. Ils avaient fait une affiche sur laquelle il était écrit que tous les hommes entre 18 et 60 ans devaient se présenter pour, comme ils disaient, aller travailler mais en réalité, et c’est ce qui se passa, c’était pour aller en Allemagne. Nous, ceux qui devaient se présenter, nous ne savions pas quoi faire et nous étions nombreux à aller voir Giulio Luzzi, qui était intouchable à cause de son âge, pour avoir un conseil.
Ce dimanche là, je suis allé chez lui moi aussi mais il me fit signe de ne pas entrer parce qu’il recevait du monde. Je lui indiquai d’un signe de tête que je voulais mettre mon vélo là-haut, dans la soupente, chez lui, et il comprit qu’en plus du vélo, je voulais m’y cacher moi aussi : il me dit oui d’un signe de tête. J’ai vraiment agi comme un imbécile puisque j’ai laissé le vélo là-haut, mais moi je ne suis pas resté, alors que si j’y étais resté ce jour-là, ils ne m’auraient pas trouvé. J’étais toujours là, à attendre de pouvoir parler avec Giulio, quand Saul est arrivé du Piazzone et m’a dit : « Oh ! Gilberto, les Allemands veulent qu’on se présente, qu’est-ce qu’on fait, on se présente ou pas ? » On devait se présenter dans un lieu appelé Ferrea, où les Allemands avaient fabriqué un enclos pour mettre ceux qu’ils attrapaient. Et comme deux parfaits imbéciles, on y est finalement allés, ils nous ont pris et ils nous ont emmenés !
Ici à Strada, les Allemands nous ont attrapés en nombre, peut-être 150, et ils nous ont tous enfermés dans cet enclos avec les autres, ceux qu’ils avaient attrapés la veille à Garliano, à Cetica, à Pagliericcio et dans d’autres endroits. Ils s’étaient positionnés tôt le matin et avaient posté une automitrailleuse cachée au Collegino et une autre à Casaricciolino. Tous ceux qui arrivaient au village, ils les faisaient d’abord entrer, puis ils les attrapaient et les emmenaient là-bas, à l’enclos. Même ceux qui étaient allés à la première messe, celle de six heures et demie, quand ils étaient entrés dans l’église ils ne s’étaient aperçus de rien, puis, en sortant, ils avaient été attrapés et mis dans l’enclos.
Puis, comme l’a écrit Cesario dans son journal : « Départ de Strada avec l’illusion d’un travail provisoire dans les environs de Stia »18 Cesario Ceruti était un ami de Gilberto et a été ramené en Allemagne avec tous les autres. De sa capture jusqu’au moment où il trouva refuge dans un camp de l’armée américaine, Cesario nota ce qui se passait dans un petit journal. Les événements décrits, qui occupent seulement 28 pages de son livret, coïncident avec ceux du récit fait par Gilberto. Le journal appartient désormais à Gianni Ronconi. À partir de maintenant nous indiquerons ce texte dans les notes de bas de page avec la mention en italique, Journal, suivie de la page citée., certains en camion et d’autres à pied, ils nous ont tous emmenés à Porrena, dans la cave de Pietro Vettori19 Pietro Vettori est un gros producteur de vin de la vallée [NdT]. . Et Cicalino ? Lui, il a vraiment été stupide. Il avait réussi à s’échapper et à retourner chez lui mais, comme il a perdu beaucoup de temps à étreindre et à embrasser sa femme, il a été vu et s’est fait reprendre par les Allemands qui l’ont ramené à Porrena. Après quelques heures, ils nous ont mis dans les camions et on a entamé le voyage, dans la direction de Pratovecchio et Stia. Quand on est passés par Pratovecchio, quelques-uns ont sauté des camions et se sont mélangés à la foule pour ne pas être retrouvés mais ils ne furent pas nombreux, tant la peur de se faire tirer dessus était forte.
Quand on a commencé à monter vers le col de la Calla20 Ce col relie la Toscane à l ’ Emilie-Romagne. C ’ est l ’ une des voies d ’ accès au Nord de l ’ Italie [NdT]. , certains ont pensé que l’on pouvait essayer de s’échapper dans l’un de ces virages mais, quand on a commencé à en parler entre nous, d’autres ont commencé à crier et à s’opposer, en disant que les Allemands tireraient sur nos familles et tueraient ceux qui étaient restés à la maison. Dans le camion où j’étais, il y avait un Allemand, un seul, assis sur un tabouret près du bord. L’un d’entre nous a proposé : « Au prochain virage, on l’assomme et on s’échappe tous. » Il aurait suffi de le pousser, il serait sûrement tombé du camion et on aurait pu s’échapper comme on voulait. Je me souviens que, parmi les plus acharnés à vouloir essayer, il y avait Nello Ferrantini et Fiocco. Ils auraient fait des pieds et des mains si les autres avaient été d’accord. Mais les plus âgés s’opposaient, ils avaient peur des conséquences : « Non, non, arrêtez-vous. On ne peut rien faire. Si on essaye, ils iront à Strada et ils brûleront toutes les maisons. » Les autres, ceux qui voulaient essayer de s’échapper, répliquaient : « On peut essayer, en plus ils ne sauront pas d’où on vient, on est tellement nombreux. » En effet, ils nous avaient attrapés à Poppi, à Stia, à Bibbiena, à Ortignano, dans tous les coins du Casentino. Parmi ceux qui s’opposaient radicalement, il y avait trois pères et leurs fils : Emilio Paggetti et son fils Aldo, Guido Francioni et son fils Mauro ainsi que Buzzino et son fils Silvano. Ils s’opposaient tous parce qu’ils avaient peur que quelque chose de pire arrive. Finalement le soldat allemand, avec tous ces chuchotements, s’aperçut que quelque chose se tramait, il se mit debout et commença à hurler, en pointant son fusil vers nous, et le plus drôle, c’est que c’était lui qui avait peur de nous. Lui avec son fusil, nous sans, lui il avait plus peur que nous, mais c’est justement pour ça que nous sommes restés tranquilles, en effet il pouvait faire partir un coup. C’est donc pour ça qu’on n’a rien fait et qu’on n’a pas essayé de s’échapper.
Après, on est arrivés à Forli et là, beaucoup ont réussi à rentrer chez eux, mais ça a été possible seulement parce qu’un sergent de Bibbiena, on ne sait pas comment il a fait, les a pris et les a envoyés travailler pour la Todt au col des Mandrioli. Bien sûr, ils travailleraient toujours pour les Allemands mais c’était une chose d’aller travailler là-haut sur la montagne et une autre d’aller en Allemagne. Et parmi eux, quelques-uns, dont Ovidio Francioni, Assuero Colozzi, Cicalino, Danilo Grifagni et d’autres, se sont échappés pendant le voyage et sont retournés chez eux. En revanche, nous qui étions restés, nous avons continué, et toujours à l’intérieur des camions allemands, nous avons commencé le voyage vers le nord. On est arrivés à Bologne et, tandis qu’on passait dans la ville, on a vu que beaucoup de gens se promenaient dans les rues. On s’est alors mis à leur crier pour les mettre en garde : « Fuyez, fuyez tant que vous pouvez encore, cachez-vous. S’ils vous attrapent, ils vous emmènent. » Mais ils ne réagissaient pas, ils continuaient à se promener comme si de rien n’était, peut-être qu’ils n’y croyaient pas. Qui sait ce qui est arrivé à un grand nombre d’entre eux, mais je peux me l’imaginer, vu que ceux qu’ils ont réussi à attraper venaient des quatre coins de l’Italie.
Le 10 août, avec les camions, on est arrivés à Vérone, où ils nous ont fait descendre pour nous envoyer dans une école qui avait un double escalier. Tandis que l’on montait sur le premier, d’autres personnes descendaient du deuxième et parmi elles il y avait aussi Altero, le frère de Bubbone. Je l’ai appelé, sans même l’avoir vu. Et lui, alors qu’il descendait, me dit : « Mais comment as-tu fait pour savoir que c’était moi ? – Comment j’ai fait ? Je t’ai entendu chanter. » Il chantait toujours. Même si les choses allaient mal, et à ce moment-là elles allaient vraiment mal, Altero chantait, chantait toujours, il avait cette habitude invétérée de chanter. Sois certain que j’aurais reconnu sa voix entre mille et, en effet, quand je l’ai entendu chanter, je l’ai reconnu tout de suite et je l’ai appelé. Et lui : « Gilberto, Gilberto, ils nous emmènent travailler, ils ont dit qu’ils nous emmenaient travailler. » Mais on sentait qu’il n’y croyait pas. Lui, Altero, ils l’ont emmené en Autriche. À Vérone, ils nous ont mis dans un train qui allait vers Venise, où il a fait une halte. Comme ils avaient pris tous nos papiers, ils nous ont même fait descendre. Ils étaient sûrs que l’on ne se serait pas échappés, sans papiers Dieu sait où l’on aurait pu aller. Et avec un carabinier pour nous surveiller, nous sommes allés faire un petit tour dans Venise. Après, ils nous ont emmenés à Trévise, et là, ils nous ont mis dans des wagons de marchandises. Et quand ils nous ont mis dans ces wagons, on a tous compris que notre destination était désormais l’Allemagne. Nous sommes arrivés à Villach21 Petite ville du Sud de l ’ Autriche [NdT]. le 12 août, et de là, ils nous ont emmenés à Cologne.
Camp de captivité
Depuis Cologne nous avons remonté le Rhin, toujours en train, alors que tous les autres avaient été envoyés dans différentes zones de l’Allemagne. Ceux qui ont remonté le Rhin ont peut-être eu plus de chance que les autres, même si ensuite beaucoup d’entre eux sont allés travailler avec les paysans. Au contraire Sandro Lorenzoni, Tito Focacci, Natalone ont été envoyés dans un camp où la vie était mauvaise et la nourriture encore pire, quand il y en avait. On ne leur donnait rien et ils étaient vraiment aux travaux forcés, ils leur faisaient faire quatorze, quinze heures de travail par jour. Sandro m’a toujours dit que c’était un lieu effrayant, et que tous les matins ils en trouvaient un mort de faim, d’épuisement ou de maladie. Je me souviens de ce qu’il m’a raconté une fois. Lui et d’autres déportés étaient en train de travailler sur un toit et ils ont vu quelqu’un enterrer un chien mort. Écoute un peu, dès qu’ils ont pu descendre, ils ont filé à toute vitesse le déterrer ! Ensuite ils l’ont emmené au camp, ou quelque part ailleurs, ils ont trouvé une grande marmite ou quelque chose du genre, l’ont mis à bouillir trois ou quatre jours et puis ils l’ont mangé. Tu vois un peu comme ils étaient affamés ! La majeure partie de ceux qui étaient dans le camp avec Sandro, et dans ceux pareils au sien, mourait de dysenterie, ils ne leur donnaient rien à manger, quelques rondelles de navet et un peu d’eau chaude. C’est là que sont morts le Gobbo de Bulletta et un certain Bargellini.
Le 19 août 1944 ils nous ont mis tous, moi, Cesario Ceruti, Niccolino Ceruti et Walter Donatelli, dans un camp, le camp 3 de Oppau, à Ludwigshafen, près d’une zone qui était pleine d’usines. Nous avons presque toujours été ensemble et nous étions aussi avec Guido Moretti au début, mais lui il est allé travailler loin de nous, et c’est pour ça qu’ensuite nous l’avons rarement croisé. Le 23 septembre notre travail dans l’usine Anilink Fabrik22 Le nom complet de cette usine de Ludwigshafen est « Ammoniaklaboratorium der Badischen Anilink-und Soda Fabrik », c ’ est-à-dire, mot à mot, Laboratoire d ’ ammoniaque de l ’ usine Anilink et soda du pays de Bade [NdT]. a commencé, usine dans laquelle, plus de 20 ans après, je suis revenu avec Francesco et Guido. Dans l’usine on travaillait un peu, mais on ne se tuait pas à la tâche parce que le travail n’était pas très fatigant. Et puis, comme en plus de nous, les déportés, il y avait de nombreux soldats prisonniers, les Allemands les faisaient travailler plus que nous. Quand nous sommes arrivés, le premier jour, ils nous ont mis dans des baraquements qui n’étaient pas trop mal. Il y avait l’eau chaude et l’eau froide, les conduites d’eau bouillante provenaient de l’usine, et il y avait même des douches et des lavabos. Dans le camp où nous étions, il n’y avait pas de barbelés mais une clôture en bois tout autour, de telle sorte que, si quelqu’un voulait vraiment s’échapper, il n’y avait pas de problème. Le problème c’était qu’on ne savait pas où aller et, en considérant en outre qu’on n’était pas si mal, personne ne s’échappait. Et puis ils nous payaient aussi, 50 marks par jour il me semble.
Le 30 août les bombardements ont commencé. Les bombardiers, qui étaient le plus souvent anglais, arrivaient presque toujours de nuit et, avant de bombarder, ils jetaient des feux de Bengale qui illuminaient tellement la zone qu’après on y voyait mieux qu’en ce moment avec cette lampe. Il y avait une telle lumière que l’on pouvait ramasser une aiguille. Mais, une des premières fois où ils sont venus, c’était pendant la journée et, à ce moment-là, on était en train de travailler dans l’usine. L’alarme a sonné et nous avons commencé à courir tous ensemble vers les refuges qui avaient été faits à l’intérieur, mais avant qu’on y arrive, à quelques mètres de nous, une grosse bombe est tombée. Et cette bombe n’a pas explosé, parce que si elle avait explosé, je ne serais certainement pas là pour te raconter cette histoire. On a vraiment été chanceux. C’était sans doute écrit dans notre destin que les bombes ne nous feraient rien, à moi et à ceux qui m’accompagnaient. À partir de ce moment-là, quand il y avait les bombardements, moi je ne fuyais plus comme avant, je restais presque tranquille. À tel point qu’une autre fois où l’alarme a sonné, je ne voulais pas aller dans le refuge, je voulais rester dans le baraquement où j’étais. Je ne voulais pas fuir, déjà parce que ça n’était pas un refuge contre les grosses bombes. Là, il y avait seulement des pare-éclats de ciment en forme d’arc, et les gens, même s’ils entraient dessous, pouvaient être à l’abri des petites bombes, mais certainement pas de celles qui pesaient cinq quintaux. C’est pourquoi je pensais qu’il était totalement inutile que je coure là-dessous. Et puis les bombes ne me faisaient rien à moi, elles n’explosaient pas. Cesario et les autres, au contraire, n’arrêtaient pas de m’appeler. Je n’y allais pas et ils continuaient de m’appeler : « Dépêche-toi, dépêche-toi, écoute, ils commencent à bombarder… » À la fin je me suis décidé, j’ai couru à l’endroit où ils étaient et je me suis jeté dedans. À cet instant, une bombe a éclaté, tellement proche que le déplacement de l’air m’a jeté contre eux. L’alarme a cessé, on est sortis et le baraquement où j’étais juste avant n’était plus là. C’était vraiment clair qu’il était écrit quelque part que les bombes ne pouvaient rien contre moi.
Le gros problème qui est apparu ensuite était que de temps en temps les soldats arrivaient et emportaient quelqu’un qui souvent ne revenait pas. Un soir ils ont pris aussi Niccolino et Walter et les ont emmenés. On les a emmenés travailler dehors, au Arbeitsfront23 En Allemagne, en 1933, les syndicats sont interdits et remplacés par le Front allemand du travail (Deutsche Arbeitsfront, DAF) [NdT]. , creuser des trous et des fossés antichars, tout ça parce que les Américains étaient désormais proches et les Allemands faisaient travailler tous ceux qu’ils réussissaient à retirer des camps. La peur d’être pris et emmené d’un moment à l’autre devenait de plus en plus grande et il fallait à tout prix trouver un moyen pour être plus tranquille. Heureusement je l’ai trouvé.
Dans mon usine, l’Anilink Fabrik, j’avais un chef chimiste qui s’appelait Gofman. C’était une brave personne et aussi un antinazi, je pense, sinon il n’aurait certainement pas pu se comporter de cette façon. Je me rappelle même encore que celui-ci, quand il allait prendre à manger pour lui, dans des plateaux porte-dîner où ils lui donnaient aussi de la viande, lui me disait, après en avoir mangé un peu : « Tiens, manges-en un peu toi aussi. » Mais la nourriture n’était pas notre problème, du moins les premiers temps, même si ce qu’ils nous donnaient nous suffisait à peine. Nous travaillions toute la semaine, et le samedi les patrons de l’usine nous délivraient un document. Cette feuille, où il était écrit que nous avions travaillé, nous la présentions au bureau préposé et ils nous donnaient des coupons qui nous servaient pour prendre à manger pour toute la semaine. Si on ne présentait pas ces coupons jour après jour, ils ne nous donnaient rien.
Gofman me rendait tellement de services que moi je cherchais à lui en rendre quelques-uns. Il avait une balance comme celle des pharmaciens, un objet particulier et de précision fait à la lunette, et avec cette balance il pesait le nickel brut travaillé dans l’usine. On broyait doucement mais de plus en plus le nickel, au début il devenait comme du gravier, puis il devenait encore plus fin, jusqu’à être presque réduit en poudre et, à ce moment-là, Gofman en pesait une petite partie avec la balance. Un jour je lui ai dit que je pouvais faire une caisse pour la mettre dedans, pour mieux la transporter, pour être sûr qu’elle ne s’abîme pas quand il l’emportait avec lui. Il m’a fait un mot pour que je prenne du matériel dans un endroit près de l’usine et je la lui ai faite. C’était une belle petite caisse en bois, avec un manche au-dessus, pour qu’il la prenne et l’emmène avec lui chaque fois qu’il en avait besoin. Pour qu’on puisse mettre la balance dedans, j’avais aussi fait des petits crans dans lesquels elle entrait toute seule, elle y glissait vraiment bien. Après que je l’ai faite et que je la lui ai apportée, il n’arrêtait pas de me remercier : « Oh, gut, viel gut, danke schoen, viel danke schoen24 C ’ est-à-dire « Oh, gut, sehr gut, Danke schoen, vielen Dank. » Expression approximative signifiant « Bien, très bien, un grand merci, merci beaucoup » [NdT]. », heureux comme un roi. « Tu lui fais tous ces trucs, à cet Allemand », me disaient les autres. Ils ne voulaient pas comprendre qu’on pouvait vivre un peu mieux s’il nous aidait.
Et donc, pour revenir au discours de tout à l’heure, pour être plus tranquille, un jour je suis allé le voir et je lui ai dit : « Tous les soirs les soldats viennent là où on dort et ils emportent quelqu’un. Mais il n’y a pas un système pour qu’ils ne nous emportent pas ? Comment peut-on faire ? Ce n’est pas possible de trouver un moyen pour être plus en sécurité, plus tranquille ? » Et qu’a-t-il fait pour m’aider ? Il m’a fait le Sonderausweis25 Un laissez-passer [NdT]. c’est-à-dire un document, fait par le chef de l’usine, dans lequel il disait que j’étais indispensable pour son travail. C’était comme l’Ausweis, le livret qu’ils nous avaient fait quand on était arrivés, celui avec la photo et le numéro, le mien était le 929, comme on peut voir d’après ma photo. Mais moi, après l’avoir remercié, j’ai ajouté : « Je le prends volontiers, mais comment je fais avec mes camarades ? Si vous ne le faites pas aussi pour eux, je ne le veux pas non plus, je ne peux pas le prendre. Nous avons toujours été ensemble et je ne peux pas les laisser en danger, alors que moi je suis en sécurité. » Je pensais protéger aussi Cesario et les autres qui à ce moment-là ne travaillaient pas avec moi. Pour Cesario il me l’a fait, et il me l’aurait certainement fait aussi pour Niccolino et Walter, mais à ce moment-là ils n’étaient pas dans notre camp et il n’a pas pu le faire. Tu vois comme il était bon, ce Gofman ! Et elle nous a beaucoup servi, cette permission, parce que quand les soldats arrivaient, et je me rappelle qu’un soir sont venus aussi ceux de la Polizei, on leur faisait voir ce document et ils disaient : « Schlafen », ce qui veut dire « Allez dormir », et ils nous laissaient là où on était.
On essayait de s’en sortir le mieux possible, jour après jour, et on était toujours à la recherche de tout ce qui pouvait servir pour passer du mieux qu’on pouvait ces journées. J’avais même trouvé un peu de toile avec laquelle j’avais réussi à faire une sorte de sac à dos que j’emmenais toujours avec moi en le fermant avec une ficelle. Ensuite, à force de troc, j’ai aussi trouvé le moyen de me procurer trois couvertures pour dormir, et avec une autre couverture j’ai fait un pantalon. Quand ils nous avaient emmenés là, j’avais seulement un pantalon en toile, celui que j’avais sur moi quand les Allemands m’ont pris. J’ai pris pour modèle le pantalon que je portais, j’ai découpé comme j’ai pu cette couverture et puis j’ai cousu ensemble les deux côtés avec des fils d’alliage ou de cuivre. Il était vraiment moche ce pantalon, mais je le portais sous la salopette qu’ils nous avaient donnée, par conséquent il ne se voyait pas et je ne sentais pas beaucoup le froid. J’avais aussi de belles chaussures de montagne et, quand j’allais dormir dans les abris, je les enlevais, je les mettais sous ma tête comme un coussin, et je m’emmitouflais entièrement, avec ces couvertures. Et pourquoi je me faisais un coussin avec mes chaussures ? Pour ne pas me les faire faucher !
Walter ne s’en sortait pas mal non plus. Dès que la nourriture commençait à se faire rare, il allait toujours faire un tour pour en trouver et il allait en chercher en dehors de la zone industrielle, dans les villages les plus proches. Une fois, et ça s’est passé peu de jours avant Noël, il a apporté un sac de farine et on a fait des gnocchis avec des Würstel26 Les gnocchis, appelés aussi en Toscane « topini » (petites souris) à cause de leur forme dodue, sont un plat de résistance, un « primo », où les pommes de terre, cuites à l ’ eau et passées à la moulinette, sont mélangées avec beaucoup de farine, une pincée de sel et un œuf : la pâte est ensuite coupée en petits dés. Würstel, mot allemand qui désigne les saucisses de Francfort ou de Strasbourg [NdT]. . Après Noël, encore une fois, Walter et Niccolino ont été emmenés et Cesario a noté : « Le 26 le couple repart pour un nouvel Arbeitsfront et revient en cachette après avoir terminé sa provision de pain »27 Journal, p. 7.. Ils s’étaient échappés et le gros problème désormais était qu’ils étaient sans papiers, parce qu’au moment où on les avait emmenés, les Allemands les leur avaient confisqués. À partir de ce moment-là ils ont toujours dû faire très attention de ne pas se faire démasquer, de toujours se cacher dès que quelqu’un arrivait. Non seulement ils n’avaient pas de papiers, mais ils n’avaient pas non plus ce Sonderausweis, ce document qu’on avait Cesario et moi, et pour eux il y avait toujours la peur d’être emmenés par quelque soldat. Et à partir de ce moment-là, par conséquent, le plus gros problème est devenu la nourriture :
Des jours encore plus tristes commencent, nous avons deux cartes d’alimentation et nous sommes quatre à manger... mais grâce à une bonne idée de Gilberto nous arrivons à améliorer cette situation. Le commerce des biscuits allemands commence, achetés à Mannheim pour un prix dérisoire et revendus dans les punkers avec un bénéfice assez considérable 28 Ibidem. Punker, avec transcription erronée de l’initiale du mot : bunker..
Et un soir, seul Niccolino est revenu d’un de ces voyages à Mannheim en nous disant que Walter avait voulu rester pour voir s’il faisait des bons achats, c’est du moins ce qu’il avait dit à Niccolino. Mais à partir de ce jour-là nous n’avons plus eu de nouvelles de Walter et je l’ai revu seulement après la fin de la guerre. Et l’argent, l’argent était toujours utile. Une fois j’ai acheté chez un Allemand qui travaillait avec nous un kilo de pain pour mille marks, qui à cette époque valaient environ mille lires. Je suis resté toute la journée sans manger, je n’ai pas coupé le pain en tranches pour pouvoir l’emmener entier à Cesario et Niccolino, tout beau et intact, et le manger avec eux. Après quelques jours j’ai pris un autre pain d’un kilo toujours chez le même Allemand. Mais cette fois, passé deux ou trois jours, celui-ci est revenu et m’a dit : « Il faut que tu me rendes ce pain que je t’ai donné. » Je lui ai répondu : « Te le rendre ? Personne ne l’a. On a déjà tout mangé, moi et mes camarades. » Jusqu’à ce moment-là, je croyais qu’il trouvait où l’acheter, vu qu’il nous le vendait si volontiers, mais en vérité, pour l’acheter et nous le revendre, il se servait de ses tickets. À la fin il n’avait plus de tickets et de pain non plus. Eux aussi ils obtenaient tout par carte, et pire que nous !
Pendant ces tristes journées, Cesario a écrit ces paroles très belles et touchantes dans son journal :
Les jours passent encore plus tristes, les problèmes à résoudre restent irrésolus. La nourriture, le coucher, tout ce qu’il faut pour qu’un homme se restaure, se repose, n’existe pas pour nous. Le soir approche, et avec le soir, la nuit, et avec la nuit le problème du coucher, où dormir ? Polizei, eau, bombardements sont les trois choses qui empêchent la résolution d’un problème pourtant facile. Nous cherchons, nous demandons, le sommeil est supérieur à la peur, nous décidons de dormir sur un carton par terre, une misérable couverture sur nous est l’essentiel pour pouvoir dormir. Nous fermons les yeux, mille pensées envahissent notre esprit, prédominante parmi celles-ci la pensée de maman, nous voyons notre enfance, toutes les minutes de notre vie passent devant nos yeux comme dans un film, en silence nous nous adonnons aux jours heureux, nous nous souvenons des jours enfantins, perçus avec une pointe d’amertume. Et au fur et à mesure, dans les pensées le présent se dessine, chers parents qui êtes à la maison, mamans [...]. Ça suffit, ça suffit, n’essayons pas de penser à tout ceci, nous sentons un nouveau mouvement dans l’estomac, nous éloignons ces pensées pour penser à quoi manger demain. Voilà, il faudrait aller voler un peu de pommes de terre. Les Polizei veulent te tirer dessus avec un fusil, ce n’est peut-être pas mieux de mourir d’un seul coup que de mourir aussi lentement ? Nous avons faim, si nous avions des pommes de terre, mais assaisonnées avec de l’huile, un peu de sel, comme quand vous les faisiez, vous les mamans ! Notre mère revient encore dans nos pensées, il faut à tout prix l’éloigner, on souffre trop. Tous les soirs nous nous endormons dans ce délire et le sommeil réparateur se transforme en un autre rêve de peur : des fascistes armés nous courent après, nous ne pouvons pas courir, ils tirent tellement de coups de feu, nous nous réveillons en sursaut, grand Dieu ils tirent vraiment ! Il faut fuir, une course folle dans la nuit illuminée par des détonations, des explosions, le souffle court, les jambes molles, et pourtant si nous réussissons à arriver [au bunker] nous pourrons un jour lointain revoir nos parents. Ne t’arrête pas, cours, le punker est à 200 mètres, courage ! Je n’en peux plus, allez, nous y arrivons. Deux ou trois heures passent, il nous reste une heure de sommeil avant l’aube, et ensuite, fatigués, épuisés, de nouveau au travail 29 Ibid., p. 13-21..
L’évasion
Les bombardements continuaient presque tous les jours et un après-midi ils ont touché l’usine où je travaillais ; par conséquent, en plus de détruire une partie de la construction, ils ont provoqué des incendies çà et là. Nous, on se réfugiait dans des abris qui se trouvaient un peu partout. Quand le bombardement était terminé, j’étais très inquiet parce que j’avais peur que mon nouveau sac à dos, que je n’avais pas eu le temps de prendre avec moi et qui contenait mes trois couvertures, ait été détruit ou soit resté dans les décombres. Une fois sorti de l’abri, je me suis mis à courir vers l’usine, mais Gofman aussi est sorti en courant de l’abri où il s’était mis et est arrivé avant moi dans le local où nous étions avant de fuir. Quand je suis arrivé il m’a vu désespéré mais, en souriant, totalement satisfait, il m’a fait : « Sois tranquille. Ne désespère pas puisque je te l’ai sorti moi, ton sac à dos, j’ai eu le temps de le prendre avant qu’il brûle. » Tu comprends ? Gofman savait à quel point ce sac était important pour moi et la première chose qu’il a faite, dès qu’il est arrivé, a été d’aller à l’intérieur le prendre et le sortir aussitôt. En fin de compte, pour lui, ce sac à dos ne représentait rien, mais il avait couru exprès pour me le sauver des flammes. C’était vraiment une personne comme il faut, il m’aimait vraiment bien et je me suis toujours souvenu de lui avec énormément de reconnaissance et d’affection.
Les bombardements pour détruire ces usines augmentaient de jour en jour, et on était bombardés jusqu’à quatre fois par jour. Les bombardiers arrivaient le matin à dix heures, ils revenaient à midi, puis l’après-midi vers quatre heures et le soir vers huit heures ou neuf heures. Je me souviens encore qu’on n’entendait jamais siffler les bombes des Anglais et elles nous atteignaient toujours. Au contraire, celles des Américains sifflaient à nous rendre fous, mais souvent elles tombaient loin de nous. Désormais notre résistance avait atteint ses limites. Et alors on a commencé à dire : « Ici on ne tient plus avec ces bombardements, il faut essayer de s’échapper, par n’importe quel moyen ! » Puis, en plus du problème de la nourriture, on ne trouvait presque plus où aller dormir. Étant donné que presque toutes ces usines avaient été bombardées et que désormais elles étaient très endommagées et dangereuses, qu’est-ce qui se passait ? Il se passait que dans le peu d’endroits encore à peu près sûrs, on était vraiment nombreux là-dedans, beaucoup trop, et les disputes et les altercations entre tous ces gens étaient désormais à l’ordre du jour. Et puis Niccolino était toujours sans papiers, il pouvait être pris d’un moment à l’autre et emmené. Et ainsi un jour, tous d’accord, on a pris la seule décision possible : « Il faut absolument essayer de nous échapper, le danger ici devient de plus en plus grand. Si nous ne partons pas, à la fin nous y resterons. »
Dans l’usine avec nous, il y avait un marocain qui, je me souviens, avait épousé une française. Il s’était fait une espèce de petit baraquement non loin de l’usine ; dedans, il avait mis une paillasse pour dormir et il s’était aussi construit tout seul une sorte de petit poêle. Quand finalement on a pris la décision définitive de s’échapper, on est allés chez lui et on a fait un échange : nous, on lui a donné les tickets pour manger, les rares tickets qu’on avait, et lui nous a fait dormir, pour une nuit, dans son petit baraquement. Tout ça parce qu’on voulait être hors de l’usine, pour pouvoir s’enfuir sans problèmes quand il faisait encore nuit, parce que s’échapper la nuit de l’usine pouvait être dangereux, on ne voulait pas que quelqu’un nous voie. Quand on a été prêts la veille au soir, on est allés dans ce petit baraquement pour y passer quelques heures, pour dormir et pour attendre le bon moment pour notre évasion. Il faisait un froid épouvantable, mais avec ce petit poêle on s’est un peu réchauffés et on n’était pas si mal. De plus j’avais toujours mes trois couvertures et, tous emmitouflés, on a réussi à dormir un peu.
Le matin de bonne heure, il faisait encore nuit noire, on rassemble tout et on part. Peu après, certainement cent, deux cents mètres plus loin, peut-être plus, je ne m’en souviens pas bien, on a trouvé un fleuve dont on ne connaissait même pas l’existence et comme on voyait que l’eau coulait dans un sens, on a raisonné ainsi : « Si l’eau va dans cette direction, la Suisse doit être de l’autre côté. Nous, on remonte par là et espérons qu’elle est proche. » On a marché toute la nuit, Cesario, Niccolino et moi, toute la nuit, toute la nuit, puis ça a commencé à s’éclaircir, et nous encore on marchait, on marchait, on marchait, et on marchait toujours en longeant le fleuve, en restant au milieu des arbres pour que personne ne nous voie, pour ne pas faire de mauvaises rencontres et... le matin on s’est retrouvés à la case départ ! Qui croirait qu’on a tourné toute la nuit comme trois parfaits imbéciles autour d’un lac, que l’on croyait être un fleuve ? On s’est aperçus de notre erreur seulement quand on a revu devant nous le petit baraquement où on avait passé la nuit. Et qu’est-ce qu’on a fait ? On est rentrés à l’usine et, comme personne ne s’était encore aperçu qu’on était partis, on a repris le travail, en faisant semblant de rien, mais avec la certitude qu’on serait repartis aussitôt. Désormais on ne reviendrait plus en arrière et on ne pouvait pas se laisser envahir par le découragement.
La famille Fertig
Comme Cesario l’a écrit dans son journal : « Nous sommes le dimanche 20 janvier 45. Il neige de plus belle. Départ 7 h »30 Journal, p. 7-8.. Le matin, lui et moi, on est sortis tranquillement de l’usine, par l’entrée, alors que Niccolino est sorti en enlevant quelques planches de la clôture. On savait déjà où aller, à Heidelberg, une petite ville au-dessus de Mannheim, où l’on savait qu’ils cherchaient des gens pour différents types de travaux. La première chose qu’on a faite a été de jeter tous les papiers qu’on avait. On a fait ça parce que, s’ils nous trouvaient avec le document de cette usine, ils nous reconduiraient certainement là-bas, alors que nous on voulait aller de l’autre côté, vers le Nord de l’Allemagne. J’ai gardé seulement la photo, celle avec le numéro 929, mais je l’ai bien cachée. Cesario a écrit : « 10 h arrivée à Mannheim. Un café amer acheté dans un bar sert de petit déjeuner. » Ensuite, on a attendu l’arrivée du train pour Heidelberg. Mais pour nous compliquer la tâche, vers le milieu de la matinée, il y a eu un bombardement qui a même interrompu la ligne ferroviaire et qui nous a contraints à passer la nuit à Mannheim, dans une maison de civils.
Le jour suivant, toujours sous la neige, on est repartis à pied vers Heidelberg et on devait traverser le pont sur le Rhin. Par chance, sur la route, on n’a jamais croisé personne qui nous ait demandé quoi que ce soit, jamais personne, pas même quand on a passé le pont sur le Rhin. Sur ce pont, il y avait de nombreuses sentinelles et nous, pour ne pas nous faire arrêter, quand on s’approchait de quelqu’un, on saluait à l’allemande : « Heil Hitler ». Eh bien, ça semble étrange, jamais personne ne nous a demandé nos papiers et on est arrivés à Heidelberg sans embûches. À peine arrivés, on est tout de suite allés dans un restaurant se faire une bonne bouffe, puis on s’est rendus à l’Airbeitsamt, l’agence pour l’emploi. Alors qu’on se trouvait là-bas, Cesario a entendu un employé de l’agence qui échangeait deux mots en français avec quelqu’un d’autre et comme il parlait bien la langue, il s’est mis à discuter avec lui. Celui-ci nous a demandé ce que l’on savait faire et nous, on lui a dit qu’on était des paysans. On lui a dit ça parce qu’on avait su qu’ils cherchaient des personnes à envoyer chez certaines familles de paysans pour les aider dans leur travail, parce que les hommes étaient tous au front. Et en effet, ils nous ont dit qu’ils nous enverraient à Laudenberg, près de Mosbach, où ils avaient justement un besoin urgent de paysans. Le plus drôle a été qu’au début, quand ils nous ont dit qu’il y avait une demande de « Schaeffer », qui en allemand voulait dire paysans31 Le mot signifie en fait « berger »., nous on a compris « chauffeur », à la française, et on allait refuser. Mais après, on a compris à temps qu’ils cherchaient bien des paysans et on a accepté. Alors, on a pris un train et on est allés à Mosbach. Puis, avec un autre petit train, on est allés vers Laudenberg, et là on s’est trompés ! Ce qui s’est passé, c’est que, au lieu de descendre à la gare de ce village, on n’est pas descendus parce qu’on ne s’est pas rendu compte qu’on était arrivés, et quand on s’en est aperçus le train était déjà reparti, même s’il n’avait pas encore repris de la vitesse. Alors qu’est-ce qu’on a fait ? On s’est jetés du train ! Heureusement qu’il allait encore doucement, et comme il était tombé tellement de neige qu’elle nous arrivait à la taille, ça ne nous a rien fait.
On a marché un peu dans la neige, puis à un certain moment on a vu une lumière et on s’en est approchés. C’était une maison de paysans. On leur a fait voir les feuilles qu’ils nous avaient données à l’agence pour l’emploi et ils nous ont fait entrer. Et à cette occasion aussi on a rencontré des gens bien. On leur a dit qu’on pouvait très bien dormir dans l’étable, mais le maître de maison, un vieux, a voulu à tout prix nous faire dormir dans la maison, mais avant tout il nous a préparé un copieux repas. Le matin, il nous a appelés de bonne heure parce que le train allait revenir et on devait aller à la gare pour le prendre et retourner à Laudenberg. Mais avant qu’on parte, il nous a préparé un bon petit-déjeuner ! On a pris le train et on est finalement arrivés à la gare de Laudenberg, où on a vu beaucoup de gens attendre. Nous nous demandions ce qu’ils faisaient là, et pour plaisanter, entre nous, on se disait : « Je parie qu’ils sont en train de nous attendre ! » Incroyable, mais c’était ça ! Ils nous attendaient avec anxiété parce qu’on leur avait annoncé notre arrivée et ils avaient un besoin urgent de nous pour les travaux des champs, étant donné que les hommes et les jeunes étaient tous partis au front. L’un d’eux, une personne âgée, peut-être le responsable, prend nos papiers et nous affecte, Cesario ici, Niccolino là, et moi, moi rien. « Mais ! Ça veut dire quoi, ça ? », je me suis dit à moi-même. « Et moi ? », j’ai demandé au chef. « Viens avec moi. » m’a-t-il dit. Et il m’a emmené dans sa maison, où lui aussi m’a fait prendre un petit-déjeuner. Peu après, une femme âgée est arrivée qui avait, je m’en souviens encore, un foulard sur la tête ; elle m’a pris et m’a emmené avec elle pas loin de là, dans sa maison. J’étais arrivé dans la famille à laquelle j’avais été affecté : les Fertig.
La famille Fertig était composée de Otto, le vieux, le chef de famille qui avait des moustaches longues comme ça, Elise sa femme, leur fille Maria, et puis il y avait une sœur d’Otto qui elle aussi s’appelait Maria. Des fils, ils en avaient quatre, ils étaient tous soldats. Avant toute chose ils voulaient me donner à manger, encore une fois, mais je leur ai dit que j’avais déjà mangé, même trop, j’avais déjà pris deux petits-déjeuners et je leur ai demandé juste un peu d’eau chaude pour me laver. Et c’est à ce moment-là qu’ils se sont aperçus que je n’étais pas paysan. Je me suis mis torse nu pour me laver et ils ont vu que j’étais tout blanc, en dessous. À tel point que le vieux a aussitôt dit : « Du nicht schaefer », ce qui signifiait que je n’étais pas paysan. Il y avait dans un coin des cartes postales ou des lettres, je ne me souviens pas exactement quoi ; en les indiquant, je lui ai dit que j’étais facteur et, par la suite, je lui ai dit que j’étais aussi commerçant. Puis, je lui ai demandé : « Arbeit ? », c’est-à-dire « au travail ? » Et ils m’ont répondu : « Morgen fünf Uhr», ce qui équivaut à « demain à cinq heures. » Je devais commencer à travailler le lendemain matin à cinq heures, mais à quatre heures j’étais déjà prêt.
Le 23 janvier 1945 notre travail de paysans a commencé. Niccolino est tombé sur une famille de trois femmes seules parce que le mari d’une d’entre elles avait été rappelé. Lui aussi était bien installé, tout comme moi, et là, dans cette maison, avec ces trois femmes, c’est lui qui commandait, elles travaillaient toutes les trois pour lui. Lui, il ne faisait que manger et boire. Le plus drôle, c’est que quand son mari est rentré tard, un soir, Niccolino était là et, en le voyant, l’Allemand a tout de suite mis les mains en l’air, il voulait même lui donner son fusil. Bref, il voulait se rendre. Tu te rends compte, un Allemand qui voulait se livrer à Niccolino ? Et pourtant, lui, il ne pensait qu’à manger, tout le reste ne l’intéressait pas, et il lui a répondu qu’il se fichait complètement de son fusil. Cet Allemand, qui était gardien dans un camp de prisonniers, s’était échappé et à partir de ce moment-là, il a toujours vécu caché, du moins le temps de notre présence. Et je pense vraiment qu’il est resté caché jusqu’à l’arrivée des Américains. Cesario était dans une autre famille et lui, en revanche, ne voulait pas y rester, il se plaignait toujours : « Moi je m’en vais, moi je m’en vais, je ne reste pas, ils n’arrêtent pas de ronchonner. » Il ne cessait de répéter : « Je ne veux plus rester. Ils me disent que je salis trop, que je rentre dans la maison en revenant de l’étable avec des chaussures sales et ils grognent sans arrêt. » Il faisait le même travail que nous, il était dans l’étable lui aussi, comme nous, comme Niccolino et moi. Et on le sait, dans l’étable les chaussures se salissent. Mais quand ils l’appelaient pour manger, il montait avec les chaussures toutes sales, pleines de fumier. Qu’est-ce que ça lui aurait coûté de faire un brin de toilette ? Mais il ne le faisait jamais, alors les autres avaient raison de grogner ! Moi j’avais des sabots, je les avais achetés, il ne pouvait pas s’en acheter lui aussi ? Presque tous ceux qui étaient là pour faire les paysans, il y en avait beaucoup, de tous les pays, dormaient dans les étables, comme Niccolino et Cesario. En revanche, moi je dormais dans une chambre, avec des draps, et quand je le disais autour de moi, même aux autres, aux Russes, aux Polonais, ceux que l’on trouvait le dimanche à flâner, personne n’y croyait. Tu vois un peu quel genre de famille c’était ! Quand je disais que j’étais chez les Fertig, tous les habitants du village disaient : « Ah, les Fertig, quelle famille, la meilleure ! » Là, chez eux, j’étais vraiment traité comme un pape, mais comme l’un de ces vieux papes, ceux qui autrefois se faisaient porter dans un fauteuil.
Le matin je me levais à cinq heures et la première chose que je faisais, c’était d’aller dans l’étable, pour nourrir les bêtes et enlever le fumier. Mais je devais faire attention à ne leur donner même pas un brin de paille sèche, parce que le pain coûtait moins cher que la paille, cette dernière étant rare, voire inexistante. En effet, avec les vaches et avec un chariot à quatre roues, un chariot avec des ridelles, on allait chercher les feuilles des plantes hivernales, on ratissait et on chargeait ce chariot pour en tapisser l’étable à la place de la vraie paille. Moi, je faisais ce que je pouvais et ils ne m’ont jamais fait faire de travaux lourds ou des travaux que je ne pouvais pas faire. Quant à traire, c’était les femmes qui trayaient. Au début ils m’ont demandé de traire, et même si je savais que je n’en étais pas capable j’ai essayé, mais je n’ai pas réussi et ils ne me l’ont plus demandé. Ils avaient treize vaches et toutes avaient un nom par lequel je devais les appeler, et Otto ne voulait pas que je les maltraite en leur disant des gros mots. Et il ne voulait pas que je leur donne certains ordres en italien. Il me disait : « Parce qu’après, quand tu t’en iras, qui réussira à les commander ? Si tu les habitues à entendre de l’italien, elles ne m’écouteront plus. »
Une fois, j’ai été sauvé par une vache. On travaillait dans les champs et en partant de l’un d’eux, je devais rentrer par la grand-route, à pied, en tenant une vache. Il y avait une très grande différence de niveau entre ces champs et la route et, à un certain moment, tandis que je marchais pour trouver l’endroit où descendre, en tenant une vache par la bride, j’ai perdu l’équilibre et j’ai commencé à glisser le long du bord du champ, vers la route. Cette vache a fait comme les vaches folles, celles que l’on voit à la télévision, elle a écarté ses quatre pattes, elle s’est plantée là pour m’empêcher de tomber sur la route. Après, je l’ai toujours nourrie en premier, Fanny, c’est ainsi que s’appelait cette vache.
Et puis ils avaient aussi des cochons. La sœur d’Otto, Maria, ne me faisait pas nettoyer les cochons, parce que c’était une chose pas propre et c’est elle qui les nettoyait une fois par semaine. Ils les gardaient dans l’étable et ils restaient toujours là, sans jamais sortir, parce qu’ils les faisaient devenir gras, très gras. Imagine un peu toute la saleté qu’il pouvait y avoir là dedans, mais par peur que je ne me salisse, ils ne m’ont jamais fait toucher un cochon, même pas une fois. J’essayais de faire du mieux possible chaque travail qu’ils me demandaient de faire, mais pas seulement : je leur ai fait aussi quelques petits travaux qui me passaient par la tête, surtout avec le bois. Ils avaient, là dans un coin, un beau morceau de noyer vieilli, et un jour j’en ai pris un petit bout, pour y tailler la poignée de la faux. Mais ce que je leur ai bien fait, vraiment bien, et qui leur a fait aussi très plaisir, c’était différents bacs pour les fleurs, ceux que l’on met aux fenêtres.
Le matin on se levait à cinq heures, et si à huit heures je n’avais pas fini de nourrir toutes les bêtes, Otto me disait, réglé comme une horloge : « Fertig, essen », « Il est huit heures, petit-déjeuner »32 Expression signifiant dans ce contexte : « C ’ est prêt, à table ! » [NdT]. . Parfois il m’arrivait de répondre : « Mais je dois encore terminer », et il disait : « Sie werden warten ! », « Elles attendront ! » Qu’importe ce qu’on était en train de faire, on arrêtait. À huit heures, on devait prendre le petit-déjeuner, et ils ne te faisaient jamais travailler quand il s’agissait de passer à table, qu’il soit huit heures, midi, quatre heures de l’après-midi pour le goûter ou le soir pour le dîner. Et la nourriture était toujours abondante, abondante et bonne. Au petit-déjeuner, il y avait toujours du café au lait, du pain, de la confiture et du beurre. Le midi, il y avait différentes sortes de saucisses et à boire du vin de pomme, du moût comme ils l’appelaient. Il était un peu léger, bien clair, mais quand je buvais un verre de ce vin, je sentais une grande chaleur dans les oreilles, et je ne comprenais pas pourquoi. Qui sait combien de degrés peut faire le vin de pomme ! Chez nous on fait du vinaigre avec les pommes, mais du vin jamais. Ils avaient aussi des petits tonneaux de ce moût, les mêmes que l’on a dans nos caves. Mais de temps en temps j’allais boire un peu de bière, quand on allait se promener avec Cesario et Niccolino, dans un café du village et c’est là que pour la première fois j’ai bu de la bière noire.
Au dîner, on mangeait souvent des tranches de pain, mais elles étaient préparées de façon étrange. D’abord, elles étaient ramollies longtemps dans de l’eau chaude et ensuite, on mettait du lait dessus. Et les pommes de terre cuites à l’eau ! Eux, ils les plongeaient dans du lait et moi, au contraire, je prenais du sel, je les salais et je les mangeais. On mangeait aussi des pommes de terre le midi et, d’une façon ou d’une autre, il y en avait tous les jours. Ils prenaient une grande marmite et ils en mettaient tellement à l’intérieur que ça faisait une coupole, de façon à ce que celles du dessus soient cuites par la vapeur : c’était celles-ci, celles-ci qu’on mangeait. Chacun en prenait autant qu’il voulait, on enlevait la peau et on la remettait sur les autres pommes de terre, parce que celles que l’on ne mangeait pas on les donnait aux cochons. Je n’ai jamais souffert de la faim, jamais. Dans cette maison, ils avaient du beurre, de la margarine, du pain et tellement d’autres choses à manger, tellement ! Ce que je mangeais, très bien, ce que je ne mangeais pas j’essayais toujours de le garder pour le lendemain et, tout doucement, je me suis fait comme une réserve. Ils recevaient du beurre, mais celui fait maison était vraiment meilleur et se faisait la nuit. Ils avaient un barillet avec un manche à l’extérieur et à l’intérieur. Il y avait deux ventilateurs qui, en remuant le lait continuellement, faisaient une boule de beurre, du beurre naturel, bon. Mais avant de le fabriquer, Otto Fertig sortait toujours de la maison et regardait bien autour, toujours, pour vérifier qu’il n’y avait personne, parce que c’était interdit de le faire.
Et nous voici arrivés au jour de notre nouveau départ, vers la libération définitive, en avril 1945 :
Le dimanche des Rameaux, nous allons à la messe comme les autres fois quand, en rentrant, nous rencontrons des réfugiés russes, italiens, français, qui nous parlent de la libération de Mannheim comme si elle s’était déjà produite. Il est trois heures, en ce jour du Vendredi saint, le village est orné de drapeaux blancs pour accueillir les libérateurs, dont l’arrivée est imminente ; notre joie, mélangée à de la peur, à cause de la Polizei allemande, est immense. Nous savons par plusieurs personnes que les Américains circulent déjà depuis trois jours sur une route qui se trouve à trois kilomètres de chez nous. 33 Journal, p. 10-11..
Je me suis toujours rappelé une chose, de ce jour de Pâques, en plus du fait que l’on a vu pour la première fois les Américains. Dans ma maison, ils avaient fait des œufs durs, colorés, et je me souviens encore comment ils procédaient pour les faire. Quand le moment arrivait de mettre les œufs dans la casserole remplie d’eau en ébullition pour les faire cuire, ils les plongeaient avec un papier feutre coloré, de façon à ce qu’ils deviennent de la couleur de ce papier. Je me souviens qu’ils en ont fait une douzaine par personne, chacun avait les siens, et ils m’en ont donné des verts.
Après le déjeuner de Pâques, l’après-midi, Cesario, Niccolino et moi sommes allés dans un village voisin, où on nous avait dit que les Américains passaient. Si on n’allait pas voir, on ne pouvait pas savoir si c’était vrai ou non, et en effet ils sont passés. Et c’est ainsi que Pâques 1945, exactement le 23 avril 1945, est devenu un des plus beaux jours de ma vie. Après avoir marché pendant environ trois kilomètres, on est arrivés à une bifurcation et c’est là qu’on a vu un char d’assaut, le premier char d’assaut américain, arrêté sur le bas-côté, avec un soldat assis dessus. À dire vrai, le comportement de ce soldat a été plutôt étrange. On lui a tout de suite demandé une cigarette pour chacun d’entre nous. Quand il a répondu, et nous l’a donnée, une chacun, on a compris qu’il était italien, même italo-américain, sicilien ou calabrais. Après lui avoir dit qu’on était italiens, on a commencé à lui poser question sur question, du genre : d’où il venait, comment se passait la guerre et d’autres choses. Pendant qu’on était là à parler, un autre soldat, qui était sorti du char d’assaut, lui a dit quelque chose à celui-là, deux mots en anglais, et il ne nous a plus parlé, même pas un mot. Il ne parlait plus italien, seulement américain. Qui sait ce qu’il lui a dit, va savoir, peut-être a-t-il eu peur qu’on soit des espions.
Après il s’est passé quelque chose de désagréable. Nous, à peine rentrés, on s’est allongés devant ma maison, la maison des Fertig, où il y avait une jolie pelouse, on s’y sentait vraiment bien. Otto, quand il m’a vu, allongé et pensif, m’a dit : « Comment ça va ? », « Kranken Zahn », je lui ai dit que j’avais mal aux dents34 Expression approximative signifiant « malade dents », c ’ est-à-dire « j ’ ai mal aux dents » [NdT]. , lui aussi savait que toutes mes dents étaient pourries. « Et tu restes assis dans l’herbe ? » m’a-t-il dit. « Ist egal », « c’est pareil », a dit Niccolino, ce crétin, et il a continué : « Morghenfrüh weggehen. » « De toutes façons demain on s’en va. » Oh, pauvre Otto ! Comme si quelqu’un lui avait tiré dessus. Et cet idiot poursuivait : « Eh, on a trouvé les Américains. On va avec eux, ils ont tout, des cigarettes, du chocolat... » Mon Dieu, quelle déception pour Otto ! Oh, qu’il était déçu ! Il ne s’y attendait pas, et même les femmes, qui étaient sorties, avaient entendu elles aussi, elles ont réagi comme lui, elles étaient déçues. Alors le vieux Fertig, tout sérieux, m’a regardé, avec un regard plein de reproches, il m’a regardé et il m’a dit : « Ah, les Américains ! Eux, oui, cigarettes et chocolat ! Moi, pas de cigarettes... pas de chocolat... », comme pour dire : « Parce que moi, ne t’ai-je pas toujours bien traité ? Je t’ai gardé dans ma maison, je t’ai donné une chambre, à manger autant que tu voulais. »
Moi j’aurais voulu rester encore, et si ça dépendait de moi, j’y serais sans aucun doute resté jusqu’à ce que les choses se soient arrangées. Ça me faisait de la peine pour eux de partir, pour Otto et sa famille, ils m’avaient toujours traité comme quelqu’un de la famille et eux aussi avaient du chagrin de me voir partir, mais qu’est-ce que je pouvais y faire ? Les autres, mais plus particulièrement Cesario, voulaient partir le plus tôt possible, on était toujours restés ensemble et on avait décidé de toujours rester ensemble, à n’importe quel prix. Et puis, à la fin, moi aussi j’étais curieux de voir ce que faisaient les Américains et comment se passaient réellement les choses. Mais, peut-être parce que j’étais encore indécis sur ce que je voulais faire, je disais à Cesario : « Ne pense pas que, si on part maintenant, les Américains affréteront un camion exprès pour nous et nous ramèneront chez nous. » Mais lui désormais : « Demain matin on part, on part, on ne reste plus ici. » Qui sait, peut-être que Niccolino aussi serait resté encore un peu de temps, mais Cesario maintenant était décidé à partir. Le lendemain, le lundi de Pâques, il a vu qu’on était tous les deux indécis et alors il nous a dit : « Si vous ne venez pas, peu importe, je pars tout seul. Faites comme vous voulez. » Alors on a dû partir. Ma famille m’a bien traité jusqu’au dernier moment, et même si ça leur faisait de la peine que je parte, ils m’ont donné plein de choses pour le voyage. J’étais chargé au point de rassasier aussi mes compagnons, des saucisses, du pain, à boire, et même les œufs colorés qu’ils avaient faits pour Pâques, alors qu’eux, Cesario et Niccolino, n’avaient rien. Et on est partis. Mais ensuite, on est resté plus d’un mois avec les Américains.
Après la guerre, ma famille, les Fertig, m’a écrit plusieurs fois, je leur avais donné l’adresse de Florence, du magasin de Freschi, situé via Giosuè Carducci, parce que je leur avais dit que j’étais de Florence. Quand ensuite je leur ai écrit une lettre de Strada, la première chose qu’ils m’ont demandée, quand ils m’ont répondu, a été si j’avais quitté Florence. Un Noël, juste après la guerre, je leur ai fait un colis de fêtes. J’ai fait un colis, en y mettant une lettre, juste une lettre, pas trois. En revanche, pour toutes les choses que j’ai envoyées, j’en ai mis trois de chaque, c’est-à-dire trois oranges, trois citrons, trois panforti35 Gâteau typique de Sienne, plat et rond, composé de fruits confits, d’amandes, de miel et d’épices [NdT]. , trois nougats, et sûrement d’autres choses, mais tout par trois, parce que les familles qui nous avaient hébergés étaient trois. En recevant ce colis, qui était adressé chez moi, chez les Fertig, ils ont compris tout de suite, sans que je leur aie rien expliqué. Ils ont pris pour eux une orange, un nougat, un panforte et ainsi de suite, et les autres morceaux ils les ont donnés aux deux autres familles, un chacun. Tu comprends ? Ils ont aussitôt partagé avec les deux autres familles : ils étaient vraiment précis, honnêtes, comme on n’en voit pas beaucoup ! J’aimerais bien savoir combien de personnes auraient fait la même chose, je suis sûr que certains auraient fait semblant de rien. Puis ils nous ont tous répondu, une lettre pour chacun, une pour moi, une pour Niccolino et une pour Cesario.
Quand j’y suis retourné, vingt ans plus tard, avec Guido et Francesco, malheureusement les trois vieux étaient morts, mais il y avait un frère de Maria, la fille de Otto. Mais lui ne me connaissait pas, parce qu’à l’époque il était militaire. J’avais une photo d’elle, une photo de quand elle avait dix-huit ans, je lui avais laissé une photo de moi habillé en militaire. Il m’a donné son adresse. Entre temps, elle s’était mariée dans un village éloigné de celui-ci, on y est aussitôt allés et on l’a trouvée. Elle était en train de récolter les pommes de terre et, quand elle m’a vu, son visage est devenu tout rouge, émue qu’elle était de me revoir, comme quand je suis arrivé dans sa maison la première fois. Elle était déjà grand-mère. Je les ai invités, elle, son mari et ses enfants, à venir en Italie, mais ils ne sont jamais venus. Je leur ai même rappelé, pour leur donner envie, Florence et Rimini, où ça commençait déjà à être plein d’Allemands pour les vacances. Et son mari nous a dit qu’il était allé à Rimini, pendant la guerre, en tant que militaire, et il l’a dit en faisant un geste. « Rimini ? » a-t-il dit, et il a indiqué avec son doigt sa poitrine et son dos, comme pour dire qu’à Rimini on lui avait tiré dessus aussi bien devant que derrière. En effet, pendant la guerre, il y avait les Alliés qui tiraient sur les Allemands par-devant et les résistants qui leur tiraient dessus par-derrière, on leur tirait dessus des deux côtés. Puis, ils ont téléphoné à un autre frère et, avant qu’on ne reparte de là, il est arrivé aussi. Mais ils ont voulu qu’avant de repartir on mange, là, chez eux, ils étaient toujours les mêmes, tels qu’était leur père. Puis, avant de repartir pour l’Italie, on est aussi allés voir les autres familles. Oh, avec eux aussi, quelle fête ! Ils ont couru à notre rencontre et ils voulaient avoir des nouvelles de Niccolino et de Cesario. Mais eux, ils n’y sont jamais retournés.
Avec les Américains
Toujours en chemin. Combien de kilomètres pour Mannheim ? Peut-être 70 kilomètres. De toute façon, on en a déjà fait 50, on doit persévérer. De belles routes. Et Niccolino : « Je suis fatigué, et comment ! » Gilberto nous arrête : « Ohé, il y a un wagen là ! » Quoi ? Où est-il ? Niccolino enthousiaste revient avec quelque chose qui nous sera très utile. On met les trois sacs dessus, un devant, deux derrière et on repart ! Nous sommes dans une montée, on avance beaucoup mieux qu’avec le sac sur l’épaule. La descente commence, le wagen avance bien, je veux essayer de monter dessus, et... tu crois que je veux y aller à pied !!! Et alors le wagen part à toute vitesse sur les belles routes goudronnées entourées d’immenses forêts de sapins, des rires et des chants le long de la grande descente se mélangent au bruit des chars d’assaut américains qui passent, et chaque personne rit de notre trouvaille en nous saluant. De nouveau des plaines, des montées, des descentes défilent sous les rapides roues de notre wagen et même les kilomètres diminuent toujours plus jusqu’à ce qu’on arrive au but tant rêvé. Nous traversons des villages, de grandes villes qui montrent les signes des récents bombardements et du passage du front encore plus récent. Des Russes, des Polonais, des Français, tous les représentants de toutes les nations européennes nous dépassent, nous les dépassons, en lambeaux, fatigués, épuisés et pourtant sur leur visage ils n’ont plus cette marque de tristesse rencontrée dans l’internement ou en prison. Nous nous saluons tous, nous nous aidons tous, et l’étoile blanche passe rapidement, nous donnant encore plus la certitude que c’est enfin la liberté. Le Neckar se fait voir avec ses petites collines et ses châteaux par une belle matinée de soleil printanier. Nous suivons pendant un bon moment le Neckar, puis le Rhin. Nous arrivons au-delà de Heidelberg, les ponts ont tous sauté, nous passons le Rhin en barque (le wagen ne nous abandonne pas). Heidelberg, camp des Italiens libérés ? Manger et boire du vin en abondance. Le soir même nous partons pour un autre camp36 Journal, p. 22-27..
Ça, c’est ce qu’a écrit Cesario pendant notre voyage pour trouver les Américains. On les a trouvés à Mannheim, mais on a fait soixante-dix kilomètres à pied, avant d’arriver. Et Cesario : « Enfin, grand Dieu, nous sommes libres »37 Ibid., p. 12.. On était dans un camp avec plein d’autres, Italiens ou non, qui comme nous étaient arrivés là avec l’espoir de vite rentrer chez eux et d’aller un peu mieux. Ils nous ont donné aussitôt de quoi nous rhabiller, de beaux uniformes neufs. Je me souviens qu’avec l’uniforme il y avait aussi une bande que l’on devait porter au bras, sur laquelle était écrit CIV, qui voulait dire Corps Italiens Volontaires, mais nous on disait Chair Italienne Vendue. En général on restait sans rien faire, on se promenait toute la journée ou presque.
Tous les jours arrivaient des wagons remplis de plein de choses, des wagons de marchandises contenant les choses que l’on envoyait aux soldats. Là-dedans il y avait vraiment de tout, et pour les décharger, les Américains cherchaient toujours des volontaires, ils leur donnaient même quelque chose en échange. Parfois ils essayaient même de nous faire travailler par la ruse, comme cette fois où il fallait décharger, d’un wagon resté immobile un bon moment, les résidus issus d’un tour. Il y avait un wagon plein de cette saleté et, pour la décharger, ils donnaient même les grosses fourches et les pelles mais, vu que ce wagon n’avait pas de toit, outre la poussière, beaucoup de rouille aussi s’était formée. En plus de nous salir, cette poussière nous empêchait de respirer et nous faisait mal aux yeux. Par la suite, quand le matin des camions arrivaient pour prendre des volontaires, souvent ils repartaient vides, parce que plus personne ne voulait aller décharger cette saleté.
En revanche, quand il fallait décharger des wagons pleins d’approvisionnements, ça aussi c’était des marchandises qu’ils envoyaient d’Amérique pour leurs soldats, c’était la course. Il y avait de tout, des caisses d’œufs, des cigarettes, des chocolats, des boîtes de conserve, du dentifrice, des brosses à dents et beaucoup d’autres choses. Je me souviens qu’il y avait aussi des wagons remplis des pommes de terre et ça me semblait étrange qu’ils ne prennent pas celles des Allemands, qui étaient la seule chose qu’ils avaient encore. Qui sait ? Peut-être n’avaient-ils pas confiance. Mais alors là, oui qu’on allait décharger, et en vitesse. En plus, on essayait de voler quelque chose pour nous. Les Américains s’en apercevaient mais ils ne disaient rien, ils faisaient semblant de rien. J’ai envie de rire quand je repense à quelque chose qui s’est passé avec un capitaine italo-américain. Il y en avait un, un Italien, qui comme tant d’autres avait attaché son pantalon en bas des chevilles pour en faire comme un sac et y mettre les choses qu’il arrivait à voler. Celui-ci a pris une gifle par ce capitaine, et tu sais pourquoi ? Parce qu’il n’avait pas su voler les bonnes choses. Cet Italien s’était bourré, me semble-t-il, de dentifrices et de brosses, et qui sait, peut-être qu’il croyait n’avoir pris que du chocolat. Le capitaine, quand il l’a vu qui marchait comme ça, les jambes écartées, rempli de ces choses qu’il avait volées, lui a ordonné : « Baisse ton pantalon et fais voir ce que tu as pris. » Il l’avait certainement vu et, quand il a baissé son pantalon, il lui a donné une gifle que, d’après moi, on pourrait entendre d’ici jusqu’au Prato. « Imbécile », il lui a dit, « Regarde là. Parmi tous tes compagnons, personne n’a pris ces choses. Si tu voulais voler quelque chose, tu pouvais au moins prendre des cigarettes ou des choses à manger, mais pas du dentifrice, imbécile ! Pose tout là-bas, va-t-en et apprends pour la prochaine fois. »
Moi aussi j’y suis allé un jour, pour voir si j’arrivais à trouver quelque chose de bon à emmener, mais je n’ai jamais réussi à prendre quoi que ce soit, je n’en étais pas capable. Alors Cesario m’a dit : « Écoute comment on va faire. Nous, on retourne décharger demain matin, et toi, tu restes là à attendre. » Et alors, ils ramenaient les choses qu’ils volaient et moi j’étais là, je restais à les surveiller. La population allemande, qui maintenant n’avait plus rien, faisait comme nous. Ils cherchaient toujours à s’approcher et quelqu’un réussissait à emporter quelque chose. Les marchandises arrivaient continuellement et ils ne les déchargeaient même pas dans des préfabriqués, mais sur les bords de l’autoroute, celle qu’ils étaient en train de construire de Paris à Berlin, faite entièrement de blocs de ciment. Donc les Allemands se débrouillaient aussi pour en prendre un peu par-ci, un peu par-là, et comme d’habitude les Américains faisaient semblant de ne pas voir, au moins au début. Mais un soir des Allemands ont mis le feu à un wagon et à partir de ce moment-là, ils n’ont plus essayé de s’approcher, parce que les Américains montaient la garde avec des fusils. Et ils ne les ont plus laissés toucher quoi que ce soit.
Pendant la période où on est restés avec les Américains, on a vérifié un fait qui est toujours resté gravé dans ma mémoire, à cause de la façon dont ça s’est fini. Il y avait un Russe qui, pendant son emprisonnement dans un camp allemand, avait été mal traité, mais mal, avec beaucoup de méchanceté, par un garde allemand. Par la suite, j’ai appris que ce garde allemand n’avait pas maltraité seulement lui, mais qu’il avait fait preuve d’une méchanceté épouvantable. C’était une crapule, un bourreau qui avait fait des abus de pouvoir en tout genre, un peu avec tout le monde. Ce Russe demandait continuellement à tout le monde, à droite et à gauche, des nouvelles pour retrouver le garde. Il ne voulait pas partir tant qu’il ne l’aurait pas retrouvé, parce qu’il voulait le tuer, on voit qu’il avait vraiment fait des choses graves. À la fin, il a réussi à trouver son adresse et, vu que la maison de ce bourreau n’était pas loin, il est allé là-bas pour voir s’il le retrouvait. Il y a trouvé son frère. Quand il lui a dit qu’il cherchait son frère et pourquoi, celui-ci lui a dit : « Tu arrives trop tard, c’est moi qui m’en suis chargé. » Il avait tué son propre frère, imagine quel genre de type c’était. Ce frère pensait certainement différemment de lui, sinon il ne l’aurait sûrement pas tué. Alors le Russe, seulement après s’être assuré que son bourreau était vraiment mort, est reparti vers sa maison. Ça devait vraiment être un criminel.
En revanche, il y avait un Allemand, un vieux, qui avait travaillé en usine avec nous à la Anilink Fabrik. Ce dernier, quand on travaillait là-bas, emmenait toujours avec lui quelque chose à manger et nous on restait à le regarder pendant qu’il prenait son petit déjeuner composé de deux tranches de pain et de deux cornichons au vinaigre. Il nous voyait manger tout ça des yeux, et alors il nous donnait toujours quelque chose, aux autres et à moi, peu, mais il nous donnait quelque chose. Puis, un jour, on ne l’a plus vu. Et qui je retrouve chez les Américains en train de chercher par-ci par-là quelque chose à manger !? J’étais avec Niccolino et on ne l’a pas reconnu tout de suite. C’est lui qui nous a reconnus, il est venu à notre rencontre. Et Niccolino, aussitôt, avec une de ses sorties : « Nous n’avons plus besoin de sandwichs. Avec les Américains on a de tout, chocolat, cigarettes, tout ce qu’on veut. » Écoute, le matin, le voici là, ce pauvre bougre. Il vient nous voir et nous dit : « Tiens, vous avez tellement de choses, comment je peux faire ? Vous pouvez m’aider ? », comme s’il nous disait : « Maintenant c’est moi qui ai faim, quand toi tu avais besoin, moi je t’ai aidé et je t’ai donné à manger, maintenant c’est à ton tour de m’aider. » J’avais réussi à trouver un peu de chocolat et je le lui ai donné, et ensuite je lui ai procuré aussi quelques cigarettes. Ce vieux a continué à venir encore deux ou trois fois et un matin je lui ai même donné un pain. L’autre, Niccolino, aussitôt : « Tiens, tu lui en donnes ? Mais ensuite nous, on n’en aura plus. » « Mais tu l’as mangé volontiers, quand c’était lui qui te le donnait, imbécile » je lui ai dit. Il avait aussi une famille, cet homme-là.
Pendant la période où on était avec les Américains, ils nous déplaçaient d’un endroit à un autre, et en dernier on est arrivés à Frankenthal et là : « Nous travaillons dans un magasin de vivres, à manger et à boire, même trop. Frankenthal, c’est uniforme et accueil à l’américaine, nous vivons une vie de nababs, manger, boire, dormir et... ne rien faire »38 Journal, p. 27-28..
25 avril 194539 Le 25 avril, les Italiens célèbrent la fête de la Libération.
Nous, on était encore en Allemagne quand en Italie il y a eu la libération et on ne pouvait pas faire la fête. Mais depuis il ne s’est pas passé une année que l’on n’ait fêtée comme il se devait. Il y a quelques jours c’était le 25 avril et, quand j’ai rencontré ici quelqu’un de Strada, le fils d’un fasciste de ma jeunesse, je lui ai dit : « Oh, quelle belle journée aujourd’hui, la plus belle, la plus belle fête qui existe ! La fin de la guerre, la fin de la dictature. » Celui-ci m’a regardé de travers et a commencé à grogner. Il ne voulait pas que je le lui dise, mais moi, au contraire, je le lui ai dit exprès, pour le faire enrager.
À la fin de la guerre, je me rappelle que les résistants, qui étaient plus informés que ceux qui restaient dans les villages, ont tondu les cheveux de quelques fascistes pour les punir, mais seulement de ceux qui s’étaient distingués plus que les autres. Ils savaient très bien qui ils étaient et ils ont aussi rasé la tête de quelques-uns que nous, on ne suspectait même pas d’avoir été fascistes. Pour certains, à notre plus grand étonnement. Quand je suis rentré chez moi, j’en ai vu deux à Strada, un homme et une femme, que je n’aurais jamais crus fascistes. Mais s’ils avaient eu la « tonte », ça veut dire qu’ils l’avaient été. Mais évidemment ils n’ont rasé que les petits poissons, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas pu s’enfuir, et où pouvaient-ils aller s’ils n’avaient nulle part où aller, s’ils n’avaient rien ? Les grands pontes, qui généralement étaient ceux qui avaient le plus de moyens, s’étaient enfuis, et rapidement, quand les choses avaient commencé à mal tourner pour eux. Ils ont tous fui vers le Nord de l’Italie, pour aller dans la République de Salò, et même ceux de Strada se sont enfuis, par familles entières, et les plus fanatiques, les plus exaltés, se sont enfuis les premiers. Quand ensuite ils sont revenus, une fois la guerre finie et le fascisme effondré, ils étaient tous « déchaussés et nus », et ils étaient même devenus très soumis. C’était peut-être l’occasion de se venger de quelqu’un, mais ton grand-père Beppe disait toujours : « La meilleure vengeance, c’est le pardon » et dans la famille on n’a jamais créé d’ennuis à personne parce qu’il ne le voulait pas !
8 mai 1945 : j’écris à la maison
Pendant qu’on était à Frankenthal, j’ai écrit une lettre, qui est arrivée à la maison une vingtaine de jours après mon retour :
Mes chers,
après plusieurs mois d’inquiétudes et de peur, me voici enfin libre, j’imagine votre joie de recevoir cette lettre. Neuf mois se sont écoulés, sous des tempêtes en tous genres qui ont lieu sur cette terre de barbares. Patience, tout est fini désormais, je suis libre du joug allemand. Imaginez ma joie, ou plutôt notre joie, parce que je suis avec Cesario et Niccolino, de voir le jour de Pâques les premiers chars d’assaut américains, c’est un jour que je n’oublierai jamais. Comme je vous ai dit, je suis avec Cesario et Niccolino. Walter et [Guido Moretti] étaient aussi avec nous, Walter est parti au bout de 5 mois et on n’a plus entendu parler de lui. Guido, en revanche, nous pouvons presque certifier qu’il est libre comme nous, et j’espère qu’il donnera des nouvelles à sa famille. Nous sommes maintenant habillés comme des soldats américains et traités comme eux à tous les niveaux. Pendant que j’exulte de joie pour ma libération, je suis aussi inquiet pour vous, comment allez-vous, combien de jours tristes avez-vous passés ? Cette question, que je peux maintenant vous poser avec la certitude d’avoir une réponse, combien de fois, même constamment, m’est-elle venue à l’esprit sans avoir aucune réponse. Je pourrai vous raconter un récit, presque un roman, plus en détail un jour que j’espère proche. L’essentiel est que tout soit fini. Je termine ces quelques lignes parce que je suis impatient de les envoyer, je vous salue et vous souhaite à tous une excellente santé, comme je peux vous assurer de la mienne. Bisous à papa, maman et à tout le monde. Votre Gilberto.
8928 Italian Service Unit, A.P.O. 667 U.S. Army
Le retour à la maison
Le 12 juin 1945 on est retournés en Italie. Ce jour-là, on est arrivés à Florence en train, et à peine arrivés, j’ai dit : « Moi, je ne m’arrête pas. Si vous voulez venir avec moi, je vais Via Giosuè Carducci où on trouvera sûrement quelqu’un pour nous emmener chez nous. » Et Niccolino : « Non, non, moi je vais d’un autre côté. Quand on passe devant l’hôpital Sangallo, moi je me présente là-bas, je veux ma retraite. » Je n’ai pas voulu y aller et il s’est fâché contre moi mais, vois-tu, nous étions le 12 juin et il commençait déjà à y avoir des cerises. C’est pour ça que je voulais aller au magasin de Freschi40 Gilberto et sa famille utilisaient toujours Freschi pour emmener et vendre à Florence beaucoup de produits locaux, écoulés dans leur boutique de Strada, qui variaient selon les saisons, surtout les pommes, les cerises, les châtaignes et les champignons., Via Carducci, parce que j’étais sûr que, si je trouvais quelqu’un, avec un peu de chance, je pourrais rentrer chez moi tout de suite. Il n’y avait personne à part le camion de Freschi, là, stationné dans un coin. Cesario et moi, on est montés dedans, on s’est allongés couverts avec mes couvertures, toujours celles du camp allemand, et on y a passé la nuit. On était vraiment bien. Le matin suivant, il était encore tôt, Chiarini est arrivé : « Mais regarde un peu quelle surprise ! fit Beppe dès qu’il me vit, qu’est-ce que tu fais ici ? – On est revenus hier d’Allemagne », lui ai-je répondu. Et je lui ai raconté grosso modo comment les choses s’étaient passées. « Et dire qu’hier ton père était ici, à Florence », me dit-il après.
Plus tard, on est allés Piazza Ghiberti où l’on a rencontré Gigi, le fils de Pelo, avec le camion de Tito, un de Salutio. Ils étaient là parce qu’ils avaient amené les cerises. Comme, avant que les Allemands ne me capturent, Gigi de Pelo et moi avions ramassé les champignons et les cerises ensemble, je lui dis : « Et mon père, tu as des nouvelles ? – Comme tu n’étais pas là, il me disait qu’il ne savait pas quoi faire », me répondit-il, m’informant ainsi que mon père n’avait plus travaillé avec lui. Mais j’ai appris plus tard qu’il n’était jamais allé le voir. Alors, je lui ai dit : « J’ai compris, tu as vraiment été très fort. Tant que j’étais là, tu étais content puisque je travaillais comme un âne, même pour toi, mais sans moi, tu as tout de suite laissé tomber mon père », et je fis celui qui était en colère. Mais ensuite, on a recommencé à travailler ensemble, malgré tout. Puis, mon père me dit : « J’ai quand même essayé d’aller les acheter, les cerises, mais tout seul c’était un problème. » Mais ce n’était pas la question qu’il ne pouvait pas les acheter, c’est qu’il ne savait pas comment faire pour les emmener jusqu’à Florence. Il fallait qu’il se déplace, mais avec son travail de facteur comment aurait-il fait ?
Après manger, Niccolino, Cesario et moi on est remontés dans le camion de Tito pour rentrer chez nous. Une fois arrivés à Strada, on est tous descendus au bar de la Giovannina. Mais dès que je suis entré dans le bar, je me suis écroulé comme une masse sur une chaise, tel un fruit bien mûr, j’étais vraiment épuisé, comme ça, tout d’un coup. Et dire que jusque-là je n’avais eu peur de rien ! Même quand il y avait eu les bombardements, je n’avais jamais eu peur, pas de crainte non plus des Allemands et de leurs fusils. Les souffrances et les privations ne m’avaient pas affaibli, mais quand je me suis retrouvé là, à l’intérieur de ce bar, enfin en sécurité chez moi, il faut croire que j’ai été pris par l’émotion et que toutes mes forces m’ont lâché d’un seul coup. Nous trois, nous avons été les premiers à retourner à la maison, et tout le monde nous demandait des nouvelles des autres qui avaient été emmenés en Allemagne avec nous, mais qui pouvait savoir ? Et en plus, quand nous sommes revenus, les habitants de Strada pensaient que nous avions ramené de l’or, personne ne comprenait que notre or c’était notre peau que nous avions ramenée indemne. Mais devine ce que Cesario voulait faire seulement quelques jours après notre retour ? Il voulait se porter volontaire pour aller combattre le Japon, lui qui avait tant insisté pour qu’on rentre à la maison le plus tôt possible. Et on lui disait : « Tu ne serais pas un peu fou, cette guerre-là est déjà de trop. » Qui sait, peut-être qu’il était effrayé à l’idée de n’avoir rien à faire. Avant la guerre, il travaillait comme portier à la Cassa di Risparmio, ici à Strada, et malheureusement, quand il est revenu, cette banque n’a en aucun cas voulu le reprendre.
Quand je suis rentré chez moi, mon père venait juste de finir la distribution du courrier. Il était descendu un peu plus bas que Barbiano quand il a rencontré des gens qui m’avaient vu revenir et qui lui ont dit : « Giuseppe cours, rentre chez toi, rentre chez toi, une surprise t’attend ! – Quelle surprise ? dit-il. – Ton fils est rentré. » Tu sais ce qu’il a fait ? Il avait déjà dépassé les maisons de Barbiano et il était sur le point d’arriver, mais comme il savait que là-haut il y avait ceux qui voulaient vendre les cerises, il a fait marche arrière, s’est mis d’accord sur le prix d’achat des cerises, puis il est rentré à la maison. La même nuit, je suis reparti pour Florence avec le camion de Freschi rempli de cerises et j’ai dormi là-dedans encore une fois. Le matin, Piazza Ghiberti à Florence, j’ai encore rencontré Gigi de Pelo et je lui ai dit tout de suite : « Tu vois que sans toi, mon père les a quand même achetées, les cerises ! »
- 1. Né à Strada in Casentino le 17 février 1916, Gilberto Giannotti est donc mort dans son village natal le 8 août 1999.
- 2. G. Giannotti, Mi ricordo che… Memorie, storie, lettere di Gilberto Giannotti, sous la direction de G. Ronconi, Castel San Niccolò (AR), Edizioni Fruska − Gianni Ronconi, 2001 (publiée en un nombre limité d’exemplaires, cette édition est désormais épuisée).
- 3. La première fois que Gilberto a fait son service militaire, il est resté dix mois à Pérouse dans l’infanterie, du début du mois de mars jusqu’à la fin décembre 1938, où il travaillait comme dactylographe. En mai 1940, il a été mobilisé comme téléphoniste et planton, destination Arezzo, tout d’abord dans la caserne Piave, puis au District où il est resté jusqu’en mars 1942, date à laquelle il a été libéré pour la seconde fois. En juillet 1943, il a été de nouveau rappelé mais après le 8 septembre il est retourné chez lui.
- 4. Francioni était le propriétaire de l’entreprise qui assurait le service des bus, c’est-à-dire de transports de personnes, de Strada in Casentino jusqu’à Porrena, où Gilberto pouvait prendre le train qui l’emmenait à Arezzo.
- 5. En italien nous avons l ’ expression vulgaire « Mi avete preso per un coglione » qui joue sur l ’ ambiguïté du sens : prendre quelqu ’ un pour/par un couillon [NdT].
- 6. Annina était la tante de Gilberto et vivait avec lui. Giannetto, Aurora et Federica étaient les frère et sœurs de Gilberto. L’oncle Gigi vivait également avec eux. Gilberto avait une autre sœur, Leda, et bien sûr sa mère, Lisa.
- 7. Le « squadrista » est un membre violent d ’ un groupe de choc fasciste [NdT].
- 8. Freschi était un camionneur qui, chaque jour, transportait des marchandises du Casentino à Florence et vice-versa.
- 9. Ils s’appelaient tous les deux Ferretti mais n’étaient pas de la même famille.
- 10. Le Piazzone est une place de Strada in Casentino tandis que la Giovannina était le nom d’un bar.
- 11. La « Sita » était le transport public reliant le Casentino à Florence.
- 12. Enel : Ente Nazionale per l ’ Energia Elettrica, entreprise italienne qui correspond à EDF en France [NdT].
- 13. La milice était une sorte de police fasciste qui fut introduite dans toutes les municipalités. Celui qui faisait partie de cette milice était chargé de la surveillance et du contrôle des citoyens, et plus particulièrement des antifascistes.
- 14. Diminutif qui a, dans ce cas précis, une valeur dépréciative. On appelle « repubblichini » tous les fascistes de la République de Salò [NdT].
- 15. Le 13 avril 1944 eut lieu, à Vallucciole, localité située dans la commune voisine de Stia, un véritable massacre nazi-fasciste durant lequel furent tués, sans aucune pitié, 108 civils parmi lesquels des femmes, des personnes âgées et des enfants, certains n’ayant que quelques mois.
- 16. Les salésiens, congrégation religieuse fondée par San Giovanni Bosco, installée à Strada dans un grand immeuble appelé par tous « Il Collegio », le pensionnat, étant donné que, avec les prêtres, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui y résidaient comme pensionnaires. Mais le pensionnat était également fréquenté par la majorité des habitants de Strada pour des motifs religieux, des activités scolaires ou récréatives.
- 17. Maisons séparées par une route et proches de la rivière Solano.
- 18. Cesario Ceruti était un ami de Gilberto et a été ramené en Allemagne avec tous les autres. De sa capture jusqu’au moment où il trouva refuge dans un camp de l’armée américaine, Cesario nota ce qui se passait dans un petit journal. Les événements décrits, qui occupent seulement 28 pages de son livret, coïncident avec ceux du récit fait par Gilberto. Le journal appartient désormais à Gianni Ronconi. À partir de maintenant nous indiquerons ce texte dans les notes de bas de page avec la mention en italique, Journal, suivie de la page citée.
- 19. Pietro Vettori est un gros producteur de vin de la vallée [NdT].
- 20. Ce col relie la Toscane à l ’ Emilie-Romagne. C ’ est l ’ une des voies d ’ accès au Nord de l ’ Italie [NdT].
- 21. Petite ville du Sud de l ’ Autriche [NdT].
- 22. Le nom complet de cette usine de Ludwigshafen est « Ammoniaklaboratorium der Badischen Anilink-und Soda Fabrik », c ’ est-à-dire, mot à mot, Laboratoire d ’ ammoniaque de l ’ usine Anilink et soda du pays de Bade [NdT].
- 23. En Allemagne, en 1933, les syndicats sont interdits et remplacés par le Front allemand du travail (Deutsche Arbeitsfront, DAF) [NdT].
- 24. C ’ est-à-dire « Oh, gut, sehr gut, Danke schoen, vielen Dank. » Expression approximative signifiant « Bien, très bien, un grand merci, merci beaucoup » [NdT].
- 25. Un laissez-passer [NdT].
- 26. Les gnocchis, appelés aussi en Toscane « topini » (petites souris) à cause de leur forme dodue, sont un plat de résistance, un « primo », où les pommes de terre, cuites à l ’ eau et passées à la moulinette, sont mélangées avec beaucoup de farine, une pincée de sel et un œuf : la pâte est ensuite coupée en petits dés. Würstel, mot allemand qui désigne les saucisses de Francfort ou de Strasbourg [NdT].
- 27. Journal, p. 7.
- 28. Ibidem. Punker, avec transcription erronée de l’initiale du mot : bunker.
- 29. Ibid., p. 13-21.
- 30. Journal, p. 7-8.
- 31. Le mot signifie en fait « berger ».
- 32. Expression signifiant dans ce contexte : « C ’ est prêt, à table ! » [NdT].
- 33. Journal, p. 10-11.
- 34. Expression approximative signifiant « malade dents », c ’ est-à-dire « j ’ ai mal aux dents » [NdT].
- 35. Gâteau typique de Sienne, plat et rond, composé de fruits confits, d’amandes, de miel et d’épices [NdT].
- 36. Journal, p. 22-27.
- 37. Ibid., p. 12.
- 38. Journal, p. 27-28.
- 39. Le 25 avril, les Italiens célèbrent la fête de la Libération.
- 40. Gilberto et sa famille utilisaient toujours Freschi pour emmener et vendre à Florence beaucoup de produits locaux, écoulés dans leur boutique de Strada, qui variaient selon les saisons, surtout les pommes, les cerises, les châtaignes et les champignons.
- Cetica (Strada in Casentino)
- Pratovecchio (Arezzo)
- Florence (Toscane)
- Venise (Vénétie)
- Forlì-Cesena (Emilie-Romagne)
- Allemagne
- Laudenberg (Bade-Wurtemberg)
- Frankenthal (Rhénanie-Palatinat)
- Camp d'Oppau (Ludwigshafen)
- Déportation
- Libération (Italie)
- Ligne gothique
- République de Salò
- Organisation Todt
- Déclaration de guerre (Italie)
- Fascisme
- Massacres nazi-fascistes
- Benito Mussolini
- Soldats allemands
- Numéro: OU001
- Lieu: Collection privée Gianni Ronconi