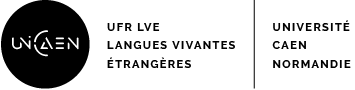Souvenirs du débarquement de juin 1944. Mémoires d'une jeune maîtresse d'école normande
Née à Octeville, commune du nord du département de la Manche, en 1916, Marcelle Hamel arrive à Neuville-au-Plain, près de Sainte-Mère-Église, le 1er avril 1940 où elle exerce son métier de maîtresse d’école. Après huit années passées dans la petite bourgade, l’institutrice retourne sur ses terres du nord Cotentin, à Cherbourg. Après l’obtention d’une licence de Lettres, elle poursuit sa carrière, honorée par les Palmes Académiques et des postes de direction, dont le dernier de 1968 à 1975 dans sa ville natale. Retraitée à Omonville-la-Rogue, elle y décédera le 25 octobre 1988. Ces Souvenirs du débarquement de juin 1944 ont été rédigés immédiatement après guerre, ce qui donne à l’écrit cette proximité avec l’événement tant recherchée, et au lecteur l’impression de vivre les peurs, les angoisses et les joies de la jeune femme. Ce témoignage inédit a été confié au Mémorial de Caen par un donateur normand : nous n’y avons ajouté que le sous-titre, proche de la définition que ce donateur lui-même a donnée au récit : « Mémoires d’une petite maîtresse d’école, en Normandie ».
Les années d’Occupation 1940-1944
C’est le 5 avril 1940 que je pris en mains ma classe à Neuville, une classe unique de trente-deux élèves, garçons et filles de cinq à treize ans. J’aurais mille histoires plaisantes et pittoresques à raconter sur les mentalités paysannes du coin et sur le mode de pédagogie que m’amenèrent à pratiquer mes charmants élèves et leurs familles. Mais ce n’est pas le lieu ici.
Nous pensions encore en avril 40 qu’avec notre ferraille on était en train de forger l’acier victorieux. Nous n’allions pas tarder à ravaler nos cocoricos. L’avalanche vert-de-gris1Surnom attribué aux soldats allemands, en référence à la couleur de l’uniforme de la Wehrmacht. de mai fondit sur nous avant même que nous ayons eu le temps de réaliser ce qui nous arrivait. La voix du Maréchal2L’auteur fait ici référence au discours radiophonique du maréchal Pétain qui le 17 juin 1940 annonce, trois jours seulement après l’entrée des Allemands dans Paris, que le gouvernement, formé la nuit précédente, va demander l’armistice. La célèbre allocution, « c’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat », sera suivie, quelques heures après, de l’appel lancé par le général de Gaulle, le 18 juin 1940. nous réveilla de cette torpeur pour nous plonger dans le désespoir. L’appel du général de Gaulle3Diffusé sur les ondes de la B.B.C. le 18 juin 1940 depuis Londres, l’appel lancé par le général de Gaulle n’est que très peu écouté le jour même à la radio. Le bouche à oreille et la presse permettront de diffuser plus largement le message à la population française. fut la petite lueur qui se mit à briller à l’autre bout du tunnel. Nous ne connûmes pas les tragédies de l’exode. Assiégés dans notre presqu’île, où serions-nous allés ? La mer était devenue un champ de mines et, seuls, les plus hardis s’y engageraient sur le chemin de la libre Angleterre.
La défaite étant consommée, il fallait s’organiser pour survivre jusqu’au jour de la victoire. Ici dans cette campagne aux riches pâturages, nous étions des privilégiés. Nous eûmes toujours l’essentiel et quelquefois même le superflu, et nous en profitions en toute bonne conscience en nous disant que c’était toujours ça de pris sur les Allemands. La maison d’école était inconfortable et plutôt délabrée, mais ma mère qui habitait avec moi sut en faire un logis assez coquet et 1’aménagea au mieux pour que nous y soyons bien.
Chaque semaine, nous prenions le car pour aller à Cherbourg porter du ravitaillement à mes grands-parents maternels et à ma grand-tante Rosalie qui occupait notre maison d’Octeville pour éviter qu’elle ne soit réquisitionnée. Les autobus venant de Saint-Lô arrivaient complets à Neuville et il fallait presque les prendre d’assaut. On faisait tout le trajet debout. Parfois, le car était tellement bondé qu’il ne s’arrêtait même pas. Alors, nous devions faire six kilomètres à pied avec tout notre chargement jusqu’à la gare de Fresville pour prendre un train omnibus qui avait souvent plusieurs heures de retard. Pour rentrer, ce n’était pas plus facile. Quand on n’avait pas réussi à se hisser dans l’autobus, on devait courir prendre « le train des fuyards » et refaire à pied, en pleine nuit et parfois sous la pluie, le trajet de la gare de Fresville à chez nous. Ce qu’on appelait « le train des fuyards », c’était l’omnibus qui quittait Cherbourg tous les soirs de la semaine, emmenant vers les campagnes et les bourgs de 1’arrière-pays les Cherbourgeois qui s’y étaient « réfugiés » par peur des bombardements nocturnes[,] et qui ne restaient en ville que pour leur travail et leurs affaires de la journée.
Souvent en effet les nuits à Cherbourg étaient perturbées par les attaques aériennes. Une certaine nuit, ce fut un terrible bombardement par une escadre de la marine anglaise4Cherbourg subit un bombardement de la flotte britannique dans la nuit du 10 au 11 octobre 1940.. Il y eut beaucoup de civils tués ; des familles entières furent ensevelies sous leurs maisons atteintes par les gros obus de marine. On avait l’impression cette nuit-là que ce n’était pas un bombardement ordinaire, que ça n’allait jamais finir. Rien de plus angoissant que ce danger qui vous menace pendant des heures sans que vous ne puissiez ni sortir, ni savoir ce qui se passe, ni où ça tombe. Les Cherbourgeois, s’ils eurent la chance de ne pas connaître de bombardements massifs comme ceux qui devaient détruire Caen et Saint-Lô, furent harcelés pendant toute la guerre par ces raids aériens qui faisaient à chaque fois des dégâts et quelques victimes5Le 24 juillet et le 30 septembre 1941, la ville est touchée par les bombes anglaises, causant la mort de nombreux Cherbourgeois et détruisant certains bâtiments, notamment dans la rue Tour Carrée le 30 septembre..
En mai 1943, nous connûmes un nouveau tourment. Les Allemands ordonnèrent l’évacuation de l’agglomération de Cherbourg6Femmes, enfants et personnes âgées sont touchés par ces mesures d’évacuation qui entrent en vigueur en 1943., il nous fallut déloger mes grands-parents de leur petite maison où ils avaient passé toute leur vie, et aussi enlever le plus possible de choses de notre maison d’Octeville qu’habitait ma tante Rosalie et dont l’étage venait d’être réquisitionné pour loger un officier allemand. Ces déménagements furent pour ma mère et moi une entreprise colossale qu’il nous fallut mener avec les moyens du bord et avec 1’aide de quelques bonnes volontés compatissantes. Le plus difficile était de trouver des moyens de transport car tout Cherbourg déménageait en même temps. Heureusement, la maison d’école de Neuville avait d’immenses greniers et nous parvînmes à tout y entasser.
Maintenant, nous étions réunis à Neuville tous les cinq : mes grands-parents, ma tante, ma mère et moi. J’étais d’autant plus heureuse de les avoir près de moi qu’on sentait bien, surtout après l’évacuation de Cherbourg et des zones littorales7Une zone interdite (zone côtière s’étalant sur une dizaine de kilomètres) est instaurée par les autorités allemandes, notamment sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique. Après avoir fait évacuer les femmes, enfants et personnes âgées de l’agglomération de Cherbourg, c’est l’ensemble de la population jugée non-utile pour les Allemands qui sera évacuée dès le mois de mars 1944. Ces « inutiles », comme on les surnomme à l’époque, seront par la suite rejoints par une large part de la population qui était restée dans la ville, craignant les bombardements qui s’intensifient au cours du printemps 1944., que de grands événements se préparaient.
Mai 1944 : le jour J approche
Depuis longtemps déjà, le mythe de la défense élastique sur le front russe, le débarquement allié en Afrique du Nord, la défaite de Rommel à El-Alamein8Le 2 novembre 1942, les Britanniques l’emportent sur les armées allemandes et italiennes à El-Alamein., nous faisaient espérer que bientôt ce serait le commencement de la fin, demain peut-être, ou plus tard mais sûrement avant l’automne.
En attendant, les Allemands sont toujours là. Pas à Neuville précisément, où de toute la guerre, on n’en a jamais vu que de passage. Ni même dans notre arrière-pays où ne cantonnent, dispersés, que des soldats de seconde catégorie et de tous âges : des gosses et des pépères, auxquels se mêlent parfois d’effrayants hommes jaunes venus on ne sait d’où mais qu’on dit être des Géorgiens9Ces Géorgiens, servant comme auxiliaires dans l’armée allemande, forment le 795e bataillon de la 709e division d’infanterie. Ce bataillon a notamment en charge la défense d’une des plages de Sainte-Marie-du-Mont, située à quelques kilomètres de Neuville-au-Plain.. En revanche, ils sont plus nombreux que jamais tout le long de nos côtes où ils renforcent fébrilement le réseau de leurs blockhaus. Comme nous, ils s’attendent à quelque chose. Ils ont requis des civils sur place pour accélérer leurs travaux de défense. Un peu partout, dans les champs, ils font creuser des tranchées et des fossés anti-chars et aménager des emplacements de canons. Les prairies basses qui s’étendent derrière la dune littorale entre Sainte-Marie-du-Mont et Quinéville ont été en partie inondées. Mais surtout, on s’affaire à planter des pieux, les fameuses « asperges de Rommel »10Ce nom d’« asperges de Rommel » ou « asperges à Rommel » est donné par la population locale qui, requise par les autorités allemandes, se voit donc contrainte de hérisser des pieux, sur des terrains susceptibles d’être employés comme zone d’atterrissage par les Alliés. dans toutes les étendues plates et bien dégagées susceptibles de servir d’aires d’atterrissage à des avions de débarquement. Le travail ne progresse que lentement car les Français qu’on emploie à cette besogne y témoignent du manque de zèle le plus absolu.
En ce mois de mai, c’est déjà presque l’été tellement il fait beau. Mais on se sent angoissé, on a l’impression de vivre près d’un volcan dont l’éruption serait imminente. Chaque jour, les forteresses volantes viennent ronronner dans le ciel. Une nuit, nous sommes réveillés par un fort bombardement. Nous nous levons et nous sortons pour voir ce qui se passe. Du côté de la mer, c’est un fantastique feu d’artifice traçant dans le ciel des serpents de feu qui sifflent dans un tonnerre d’explosions avec, en bruit de fond, le vrombissement des escadrilles. Peu à peu, les lueurs s’éteignent, le bruit des moteurs s’éloigne. L’obscurité et le silence reprennent possession de la nuit. Je rentre, à la fois soulagée et déçue. Le lendemain matin, j’apprends que les défenses allemandes du côté de Saint-Martin-de-Varreville11Les batteries côtières situées sur la commune de Saint-Martin-de-Varreville (quatre canons) subiront plusieurs attaques, notamment la veille du Débarquement, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. ont été pilonnées et gravement endommagées par l’aviation alliée. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes civiles. C’est la première fois que cette côte est bombardée. Plus que jamais, nous sentons que l’heure du débarquement est proche et nous sommes persuadés qu’il aura lieu près d’ici. Les Allemands nous ayant fait déposer nos postes de radio dans les mairies12Avant même le début des grandes opérations militaires en Normandie, les Allemands, conscients de l’importance des écoutes, notamment celle de la B.B.C. par les résistants, ordonnent que tous les postes de T.S.F. (Téléphonie sans fil) soient déposés en mairie. Ainsi, dès mars 1944, les civils se voient dans l’obligation de remettre leurs postes., c’est sur un petit poste à galène qu’au matin du 5 juin nous apprenons par la B.B.C. la prise de Rome. Il n’est question que de cela. Nous nous exaltons à rêver au jour où nos villes pourront aussi accueillir les Alliés. L’idée qu’il en coûtera beaucoup de sang et de larmes ne nous effleure qu’à peine.
La nuit du 5 au 6 juin : pluie de parachutes
Au mois de juin, les jours n’en finissent plus et la nuit n’est qu’un long crépuscule car l’obscurité n’y est jamais complète. Il est environ 22 heures, ce lundi 5 juin, et je viens de me coucher près de ma mère. Nous dormons toutes les deux sur un canapé-lit que nous ouvrons chaque soir dans la salle commune, car nous avons depuis l’évacuation de Cherbourg laissé notre chambre à mes grands-parents. Le canapé fait face à la fenêtre toute grande ouverte sur la nuit. Ainsi, de mon lit, je contemple encore un moment la fin de ce beau jour. Je pense avec mélancolie à un soir de juin tout pareil, celui de juin 1940 où mon ami Jean m’a quittée pour aller rejoindre la France Libre13Le rassemblement de la France Libre naît autour du général de Gaulle dès juin 1940. Les membres de l’organisation, dont le centre névralgique est établi à Londres, s’organisent dans l’optique d’aider les Alliés au combat. Ainsi, ils se joindront à ces troupes en Afrique, en Italie puis en Normandie lors du Débarquement.. J’ai su qu’il avait débarqué en Afrique du Nord, peut-être est-il déjà en Italie ? Peut-être que bientôt... Mais ne divaguons plus, essayons de dormir.
Un vrombissement d’avions trouble tout à coup le silence du soir. Mais c’est tellement habituel, on y prend d’autant moins garde qu’ici il n’y a pas d’objectif militaire et que la voie ferrée est à plus de cinq kilomètres. Mais le bruit s’amplifie, le ciel s’éclaire et rougeoie. Je me lève, et bientôt toute la famille est debout. Nous sortons dans la cour. Là tout semble calme. On n’entend que la rumeur lointaine d’un bombardement dans la direction de Quinéville. Pourtant, d’inépuisables escadrilles semblent rôder, mystérieuses, dans un incessant ronronnement. Puis, c’est le decrescendo, ce ne sont plus que des bruits vagues et lointains. « C’est comme la dernière fois, dit ma mère, ils ont dû bombarder les blockhaus de la côte ». Et nous allons tous nous recoucher.
Maman s’endort tout de suite. Mais moi, je m’assieds sur mon lit et je continue de contempler le rectangle de nuit claire que découpe la fenêtre. Le besoin de dormir engourdit peu à peu mon esprit, mais je garde les yeux grands ouverts sur la nuit. C’est dans cette sorte de demi-sommeil que je vois surgir, se découpant en sombre sur le clair-obscur du ciel, des ombres fantastiques, comme de grands parasols noirs qui semblent pleuvoir doucement sur les champs d’en face, puis disparaître derrière la ligne noire des haies.
Non, je ne rêve pas ! Grand-mère[,] qui ne dormait pas, les a vus, elle aussi, par la fenêtre de sa chambre. Je réveille maman et ma tante. Nous nous rhabillons à la hâte et sortons dans la cour. De nouveau, le ciel s’est empli d’un incessant bourdonnement qui va s’intensifiant. Les haies s’animent de craquements insolites. Le père Dumont, le voisin d’en face, un veuf qui habite là avec ses trois gosses, est sorti lui aussi. Il vient vers nous nous montrer, accrochée à l’angle du toit du préau, la toile d’un parachute. Les gamins Dumont ont suivi leur père et nous ont rejoints dans la cour de l’école. Mais la nuit ne nous a pas encore livré son secret.
Une curiosité impatiente est plus forte que l’émotion qui m’étreint. Je sors de la cour, fais quelques pas sur le chemin. À la barrière du clos voisin, un homme est assis sur le rebord du talus. Il est harnaché de gros sacs et armé de pied en cap : fusil, pistolet et une sorte de coutelas. II me fait signe d’approcher. En anglais, je lui demande si son avion a été abattu. Il me détrompe et m’assène, à mi-voix, dans un français très pur, la formidable nouvelle : « C’est la grande invasion14Terme utilisé à la fois par les Anglais, Américains et Allemands pour évoquer les opérations militaires du 6 juin.... Des milliers et des milliers de parachutistes descendent sur ce pays cette nuit. Je suis un soldat américain, mais je parle bien votre langue, ma mère est une française des Basses-Pyrénées »15La 82e aéroportée et la 101e aéroportée américaines seront parachutées près de Sainte-Mère-Église, Saint-Côme-du-Mont, Picauville. 13.000 hommes sont ainsi embarqués dans 832 appareils afin de s’emparer de routes clés (telle la Route Nationale 13), détruire les ponts, faire sauter la voie ferrée allant vers Carentan et annihiler quelques batteries côtières. Ceci dans le but d’empêcher les renforts allemands d’arriver et de sécuriser la zone de débarquement. En 1969, le département des Basses-Pyrénées change de nom pour devenir le département des Pyrénées Atlantiques.. Je questionne : « Que se passe-t-il sur la côte ? Y a-t-il un débarquement ? Et les Allemands ? » L’émotion bouleverse mes pensées et me fait bafouiller. Il ne répond pas à mes questions mais m’interroge sur l’importance et la situation de l’ennemi dans ces parages. Je le rassure : « II n’y a pas d’Allemands ici ; les plus proches sont cantonnés à Sainte-Mère-Église, à près de deux kilomètres ».
L’Américain me dit qu’il voudrait consulter sa carte dans un endroit où l’on ne risque pas de repérer la lueur de sa torche électrique. Je lui propose d’entrer chez nous. Il hésite car il craint, dit-il, de nous compromettre au cas où des Allemands viendraient à surgir à l’improviste. C’est une éventualité qui ne m’a pas même effleuré l’esprit et que, dans mon inconscience du danger, je refuse encore d’envisager. J’insiste et le rassure : « Le père Dumont et ma vieille tante vont surveiller les abords de l’école, l’un par devant et l’autre par derrière ». Le soldat nous suit alors en boitillant ; il m’explique qu’il s’est foulé la cheville en atterrissant et refuse de se laisser soigner. Il y a des urgences plus grandes. Dans la classe, où grand-mère, maman et les enfants Dumont sont entrés à sa suite, il se débarrasse d’une de ses trois ou quatre musettes, il arrache les bandelettes gommées qui la scellent et en extrait des cartes d’État-major. Il en étale une sur un pupitre. C’est la carte de la région. Il me demande de lui montrer l’endroit précis où il se trouve. Il est étonné d’être si loin de la voie ferrée et d’une petite rivière qui s’appelle le Merderet et borde le marais de Neuville vers l’ouest16Les parachutages furent d’une grande imprécision en raison notamment du mauvais temps qui sévissait sur la région et de la prudence des pilotes. Certains parachutés se retrouvèrent parfois à une trentaine de kilomètres de la zone d’atterrissage prévue.. Je lui indique le chemin à suivre pour s’en rapprocher. C’est par là, en principe, qu’il doit retrouver ses compagnons. Il regarde sa montre. Machinalement, j’en fais autant. Il est onze heures vingt. Il replie sa carte, fait disparaître toute trace de son passage et, après avoir sorti de sa poche du chocolat qu’il donne aux enfants[, si] ébahis qu’ils en oublient de le manger[,] il prend congé de nous. Il paraît parfaitement calme et maître de lui, mais la main qu’il me tend est moite et se crispe un peu dans la mienne. Je lui souhaite bonne route d’une voix qui se veut joviale. « Bonne nuit à vous tous ! » répond-il. Et il ajoute en anglais pour n’être compris que de moi : « Les jours qui viennent vont être terribles. Bonne chance mademoiselle, merci, je penserai à vous toute ma vie. » Et il disparaît comme une vision de rêve.
Le mystère de la nuit s’épaissit à nouveau. Nous restons dehors attendant nous ne savons quoi, étouffant nos voix. Et subitement, c’est un extraordinaire embrasement. L’horizon, du côté de la mer, s’éclaire comme des reflets d’un immense incendie qu’on aurait allumé sur l’Océan. Le formidable grondement des pièces de marine parvient jusqu’ici, mais assourdi et comme submergé par une multitude de bruits indéfinissables.
De noires silhouettes d’avions arrivent par nuées et tournoient dans le ciel. L’un d’eux passe juste au-dessus de notre petite école, il allume ses feux et lâche... quoi ? Un instant, nous croyons que c’est un chapelet de bombes. Mais nous ne faisons qu’ébaucher le geste de nous jeter à terre, car les parachutes s’ouvrent presque aussitôt et ils flottent comme un essaim de bulles noires dans la nuit claire. Puis ils s’égaillent avant de disparaître dans les confusions du paysage nocturne. Un autre avion passe au-dessus de nous et largue son chargement. Les parachutes semblent d’abord entraînés dans le sillage de l’avion, puis ils amorcent une verticale vertigineuse et enfin les dômes de soie s’ouvrent. La descente se ralentit de plus en plus à mesure qu’ils approchent du sol. Toutefois, celle des hommes qu’on distingue nettement à leurs jambes pendantes s’achève un peu plus rapidement que celle des sacs de vivres, de matériel et de munitions. Ce n’est bientôt plus dans le ciel au-dessus de nos têtes qu’un immense ballet de parachutes.
Le spectacle sur la terre n’est pas moins extraordinaire. De tous les coins de la campagne, des gerbes de fusées multicolores jaillissent comme lancées par d’invisibles jongleurs. Et voilà que sur les champs d’alentour, tels des vaisseaux fantômes, de grands aéroplanes noirs glissent silencieusement vers le sol où ils semblent se poser comme dans un rêve ! Ce sont les premières escadrilles de planeurs. Notre premier parachutiste faisait partie d’un groupe d’éclaireurs largués pour signaler les zones de descentes et les aires d’atterrissage. Les heures passent. Nous restons dehors dans la cour. Aux détonations et explosions se mêle tout près de nous le martèlement des galops affolés des chevaux échappés de leurs enclos. Je voudrais bien sortir pour aller voir ce qui se passe plus loin, mais ma mère m’en dissuade.
La journée du 6 juin : flambée de joie... et retombée d’angoisse...
L’aube du 6 juin commence à faire pâlir la nuit. Je frissonne sous le souffle frais de l’heure matinale. Les Dumont s’en vont chez eux et nous rentrons pour nous réchauffer un peu dans la tiède et rassurante ambiance de la maison.
Brusquement, quatre ou cinq soldats au casque rond, l’arme au poing, pénètrent dans la cour. Celui qui doit être le chef frappe violemment à la porte en criant avec un fort accent yankee : « Nous, soldats américains... Y a-t-il des Allemands ici ? » À son air conquérant et sûr de lui, on croirait qu’il a déjà gagné la guerre. Nous les accueillons à bras ouverts. Leur assurance est si communicative que nous considérons déjà que la libération est faite comme si, en une nuit, toute l’armée allemande s’était volatilisée. Moment d’euphorie. Je ne tiens plus en place, je sors, je rentre, je vais et viens de la porte d’entrée à la barrière de la cour. Je vois passer des parachutistes qui, rasant les haies, se dirigent vers leurs points de rassemblement. La plupart ont le visage barbouillé de noir et me regardent en me souriant drôlement sous leur étrange maquillage. Plusieurs traînent un peu la jambe, d’autres sont drapés dans la soie aux tons verts et bruns de leurs parachutes. Leurs silhouettes massives sous le gros casque rond, le grand coutelas planté à l’intérieur de la tige de leurs belles chaussures montantes de cuir jaune, leur allure et leur démarche, tout cela évoque des histoires de bandits et de Far West.
Un jeune homme qui [avait été] embauché dans une ferme voisine et qui était en fait, je ne l’ai su qu’après, un gars de la Résistance, se présente à la barrière avec d’autres soldats américains et me demande de leur servir d’interprète, je vais pouvoir enfin être utile ! Celui qui doit être l’officier, bien qu’aucun galon ne le distingue des autres, me présente sa carte d’État-major et me désigne la ferme des Noires Terres, près du village de la Fière à proximité de la ligne Paris-Cherbourg, entre les gares de Fresville et de Chef-du-Pont. Il veut savoir le meilleur chemin pour y parvenir et me demande s’il y a des cantonnements allemands de ce côté. Il voudrait que quelqu’un les guide jusque-là. « J’y vais, dit le jeune résistant, je connais très bien le chemin. » Et il part avec eux.
Un autre groupe de soldats fait halte devant l’école et cherche, lui aussi, à s’orienter. L’officier me fait signe d’approcher. Il est heureux de constater que je comprends l’anglais. Il me montre sur sa carte « la Chasse des trois Ormes » aux abords de laquelle est son point de ralliement. C’est un petit chemin, juste au bas de la côte à l’entrée de Sainte-Mère-Église. Comme les Américains veulent éviter la grande route, l’itinéraire est assez compliqué : il faut connaître les brèches qui permettent de franchir les haies pour passer à travers champs. Je propose de leur servir de guide, l’officier, qui a conscience des risques, hésite à accepter mon offre. Mais comme il n’a pas le choix, tout en continuant à mâchonner son chewing-gum, il dit « O.K. » en me donnant une petite tape amicale sur l’épaule. Et nous partons. Comme nous approchons de Sainte-Mère, une mitraillade éclate tout à coup. Les soldats s’arrêtent. Moi, j’ai la gorge serrée. Si j’étais seule, je m’enfuirais en courant vers la maison, mais mes Américains sont là. Encore deux herbages à traverser en longeant les haies. Et on aperçoit le chemin des Trois Ormes. Mission accomplie !
Il me faut maintenant refaire ce parcours en sens inverse et cette fois, seule. Cela me paraît interminable. J’ai l’impression que, comme dans un cauchemar, je marche sur place sans avancer. Dans les champs que je traverse, des groupes silencieux s’affairent à des besognes qui me paraissent bien étranges. À la Croix de Neuville, les Américains installent je ne sais quoi en travers de la route nationale. Les trois gamins de Dérot[,] le fermier voisin, et son commis les observent de l’endroit où le chemin de l’école débouche sur la grande route, précisément en face de la Croix. Je me joins au petit groupe des curieux. Un soldat s’avance vers nous et nous fait signe de nous éloigner. Un autre, juché au faîte du plus proche poteau électrique, vient de couper les fils. De son perchoir, il crie quelque chose que je ne comprends pas à ses camarades occupés sur la route. Aussitôt, ces derniers s’écartent de l’endroit où ils besognaient et nous font reculer avec eux dans le chemin de 1’école, pendant que 1’autre descend prestement de son poteau et nous rejoint. Nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer, mais nous sommes sûrs qu’il va se passer quelque chose.
Cela ne tarde pas d’ailleurs[,] en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire un camion militaire allemand suivi d’une auto et d’une moto arrive et passe à la Croix. Une explosion formidable, une fumée chargée de débris qui jaillissent en l’air puis s’égaillent en un grand fracas de ferraille... Et c’est fini. Nous comprenons alors que la route venait d’être minée par les Américains. Mais les quelques Allemands qui, au petit matin du 6 juin, roulaient ainsi à vive allure en direction de Sainte-Mère-Église n’y auront, eux, jamais rien compris.
Tous les gens du village sont maintenant sortis de chez eux pour accueillir les parachutistes et on fête déjà le débarquement en invitant les Américains à boire un coup en passant. Des rires, des oh ! des ah ! devant les nouveautés qui nous étonnent, par exemple une petite auto, une des premières Jeeps, descendue du ciel en planeur.
Mais notre bonheur ne dure pas longtemps. Les Américains postent un petit canon à la Croix, il me semble entendre un crépitement de balles. Sur le chemin où je me hasarde, un soldat est blotti derrière la haie. Il se tient immobile et courbé, comme aux aguets. Dès qu’il m’aperçoit, il pose mystérieusement un doigt sur ses lèvres, puis me désigne quelque chose sur la gauche. Je tourne mes regards dans cette direction, et aussitôt les mots que j’allais dire s’étranglent dans ma gorge. Au détour du chemin, des soldats allemands avancent en file indienne, 1’arme à la main, courbant 1’échine, rasant la haie. Je réalise l’imminence du danger et m’enfuis vers la maison. À peine suis-je rentrée que plusieurs rafales de mitraillette font vibrer les vitres.
Les Boches17Dénomination péjorative désignant l’Allemand. Ce mot, employé dès la seconde moitié du XIXe siècle, est difficilement explicable d’un point de vue étymologique. Possible aphérèse d’« alboche », mot plus ancien précédé du préfixe « al- » pour Allemand. L’expression « tête de boche », utilisée dans l’argot du XIXe siècle, désigne une personne à la tête dure, en référence à cette boule de bois, la boche, que l’on jette dans certains jeux de quilles notamment. « Boche » pourrait être aussi le diminutif de « caboche », désignant la tête. sont donc encore là ! C’est à peine croyable ! J’en suis à me demander si je les ai vraiment bien vus. Hélas, mes doutes s’évanouissent quand j’aperçois de ma fenêtre un groupe d’uniformes vert-de-gris qui sortent de la cour du père Dumont. Ma déception est brutale. Je m’accroche à l’espoir qu’il ne s’agit que d’un petit groupe d’isolés essayant de rejoindre vers Montebourg le gros de la troupe. D’ailleurs voici maintenant trois Américains qui passent, plongeant des regards inquisiteurs dans les buissons des haies, prêts à réagir au moindre mouvement suspect. Il est environ 4 heures de 1’après-midi. Je rentre prudemment à la maison, et postée derrière la fenêtre, je vais rester jusqu’à la nuit à observer anxieusement ce qui se passe au dehors. À vrai dire, je ne vois pas grand-chose. C’est le lendemain, par les uns et les autres, que je saurai un peu mieux les événements de la soirée.
Les Allemands, d’abord déroutés, se sont ressaisis et regroupés. C’est ainsi que de petits groupes des deux camps se rencontrent et s’affrontent dans les champs, sur les chemins et sentiers autour du bourg. Les Allemands, ayant reçu du renfort, contre-attaquent et mettent les Américains en position plutôt critique. Un cycliste annonce au château qu’une colonne allemande descend d’Émondeville vers Neuville. À peine le temps de prévenir les Américains présents, et la colonne est là. Il y a des Allemands partout, autour du château, dans le parc, dans la cour, dans le jardin. Ils surgissent de toutes parts, cernant, puis occupant le château. Ils y amènent des Américains blessés qu’ils ont faits prisonniers ainsi que le cadavre d’un des occupants du camion allemand qui a sauté le matin sur les mines à la Croix de Neuville, ce doit être le chauffeur car la rigidité cadavérique 1’a figé dans le geste de tenir encore le volant. Ils l’ont étendu sur la longue table de la cuisine où il attire les mouches.
En bref, au soir du 6 juin, la situation telle que nous la percevons à Neuville, n’est pas brillante et [est] bien confuse. Nous n’avons pas perdu confiance, mais notre joie du matin est remplacée par une lourde anxiété.
La nuit du 6 au 7 juin : le retour en force des Allemands
La nuit qui vient de commencer ne sera qu’une longue et angoissante veillée. Nous avons fermé nos volets, et comme l’électricité est coupée, ma mère a ressorti une vieille lampe Pigeon qui répand dans la pièce une clarté sinistre de veillée mortuaire. Je m’efforce de rester optimiste en dépit d’une inquiétude croissante. J’essaie de rassurer les autres tout en les persuadant qu’il faut préparer des affaires dans les valises pour le cas où nous serions obligés de partir précipitamment. Cela fait passer le temps et occupe l’esprit. Il me semble soudain percevoir le bruit d’une troupe en marche, puis des paroles inintelligibles, comme des ordres. Cette rumeur vient de la grande route. Nous sortons dans le jardin, et, cette fois, nous percevons nettement le bruit des bottes mêlé au martèlement des sabots des chevaux et au lourd roulement des voitures. Il n’y a plus aucun doute : ce sont les Allemands qui reviennent en force. Il faut rentrer et attendre mais attendre quoi ? Je n’ose y penser.
Les bruits se sont rapprochés. Les Boches doivent être maintenant dans notre petit chemin. Je crois même qu'ils s’arrêtent devant l’école. Mon Dieu ; j’entends les voitures qui entrent dans la cour, j’ai très peur, mais tout de même je veux savoir ce qui se passe. Je grimpe sur un tabouret pour regarder dans la cour par le haut-jour de la porte. La nuit est plutôt sombre, et je devine sans les distinguer nettement deux longues voitures à quatre roues, bâchées en demi-cercle. La silhouette de ces lourdes guimbardes qui font penser aux antiques chariots des pionniers du Far West est devenue familière depuis que les réserves de carburant des Allemands ont commencé à s’épuiser. La cour est maintenant pleine de soldats et de matériel. Des avions, sans doute américains, volent très bas : « Pour sûr, ils sont en train de nous repérer, dit ma mère. Et avec un pareil arsenal dans la cour, nous sommes bons pour le massacre ». Ce qu’il y a de rassurant avec ma mère, c’est que les catastrophes qu’elle prédit n’arrivent jamais. C’est une sorte d’anti-Cassandre, et c’est justement ce que je me dis pour me redonner un peu d’optimisme. Il en faut, car de nouvelles troupes arrivent sans cesse, prennent position dans les tranchées creusées récemment dans le jardin du presbytère et les champs voisins. Elles en creusent aussi de nouvelles dans le cimetière. Des canons sont camouflés sous les grands arbres du parc du château.
En cette nuit du 6 au 7 juin, la plupart des maisons du village sont vides de leurs habitants qui, dès qu’ils ont vu les Allemands revenir, ont cherché à s’éloigner de la route nationale où le choc semblait devoir se produire. Il est d’ailleurs miraculeux que pour certains cet exode n’ait pas tourné à la tragédie. Je me souviens de la mère Poussard, l’aubergiste du « Bon Accueil » me donnant quelques jours plus tard sa version des événements sur le ton de son habituelle et imperturbable placidité : « Moi, j’voulais qu’on reste là pour garder la boutique et pas nous faire piller mais les filles avaient la frousse et Michel (son fils) était déjà parti. J’leur disais : mettez-vous à l’abri sous le billard, et priez la p’tite sœur Thérèse18Sainte Thérèse de Lisieux (Alençon, 1873 – Lisieux, 1897) : Sœur carmélite béatifiée en 1923, puis canonisée en 1925 par le Pape Pie XI, proclamée en mai 1944, patronne secondaire de la France par Pie XII. En Normandie, sa terre natale, Sainte Thérèse bénéficie d’une remarquable dévotion.. Mais elles voulaient pas rester. Alors on est partis à la ferme à Dancourt. Quand on a traversé le clos du presbytère, y’avait des Allemands d’un côté dans la tranchée et des Américains d’l’aut’ côté derrière la haie. Sûrement qu’i s’voyaient pas les uns les autres. Alors nous, on a passé dans l’beau mitan du clos, en l’vant les bras en l’air et en criant : “Civils, civils” »19 « Moi, je voulais qu’on reste là pour garder la boutique et pas nous faire piller mais les filles avaient la frousse et Michel (son fils) était déjà parti. Je leur disais : mettez-vous à l’abri sous le billard, et priez la petite sœur Thérèse. Mais elles ne voulaient pas rester. Alors on est partis à la ferme à Dancourt. Quand on a traversé le clos du presbytère, il y avait des Allemands d’un côté dans la tranchée et des Américains de l’autre côté derrière la haie. Sûrement qu’ils ne se voyaient pas les uns les autres. Alors nous, on est passés dans le beau milieu du clos en levant les bras en l’air et en criant : “Civils, civils”. » . Ô superbe inconscience du danger.
7 juin : Neuville dans l’enfer de la bataille
Autant qu’on puisse s’en rendre compte, il nous apparaît bien maintenant que les Américains ont été parachutés pour couper notre presqu’île entre la Madeleine, Sainte-Mère-Église, et Saint-Sauveur-le-Vicomte20La presqu’île du Cotentin sera en effet coupée le 18 juin lorsque les parachutistes arrivent sur la côte ouest.. Les Allemands occupent encore toute la partie Nord21Cherbourg ne sera libérée que le 26 juin. . C’est pour cela que les isolés tentent de remonter vers Montebourg et, ensuite, regroupés, et en force, redescendent pour éliminer les Américains concentrés autour de Sainte-Mère-Église. À Neuville, nous sommes aux premières loges pour assister aux va-et-vient et aux affrontements des deux armées.
Au matin du 7 juin, Neuville est donc aux mains des Allemands. Mais pendant la nuit, les parachutages américains ont continué. Les gens qui avaient fui le village pendant la nuit et qui rentrent comme si de rien n’était pour traire les vaches, voient toutes sortes de choses sur leur passage : un planeur s’est écrasé non loin de la Croix, en travers du chemin de la Fière ; la campagne est toute parsemée des taches multicolores des parachutes ; il y en a qui sont restés accrochés aux branches des arbres et qui se gonflent au souffle léger du vent. Spectacle plus triste dans le champ à Quertier. Un malheureux s’est tué en arrivant au sol. Le canon de son fusil lui est entré dans le côté causant une énorme blessure. Mais il n’en est pas mort sur le coup, car il est couché sur le dos, les mains jointes et, près de lui, sont étalées des lettres et des photos. Un jeune paysan prend le temps de s’agenouiller près du mort, de remettre papiers et photos dans la poche de son uniforme et de le recouvrir de la toile de son parachute ! !
Les Allemands, eux, ont installé un canon anti-aérien en bordure de la R.N. 13, braqué sur Sainte-Mère-Église. Écoutons la mère Poussard qui habite juste à côté nous dire comment elle a vu la chose : « Pensez, c’tait un p’tit canon gros comme rien. I z’étaient plus d’une douzaine à s’afforiller alentour. Entre deux de 1’faire péter, i v’naient chercher des bocks. J’avais beau leur dire rapportez les bocks vides, sinon la Agnès (de Montebourg), elle voudra pas m’en r’donner d’autres. I n’m’entendaient même pas. I s’sauvaient comme si z’avaient eu l’feu au derrière sans même ramasser leur monnaie. C’était pourtant pas avec leur mauvais p’tit canon de rien du tout qu’i pouvaient gagner la guerre »22 « Pensez, c’était un petit canon gros comme rien. Ils étaient plus d’une douzaine à s’affoler autour. Entre deux de le faire péter, ils venaient chercher des verres. J’avais beau leur dire de rapporter les verres vides, sinon Agnès, elle ne voudra pas m’en redonner d’autres. Ils ne m’entendaient même pas. Ils se sauvaient comme s’ils avaient le feu au derrière, sans même ramasser leur monnaie. C’était pourtant pas avec leur mauvais petit canon de rien du tout qu’ils pouvaient gagner la guerre. » .
Pendant ce temps-là, les Américains qui tenaient les abords de Sainte-Mère-Église, ayant repéré la pièce allemande et la dédaignant moins que la mère Poussard, arrosaient les alentours en cherchant à 1’atteindre. Si bien que la maison située juste en face de l’auberge et près du canon, s’était écroulée sous leurs coups. Comme je m’inquiétais de savoir si les habitants de cette maison avaient pu la quitter à temps, la mère Poussard me rassura : « I z’avaient eu l’temps parce que l’z’autres, i z’ont pas foutu la maison à bas du premier coup... »23 « Ils avaient eu le temps parce que les autres, ils n’ont pas foutu la maison à bas du premier coup… » .
Mais plus près de nous, dans la matinée, un roulement sourd fait tout à coup vibrer le sol. Cinq canons montés sur chenilles − j’ai su depuis que c’étaient des 88 autrichiens − défilent sur notre petite route, camouflés sous des branchages ; l’un d’eux se cache même sous la toile d’un parachute américain. Les engins passent et repassent comme à la recherche du bon endroit stratégique. Pourvu qu’ils ne s’installent pas près de chez nous. Je pense alors que, pour parer à toute éventualité, il est urgent d’organiser notre protection !
II n’y a à 1’école ni cave, ni abri, ni tranchée. Heureusement, les murs sont trapus et solides. Pour nous protéger des balles et éclats d’obus qui pourraient entrer par les fenêtres, nous dressons nos matelas contre celles-ci et nous en disposons quelques-uns en voûte au-dessus du canapé où sont assis mes grands-parents et ma tante. Nos valises sont prêtes, avec dedans ce que nous avons de précieux ou d’indispensable en cas d’évacuation précipitée.
Pendant ces préparatifs, la situation n’a cessé d’empirer. Claquements de balles, rafales de mitrailleuses déchirent l’air. Jetant un coup d’œil furtif en écartant un peu le matelas, je ne vois plus que des Allemands qui tirent, qui tirent. Signe certain que les Américains sont encore là, me dis-je pour me réconforter. Nous n’avons rien mangé depuis la veille, mais seul mon grand-père a faim. Il me serait impossible d’avaler quoi que ce soit, je ne sens ni faim, ni soif, ni fatigue. Vers la fin de la matinée, les gens de la ferme d’à côté, qui sont revenus traire leurs vaches, envoient à la faveur d’une accalmie leur commis nous porter du lait. Il nous donne des nouvelles de la bataille : il paraît qu’il y a beaucoup d’Allemands du côté du Port (c’est un hameau de Neuville qui se trouve de l’autre côté de la grande route, en bordure du marais, dans la direction de Fresville) mais que des nuées de planeurs continuent de descendre du ciel. Vrai, ou pas, mais comme c’est une bonne nouvelle, on ne demande qu’à y croire.
Au début de l’après-midi, la mitraillade a recommencé, beaucoup plus nourrie que le matin. Comble de malheur et d’inquiétude : un des 88 autrichiens se poste juste devant la barrière de l’école. Nous nous remettons sous matelas. Le maudit canon entre en action et tire sur Sainte-Mère. Je glisse un regard oblique par la fenêtre, les obus sont empilés sur l’engin ; j’en vois tout un gros tas. Un servant passe l’obus à un autre qui l’enfourne. J’entends le cliquetis de l’obus qui glisse dans la culasse, puis le coup part. Les artilleurs allemands se démènent comme des démons.
Mais voilà que les avions américains entrent dans la danse. Ce sont de ces petits avions qu’on appelle des mouchards d’artillerie. Ils passent juste au-dessus de la cour, et si bas qu’à un moment je distingue nettement une tête d’homme dans la carlingue. Chaque fois qu’il repasse au-dessus de la cour, d’invisibles mitrailleuses lui envoient un déluge de balles. Mais il paraît invulnérable, il redresse le nez et file sans riposter vers Sainte-Mère. Je l’admire mais je ne comprends [pas] son manège, ce qu’il cherche à faire. Je ne vais pas tarder à comprendre et à savoir.
Miaâouou... Baoum... Des vitres se brisent. Un obus vient de tomber très près. Pas un obus allemand. Ce sont les Américains qui répliquent. Leur petit avion passe et repasse et, dès qu’il est passé Miaâouou ... boum... C’est donc lui qui repère la position du canon allemand et dirige le tir. Gare à nous.
Je me blottis tout contre ma mère sous le matelas, je serre sa main dans la mienne. Ma petite chienne[,] d’ordinaire si turbulente, se serre elle aussi tout contre moi, immobile et silencieuse. Les miaulements d’obus se multiplient et se rapprochent. Il y a de moins en moins de temps entre le sifflement et l’éclatement. Chaque fois, nos épaules se courbent, nos muscles se bandent comme pour parer le coup.
Baououm ! Une assourdissante explosion. Je n’entends plus rien. L’obus est tombé si près que je ne l’ai pas entendu siffler. Revenue de mon premier instant de stupeur, je hasarde un coup d’œil par la fenêtre. La maison du père Dumont a disparu dans un nuage de poussière et de fumée. Un instant de silence... et je vois le père Dumont et ses trois gosses qui traversent la cour en courant. Ils entrent. Ils sont livides et tremblants. Nous nous dénichons de sous nos matelas pour les accueillir. Un obus vient de traverser leur maison.
C’est la panique dans le petit groupe. Maman dit des prières pour tromper son angoisse. Grand-mère fait prier les gosses : « Mon Dieu, protégez-nous ! Seigneur, ayez pitié de nous ! » Dès que la litanie se suspend sur les lèvres, je la relance, car, bien que je n’y croie guère, c’est le meilleur moyen pour dériver la peur des enfants et celle des adultes. « Sainte Marguerite, patronne de Neuville, protégez-nous... Ô Marie, conçue sans péché... » Les Allemands eux-mêmes semblent un peu affolés. Je les entends parler, marcher, courir. Certains entrent dans le couloir de la maison, montent au grenier, tirent par la lucarne. Ils ne nous voient même pas, nous jetant seulement au passage un regard furtif, un peu fou... Se sachant repérés, ils ont enfin déplacé leur canon. Trop tard, hélas pour nous !
La fenêtre s’ouvre violemment dans un fracas terrible où le bruit des vitres brisées n’est qu’une note légère dans l’épouvantable tumulte. La maison craque sinistrement, semble se disloquer sous l’effet d’un souffle infernal chargé de poussière et d’une odeur de poudre qui nous prend à la gorge. Je suis au-delà de la peur, dans un état second. Aucune sensation. Un vrai passage à vide. J’ai cessé d’exister. Quand on est tué sur le coup, j'imagine que c’est ainsi que l’on passe à l’éternité. Ma première sensation de retour à la vie est celle, tiède et humide, de la langue de mon petit chien qui me lèche le nez.
Nous ne pouvons mesurer tout de suite l’étendue des dégâts. Nous restons sous nos matelas, car la mitraillade a repris de plus belle. Quand elle s’apaise, dans la soirée et que nous commençons à sortir du chaos, nous constatons que la cour est jonchée de débris, que nos portes et fenêtres ont été arrachées, que les murs sont toujours debout et que les Allemands sont encore là.
La nuit du 7 au 8 juin : un soldat perdu de la Wehrmacht
C’est au soir de cette terrible journée que se produit une rencontre étrange, que pour ma part, je n’oublierai jamais. Tout à coup, la haute silhouette d’un jeune officier allemand se dresse dans l’embrasure de la porte. Son visage est livide et les rares cheveux qui dépassent de son casque sont collés à son front. Il claque des dents et est agité d’un tremblement qu’il ne parvient pas à maîtriser, il vient s’asseoir face à maman et à moi, et aussi face à la fenêtre. J’essaie de le faire parler, mais il n’a pas l’air de comprendre un mot de français. J’insiste, mobilisant les quelques mots d’allemand que je connais, pour engager le dialogue. J’interroge : « Américains kaput ? » De la tête, 1’Allemand fait signe que non. Je m’efforce de dissimuler ma satisfaction et, affectant un air dégagé, je continue : « Américains Sainte-Mère-Église ? » « Ya »24Transcription inexacte de l’adverbe d’affirmation allemand « ja »., répond 1’Allemand. J’insiste encore : « Américains here ? » Le jeune homme soulève les épaules comme pour dire qu’il n’en sait rien[.]
Il s’est peu à peu remis de sa frayeur ! II ôte son casque dont il me montre les bosses. Il se donne un coup de peigne et coiffe son bonnet de police. Il sort aussi ses gants de sa poche, et un paquet de cigarettes... américaines. Il m’en offre une que je prends et que je fume ; c’est la première et une des rares cigarettes que j’aie jamais fumées de ma vie, mais il est des moments où il faut absolument faire quelque chose pour se calmer.
Le voilà qui regarde intensément vers la fenêtre béante, les yeux fixes et l’oreille tendue. Moi, je n’entends que des claquements de mitrailleuses qui semblent se donner la réplique. Les unes tirent de vraies rafales à coups précipités : « Deutsch » dit 1’officier. Les autres ont des tac-tac plus nets, plus séparés : « Américain » précise-t-il. J’interroge : « Wieviel Meters ? »25« À combien de mètres°? ». J’apprends que les mitrailleuses américaines que l’on entend ne sont qu’à une centaine de mètres d’ici. Je jubile et je traduis à ma mère ce que je viens d’apprendre. Deux explosions successives dominent le bruit des balles et des obus. Puis, à un rythme régulier, des coups partent du côté de Beaudienville, village situé du côté de la mer au bout du chemin vicinal qui, partant de l’église de Neuville[,] passe devant le presbytère. L’Allemand que je ne quitte pas des yeux a tressailli. Je demande : « Was ist das ? »26« Qu’est-ce que c’est ? » − « Tanks américains » murmure-t-il.
Du coup, je me sens transportée d’allégresse en dépit des explosions qui se multiplient à 1’infini. L’espoir est revenu, les Américains sont là, tout près. L’Allemand comme nous, a l’air de s’attendre à les voir paraître d’un instant à l’autre. Mais lui, à quoi s’attend-il au juste ? Que compte-t-il faire quand ils vont arriver ici ? Depuis qu’il est là, on n’a plus vu d’Allemands aller et venir dans le couloir. Il semble être resté seul. À un moment d’accalmie, il s’est levé et est allé se promener dans la maison. On l’a entendu qui remuait les casseroles et la marmite dans la laverie comme s’il cherchait quelque chose à manger ou à boire. Puis, il est monté au grenier et il en est redescendu avec un fusil-mitrailleur à la main. Mais il ne le tenait pas du tout comme un homme prêt à s’en servir. Dès que ma vieille tante a aperçu l’engin qu’il avait d’abord posé contre le mur du couloir, elle lui a fait comprendre par gestes qu’il fallait le jeter dehors. Et lui, docilement, est allé le jeter dans le fossé de la haie du jardin.
Avec le soir, un calme tout relatif est revenu. Le danger semblant s’être écarté, nous quittons l’abri de nos matelas, mais nous en réajustons un dans l’embrasure de la fenêtre pour camoufler la lumière de la lampe à pétrole, moins sinistre que la veilleuse et les bougies. La petite Dumont a fini par s’endormir et mon grand-père ronfle dans la pièce d’à côté. Nous avons bien essayé de manger, mais c’est comme si nous avions la glotte bloquée, nous n’avons rien pu avaler de solide, tout juste réussi à boire un peu du lait que le petit commis de la ferme nous a apporté ce matin.
Il fait nuit maintenant et il y a au moins trois heures que l’Allemand est chez nous... avec nous. Des heures passent, presque étrangères à cette guerre qui est là, si près. C’est bizarre, mais notre Allemand est devenu si humainement proche de nous que je ne le ressens plus comme un ennemi. Je suis même certaine que du fond du cœur je souhaite qu’il ne lui arrive pas malheur et que, s’il m’était donné de faire quelque chose pour lui sauver la vie, je le ferais. Je réussis à comprendre qu’il s’attend à l’arrivée des Américains et à ce qu’ils le fassent prisonnier : il est désarmé, il me montre que le chargeur de son revolver est vide, il en a vidé les balles dans la marmite de la laverie quand il est allé faire son petit tour dans la maison.
Le bruit des mitrailleuses s’est éloigné, il n’est plus que spasmodique. La nuit est maintenant presque calme. Soudain, l’homme semble avoir pris une décision. Il m’explique qu’il va essayer de rejoindre les siens par des chemins qui le conduiront à Émondeville dans la direction de Montebourg en passant par Houlbecq, Saussetour, le Buisson. C’est bien de par là en effet que les Allemands tirent maintenant.
Notre « hôte » nous donne la poignée de main de 1’adieu, et, comme l’Américain de l’autre soir, il disparaît lui aussi dans la nuit, vers son destin.
La matinée du 8 juin : voici l’aube !
Enfin ! Jamais nuit de juin ne m’avait paru aussi longue. J’ai hâte de mettre le nez dehors pour voir si les Américains sont là, pour savoir aussi ce que sont devenus voisins et amis et ce qui reste de notre petit village.
Constats de désolation et d’horreur. La cour de l’école est jonchée d’un mélange invraisemblable de débris de toutes sortes. Une bicyclette projetée jusque là est éparpillée en pièces détachées, roues tordues par-ci, pneus déchiquetés par-là, garde-boue ailleurs, et quelque chose comme le cadre sur le toit du préau. Une masse sanglante me fait reculer avec un frisson d’horreur ; mais, réagissant vite, je m’approche. Ce n’est pas de la chair humaine. Par endroits, j’aperçois des touffes de pelage bai, c’est sûrement un des chevaux qui tiraient la guimbarde des Allemands. Un autre cheval, blessé celui-là, passe en hennissant de douleur. Le sang, qui a coulé en longs ruisseaux, s’est coagulé sur ses flancs.
La série des spectacles macabres ne fait que commencer. À la barrière de la cour, un soldat allemand se tient debout, un peu penché en arrière, comme s’il était en train de tomber à la renverse. Il est comme immobilisé dans sa chute, il tient toujours son fusil à la main. C’est bizarre ! Je me rapproche un peu de lui, je lui parle. Il ne répond pas, il reste là comme statufié. Je regarde de plus près : son visage est déjà vert. La rigidité cadavérique l’a saisi en pleine action, et si vite qu’il n’a même pas eu le temps de tomber.
Tout près de là, notre 88 autrichien d’hier n’est plus qu’un tas de ferraille. Un obus est tombé en plein sur le chariot à munitions. Le gros de la carcasse est affalé contre le talus de la haie, en travers du fossé. Tout le terrain alentour est encombré de débris : grosses chenilles arrachées, blindages tordus, armes et casques égaillés et, gisant parmi tout cela, une dizaine de corps, la plupart affreusement mutilés. À côté de l’un d’eux, des lettres et des photos : une petite maison avec des enfants qui jouent, une jeune femme. Çà et là, des pansements et des bandages maculés de sang. Je comprends la terreur du jeune officier qui s’était réfugié chez nous hier soir.
La ferme derrière l’école est à moitié détruite. La plupart des maisons sont endommagées : toitures percées comme des écumoires, vitres brisées. De grosses branches et même des arbres ont été cassés et gisent en travers du chemin. Dans les grands hêtres derrière lesquels, hier, le canon allemand s’était embusqué, des loques sont suspendues, projetées là-haut. Elles y resteront à pourrir tout l’été, tout l’hiver jusqu’à ce que leurs derniers haillons s’effilochent au vent de l’oubli.
Mais, apparemment, les Allemands ne sont plus là. M’avançant sur le petit chemin de l’école, je vois émerger de derrière les haies qui le bordent, de gros casques ronds, ceux des Américains. J’essaie d’engager la conversation avec les soldats, mais je les sens réticents, graves, méfiants. Des obus miaulent encore assez lointains mais dangereux quand même. Un soldat me dit et me fait signe de faire demi-tour et de rentrer.
Ce qui s’est passé cette nuit au château
Trois villageois que je rencontre alors me donnent un complément d’informations. Il n’y a pas eu de victimes dans la population de notre village. Mais les gens du château ont eu une nuit particulièrement mouvementée. Les Allemands, dont les canons continuaient de tirer sur Sainte-Mère-Église et de recevoir la réplique américaine, avaient de nombreux blessés. Ils ont fait du château leur infirmerie, déposé moribonds, mutilés et estropiés sur les canapés et les fauteuils. La table de la salle à manger, dont on avait mis les rallonges en prévision d’un repas de noces qui devait avoir lieu le samedi suivant, sert de table d’opération. Le sang dégoutte sur le parquet, sur les beaux tapis du salon aux tons rosés et bleus. Les rideaux des fenêtres sont descendus pour faire des garrots. À un moment, il y a tant de blessés sur la table qu’elle s’écroule avec toute sa charge humaine. La vaste demeure est toute emplie de cris et de gémissements.
Au milieu de tout ce branle-bas sanglant, un blessé pas comme les autres a attiré l’attention de quelques domestiques du château. C’était un Américain, un parachutiste, pas trop gravement « amoché »27Blessé.. Les Allemands, pressés par les urgences, l’ont laissé sur le palier du grand escalier. Assis juste en face de la grande baie, il pouvait voir tout ce qui se passait au dehors. « II écoutait, ont-ils raconté, attentif aux bruits comme s’il cherchait à en saisir l’origine et la nature. Son visage reflétait à la fois la souffrance et le plaisir. Quand on est repassés devant lui, après être allés chercher des provisions aux cuisines, il nous a fait, “en douce”, pour ne pas être vu de la sentinelle allemande, un geste de triomphe en nous désignant du doigt quelque chose dehors, qu’on n’a pas eu le temps de voir car la sentinelle s’est retournée. » Ce quelque chose, c’était l’arrivée des tanks américains, dont notre Allemand à nous avait aussi perçu l’approche.
Ils arrivaient en effet par le chemin de Beaudienville. Plus d’une douzaine, en file indienne, faisant feu de tous leurs canons, détruisant les 88 autrichiens qui restaient. Pour les Allemands du château et de Neuville, ç’avait été le signal d’un repli précipité en direction d’Émondeville et de Montebourg. Le matin du 8, au château réoccupé par les Américains, ce sont maintenant les blessés allemands qui sont prisonniers. Leur médecin-major est resté avec eux, soignant avec un égal dévouement les uns et les autres.
L’après-midi du 8 juin : l’exode des Neuvillais vers Écoqueneauville
Nous croyions la bataille définitivement terminée dans notre secteur. Les Américains, de plus en plus nombreux, consolidaient leurs positions sur le terrain reconquis. Nous avions l’impression que notre vie allait presque pouvoir reprendre son cours habituel, que maintenant, la guerre, c’était l’affaire des autres, plus loin.
Mais voilà que vers le début de l’après-midi, deux Américains viennent nous dire que nous devons quitter la maison car ils ont miné les champs tout autour en prévision d’une contre-attaque allemande. J’essaye de les convaincre qu’avec trois enfants et trois personnes âgées, il est bien difficile de s’en aller. De s’en aller où d’ailleurs ? Le soldat m’explique en anglais qu’ils ne nous forceront pas à partir, mais que ce serait une folie de rester là. Il m’indique un itinéraire vers Sainte-Mère-Église : pas par la route nationale encore balayée par l’artillerie allemande, mais à travers champs, le long des haies, ni trop près ni trop loin. Il m’explique où sont posées les mines dans le champ d’en face que nous devrons d’abord traverser. Il ajoute : « Je vous confie là un secret militaire ».
Il faut donc partir. À la hâte, nous rassemblons quelques vêtements ; les valises étaient heureusement déjà préparées à toutes fins utiles. Mon grand chien gambade joyeusement croyant qu’on l’emmène en promenade : « Tenez-le bien, dit l’officier, qu’il n’aille pas faire sauter une mine et vous faire sauter avec et marchez en file indienne, à une certaine distance les uns des autres ».
J’ouvre la marche avec mon grand chien. Maman me suit. Derrière, viennent les enfants Dumont, le gamin d’abord, puis la grande sœur tenant la petite par la main. Puis, ma vieille tante tenant la petite chienne en laisse, puis ma grand-mère. Enfin, fermant la marche, le père Dumont et mon grand-père avec ses quatre-vingt-quatre ans. Chacun, même la toute petite fille, porte un bagage à la mesure de ses forces. L’angoisse et la tristesse qui nous étreignent, le désir de trouver au plus tôt et au plus court un refuge nous rendent presque insensibles aux horreurs que nous côtoyons.
Des troupeaux entiers gisent dans les champs, répandant une odeur pestilentielle. Les ventres gonflés comme des outres sont la proie d’essaims de mouches qui grouillent sur les déchirures de la chair. Un cheval éventré agonise dans l’herbe souillée de son sang. Un jeune poulain hennit tristement en essayant de téter sa mère morte. Des vaches qui n’ont pas été traites meuglent sinistrement. J’essaie de détourner mes regards. Je ne veux plus voir ça. Nous marchons comme dans un cauchemar, aussi vite que le permettent les jambes du vieux grand-père et celles de la petite Dumont. Tout à coup, en sautant une brèche, je sens quelque chose de mou sous mes pieds et, comme je me retourne pour tendre la main à ma mère, j’aperçois deux cadavres dans le fossé. Je viens de sauter dessus sans les voir.
Voici un petit groupe de maisons. On va peut-être pouvoir y faire une petite halte. Mais la bataille est passée par là aussi. Les maisons sont désertes. Dans l’une, la table encore servie nous donne à penser que les gens sont partis précipitamment, ce qui n’est pas fait pour nous rassurer. Un Allemand est étendu à plat ventre devant une porte. Partout autour, des cadavres de soldats, de volailles, celui d’un petit chien. Et de temps en temps, des tirs passent encore au-dessus de nous.
Un autre village est en vue, celui de Beauvais. On s’y achemine péniblement. Même spectacle de désolation : maisons vides, bêtes mortes. Mais des voix humaines à l’accent de chez nous dissipent le cauchemar. C’est un groupe de paysans qui reviennent chez eux pour prendre des choses utiles ou précieuses, traire les vaches et soigner les bêtes. Dès le travail fini, ils vont repartir vers Écoqueneauville. « Par là-bas, disent-ils, il y a beaucoup d’Américains, il en débarque sans cesse. On est plus en sécurité qu’ici ». Et ils nous conseillent de les suivre. Je ne sais plus trop par où aller vers Sainte-Mère, je pense qu’il est plus prudent et plus rassurant de rester en contact avec d’autres, et à ma petite troupe, j’ordonne : « Allons-y. Suivons. »
Suivre les gens, c’est facile à dire, mais la plupart sont relativement jeunes et la peur leur donne des ailes. Pour nous autres, avec les enfants et les vieux, c’est une autre affaire. Bientôt, nous sommes à la traîne, et si bien distancés qu’on ne voit même plus les autres, ce qui pose le problème du chemin à prendre, car j’ai du mal à repérer la direction d’Écoqueneauville. Nous avançons au juger, de plus en plus lentement. Mon grand-père et la petite Dumont demandent souvent si nous sommes bientôt arrivés. Finalement, mon pauvre vieux qui est à bout de forces se laisse tomber et nous dit : « Continuez sans moi, vous reviendrez me chercher demain ». Bien entendu, il n’est pas question de le laisser là tout seul. Je pars en reconnaissance dans les alentours avec 1’idée de trouver dans une ferme une brouette pour transporter grand-père. Et par chance, je trouve bien mieux qu’une brouette : une carriole, celle du neveu de la mère Poussard, qui se trouve dans ces parages. Mon histoire de brouette le fait éclater de rire. Il a vite fait d’atteler et nous ne tardons pas à retrouver notre petit monde qui ne nous attendait pas de sitôt et est tout ébahi de me voir revenir en cet équipage. Les deux petites filles montent avec les grands-parents et les bagages. Maman et moi, nous reprenons à pied le chemin d’Écoqueneauville, avec le reste de la troupe et les deux chiens.
9-10-11 juin : réfugiés
Écoqueneauville, petite commune de cent et quelques habitants, accueille à ce moment-là beaucoup de réfugiés venus de Sainte-Mère-Église et des alentours. Les gens nous reçoivent avec une incroyable cordialité, et la chaleur de l’accueil nous fait oublier la tristesse de l’exode. L’institutrice nous invite, ma mère et moi, à loger chez elle. Elle a même un cellier pour notre chien. Le père Dumont et ses trois gosses logeront chez le fermier qui nous a si bravement véhiculés jusqu’ici. Grand-père et grand-mère auront un bon lit chez un couple à l’autre bout du village. Ma vieille tante logera tout près d’eux chez une dame qui est seule avec sa fille. Comme nous sommes à la campagne, le ravitaillement ne manque pas. On nous rapporte « à gogo »28En abondance. œufs, lait, cochon et, à défaut de pain, galettes de sarrasin.
Après nous être restaurés, nous espérons pouvoir nous reposer, dormir un peu. Douce illusion. Le village grouille d’Américains et, sans cesse, les troupes qui montent en ligne défilent le long de la route qui vient de la mer. Dans les champs de pommiers les munitions s’entassent, camouflées sous les arbres. La nuit venue, à peine venons-nous de nous coucher qu’un bourdonnement d’avions vient troubler le silence. Aussitôt, la D.C.A.29 Défense contre avions. américaine postée tout près de nous se déchaîne. La maison d’école vibre de partout comme si elle allait s’écrouler sur nous.
D’un bond, 1’institutrice et ses deux enfants, maman et moi, nous nous sommes levés et habillés à la hâte, n’importe comment tellement la panique brouille les choses et les gestes. « Essayons d’aller à la ferme d’en face, dit ma collègue, ils ont un abri solide sous leur escalier ». Comme nous traversons le chemin qui y conduit, nous voyons avec épouvante un avion en feu qui descend au-dessus de nos têtes. Un instant, nous avons l’impression qu’il va tomber sur nous. Mais non, il s’abîme dans un champ voisin, explose et achève de brûler. Tout cela, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Nous traversons la cour de la ferme. Il faudrait courir, mais maman[,] qui a enfilé dans sa précipitation les grandes babouches de l’Allemand qui avait logé à l’école, a de la difficulté à marcher avec. Les rafales sont si violentes qu’un moment nous nous couchons sous une grande charrette dans un hangar de la ferme. Mais l’abri n’est pas sûr. Un dernier bond nous amène enfin à la porte de la maison. Nous frappons à coups précipités : « Ouvrez, ouvrez vite ! » La porte s’ouvre aussitôt. Ouf ! une fois de plus, sauvés !
Dans la grande salle de la ferme, les fermiers ont étendu tous leurs matelas par terre. Il y a là une bonne douzaine de personnes réfugiées des alentours en plus des gens de la maison qui ont déserté les chambres de l’étage. Il y a aussi un petit lit-cage dans lequel est couchée une vieille dame de 90 ans. Sa fille, qui en a 70, est couchée à côté d’elle. La vieille dame n’a aucune notion de ce qui se passe, ni du tragique de la situation. Quand la mitraillade est plus nourrie, tout le monde s’entasse sous le fameux escalier. Alors la vieille dame n’est pas contente du tout d’avoir à se lever. Et comme les gens parlent haut, elle se fâche et dit : « Taiz’vous, i’ vont v’z’entendre ! »30 « Taisez vous, ils vont vous entendre ! » . Malgré notre frousse, ça nous fait rire. La frousse en effet, nous l’avons et nous faisons un généreux usage du seau hygiénique destiné à la vieille dame. Elle proteste : « Dire qu’i viennent tous faire dans mon pot ! Ça va senti mauvais... I pourraient tout d’même ben aller faire leur affaire dehors... Où j’vas fer, me, quand mon seau va ietr’ plein ? »31 « Dire qu’ils viennent tous faire dans mon pot ! Ç a va sentir mauvais… Ils pourraient tout de même bien aller faire leur affaire dehors… Où je vais faire moi, quand mon seau va être plein ? » . Comment ne pas rire, malgré l’arsenal qui est là tout près sous les pommiers et qui peut sauter à la première bombe allemande ?
Chaque nuit, pendant notre séjour à Écoqueneauville, il va en être à peu près de même, les avions allemands continuant de menacer. Heureusement, les journées sont plus tranquilles. Il y a plein d’Américains et je suis mobilisée à leur servir d’interprète. Il y a ceux qui sont chargés de repérer les cadavres, que d’autres viendront enlever dans des camions pour les emmener au cimetière militaire qu’ils ont ouvert près de Sainte-Mère-Église. Les paysans m’expliquent où il y en a, et moi, j’y conduis les Américains. On dénombre chaque jour de nouveaux cadavres dans la campagne. C’est souvent l’odeur qui nous conduit vers eux. Certains ont succombé à d’horribles blessures. Quelquefois, le mort a l’air de dormir. À un endroit, près d’une maisonnette isolée, un Américain et un Allemand sont morts l’un en face de l’autre ; ils sont adossés aux talus des haies, de chaque côté du chemin. Ils tiennent encore leur arme. Ils ont dû s’entretuer en même temps.
Quand les Américains arrivent, ils fouillent le mort ; le tournent et le retournent, lui enlèvent montre, bagues, argent, papiers, ramassent le tout dans un petit sac, lisent la plaque d’identité et écrivent le nom du mort sur le paquet de ses reliques. Dans quelque temps, là-bas, en Amérique, une femme, des parents, des enfants, sauront qu’ils ne reverront jamais leur G.I.32Selon l’Oxford English Dictionary, il s’agit de l’abréviation de G overnment (or G eneral) I ssue : nom générique donné aux soldats américains. C’est ça la mort, c’est ça la guerre.
Et nous, au milieu de tout ça, on est un peu comme en vacances. Le temps est merveilleux et la nature en fête semble se moquer éperdument du carnage. À cette époque de 1’année, toute la campagne est un foisonnement de verdure et de fleurs, et les oiseaux peuplent les frondaisons neuves de leur joyeuse multitude. Les gens du village, et surtout les réfugiés qui n’ont rien à faire, naviguent dans cet incroyable décor. Décontracté, on se promène, on bavarde, chacun racontant ce qu’il a vu ou entendu, ce qu’il sait, ou croit savoir. On va en pèlerinage aux endroits où il y a eu de la bagarre, chacun exposant ses idées sur la stratégie du combat.
12 juin et jours suivants : retour à Neuville
La bataille s’est maintenant assez éloignée pour que nous puissions envisager notre retour à Neuville, chez nous, avec, il est vrai, cette angoissante interrogation : avons-nous encore un « chez nous » ?
Le neveu de la mère Poussard, qui nous a déjà été si secourable, renouvelle son service pour reconduire nos vieux en carriole. Le père Dumont, qui est journalier, a trouvé de l’embauche à Écoqueneauville et y reste avec ses trois gosses. C’est pour le moment ce qu’il a de mieux à faire, car sa maison est en piteux état. Ma mère et moi, nous repartons à pied avec d’autres réfugiés qui s’en retournent vers Sainte-Mère-Église. Après Sainte-Mère, il n’y a plus que nous deux comme civils à cheminer sur la berne33Bas-côté de la route, en patois normand, d’après le Dictionnaire du français régional de Basse-Normandie de René Lepelley. de la grande route continuellement sillonnée par les convois militaires. Bien que, parfois, les soldats nous interpellent cordialement, nous éprouvons l’angoisse de notre solitude. L’arrivée à Neuville y met fin, et l’immense soulagement de retrouver 1’école debout et de nous y retrouver ensemble.
Maintenant c’est ici, à Neuville, qu’il arrive des réfugiés, en particulier ceux qui ont fui Montebourg brûlé34Sur la route de Cherbourg, Montebourg revêt un rôle primordial dans la bataille pour accéder au Nord Cotentin. Plusieurs bombardements frappent la bourgade, notamment les 8, 10 et 12 juin. Bombes au phosphore et obus de marine font de Montebourg un brasier. Si quelques habitants se réfugient dans l’abbaye, beaucoup quittent leurs caves pour trouver le chemin de l’exode.. Nous apprenons que Valognes aussi a été en grande partie détruite, et qu’il y a énormément de victimes civiles35Trois bombardements les 6, 7 et 8 juin anéantissent Valognes, le « petit Versailles normand ». Les charmes de la ville sont réduits en poussière. Près de 300 morts seront à dénombrer.. Dans les journées qui suivent notre retour, la vie se réorganise au milieu des troupes américaines, dans un tissu de vraies et de fausses nouvelles. Sur la grande route passent souvent des camions chargés de morts[,] enveloppés dans des linceuls maculés de sang, macabres paquets sinistrement ballottés aux chaos de la route.
C’est que la bataille est toujours très rude un peu plus loin. Par Utah-Beach36Nom de code donné à la première plage de débarquement vers l’ouest., les Américains reçoivent continuellement des renforts en matériel et en hommes. Ils consolident et élargissent leur tête de pont de Sainte-Mère-Église en direction de Jourbesville, Saint-Sauveur-le-Vicomte, la Haye-du-Puits. À partir du 19 juin, ils attaquent dans la région de Montebourg pour accentuer leur pression vers Cherbourg, qui va tomber entre leurs mains le 24 juin37Les Américains arrivent sur les hauteurs de Cherbourg dès le 23 juin. Deux jours plus tard, le 25, des combats se déroulent en ville. Le général von Schlieben et l’amiral Hennecke capitulent le 26, sans ordonner à leurs troupes, retranchées, un cessez-le-feu général. L’arsenal résistera jusqu’au lendemain..
Nous descendons souvent à l’auberge de la mère Poussard. C’est en effet un vrai bureau de journal, quelquefois même, les nouvelles y sont affichées. C’est chez elle que je suis amenée à reprendre mon rôle d’infirmière occasionnelle. Sa bru a reçu, au cours d’un bombardement qui a tué sa mère et son frère, un petit éclat d’obus dans la cuisse. J’en parle à un major américain qui fait une halte à l’auberge. Il me donne un petit sachet de poudre blanche à mettre sur la plaie. Produit miracle, encore inconnu de nous : la pénicilline. « Faites-lui des compresses, a dit le major, jusqu’à ce que l’éclat soit prêt à sortir ». Je pose des compresses. J’extrais des lambeaux de chair avec une pince à épiler. Mais l’éclat, lui, s’accroche obstinément. Je le sens à fleur de peau. Alors, avec un canif bien aiguisé et soigneusement flambé, m’improvisant chirurgien, je fais une petite incision en forme de croix. Et l’éclat sort enfin, avec du sang et du pus. Il ne reste plus qu’à désinfecter à plein alcool, sans me laisser impressionner par les gémissements de la patiente, puis à saupoudrer avec la poudre blanche de 1’Américain. Le lendemain, la jeune femme peut marcher, et la plaie commence déjà à se cicatriser.
Ainsi, de jour en jour, à mesure que la guerre s’éloigne, les jours vont perdre un peu de leur densité historique, et nous un peu de la fièvre d’héroïsme que nous avaient donnée la proximité du danger et la nécessité d’y faire face. Nous nous installons pour des mois dans un genre de vie un peu particulier, une sorte d’Occupation encore, non plus celle de 1’ennemi, mais celle de nos alliés, de nos libérateurs. Il n’est pas sans intérêt d’évoquer cette « cohabitation » d’un nouveau genre.
Quelques « effets secondaires » du passage des troupes américaines dans nos campagnes
La présence des troupes américaines dans notre secteur va perturber quelque peu les mentalités de notre paysannerie normande. D’autant que les « occupants » sont des amis, des libérateurs et que nous n’avons pas à garder les distances avec eux.
Un hôpital de campagne est venu dresser ses tentes dans le champ en face de 1’école. Le plus gros de la clientèle des médecins américains est fait d’accidentés de la route et de victimes, civiles et militaires, des engins explosifs. Les gens du village profitent aussi occasionnellement de soins gratuits, ce qui crée des liens amicaux. Plus d’une fois, il m’arrive d’envoyer aux Américains des gens de la campagne avoisinante que j’ai découverts au cours de mes tournées de piqûre à domicile. Comme nous sommes toujours en vacances, je vais souvent à l’hôpital pour servir d’interprète, ou tout simplement pour bavarder, ce qui me permet de me familiariser avec l’anglais et avec 1’accent américain. Souvent même, un des médecins, personnage sympathique d’origine italienne et de surcroît violoniste, vient passer la soirée à la maison.
Je viens d’évoquer les victimes civiles des explosifs. Une des originalités du moment, ce fut en effet 1’abondance des « objets trouvés » d’un genre un peu spécial : fusils, pistolets, mitraillettes, grenades, petites bombes à ailettes, etc. Il y avait de tout dans les champs, les haies, les fossés. Que de tentations pour nos gamins, et même pour les adultes. Je me rappelle un voisin rentrant chez lui avec un chapelet de grosses cartouches jaune pâle ressemblant à s’y méprendre à celles qui servent à soufrer les barriques. C’est d’ailleurs ce qu’il comptait en faire, tout fier de sa découverte. « Imbécile ! lui criai-je, vous ne voyez donc pas que c’est de la dynamite ».
Un autre effet très particulier de la situation, c’est ce que j’appellerais la banalisation de la mort et plus précisément du cadavre. On en avait tant vu et il en restait tant les premiers jours disséminés çà et là qu’une sorte d’accoutumance nous insensibilisait. Je me souviens d’un garçon de 14 ans d’un naturel doux et sensible, qui, m’accompagnant à Écoqueneauville, montrait une sorte d’excitation morbide à ces macabres découvertes, m’appelant pour me faire remarquer telle ou telle expression en laquelle le visage d’un mort s’était figé.
Tout près de chez nous, le long du champ qui fait l’angle entre la route nationale et notre chemin, j’avais remarqué que ça sentait très mauvais à un certain endroit. Je devinais trop aisément ce que ça pouvait être mais je n’avais pas le courage d’aller voir de l’autre côté de la haie. Un jour, j’aperçois là deux de mes garnements qui m’interpellent au passage : « Mademoiselle, y a un Boche dans le fossé ! » L’un lui a déjà pris son porte-monnaie et ils essaient de lui tirer son portefeuille. Ils m’apprennent qu’un troisième a déchaussé le mort et qu’il est parti laver les godasses, car il y avait plein d’asticots dedans.
Je me souviens aussi de Pecata, le fossoyeur, que j’entendais un jour « jurer » derrière la haie d’un champ, près de l’église. Je m’approche, intriguée, et je le vois un pied sur le ventre du cadavre d’un Allemand, arc-bouté sur son autre jambe. Il essaie, des deux mains, de débotter le mort. Ma présence ne le dérange pas le moins du monde et il me dit, tout en continuant à faire effort pour parvenir à ses fins : « Dire qu’il a les pieds raides, c’con-là ! J’arrive pas à l’décauchi »38 « Dire qu’il a les pieds raides ce con-là ! J’arrive pas à le déchausser. » .
Comme on le voit, l’accoutumance à la mort amène un sous-produit peu ragoûtant : le pillage des cadavres. Un de mes voisins, homme riche pourtant, qui a été requis pour creuser des tombes, en revient un soir avec deux paires de godasses suspendues à son cou par les lacets. Il les a récupérées sur les morts. Il me montre d’un air satisfait comme elles sont belles, en vrai cuir et presque toutes neuves. Cynisme ou inconscience, cupidité ou bêtise, je ne sais.
Corollaire fréquent de ce genre de pillage : le troc. Il s’est fait pas mal de petits marchés « noirs » pendant ces mois. Même mes élèves, quand l’école fut recommencée, séchaient parfois la classe pour aller rôder autour des cantonnements. Par curiosité certes, mais aussi en quête de ceci ou de cela. C’est que les soldats de la riche Amérique offraient tant de choses inédites ou dont les restrictions de guerre nous avaient privés. En échange, nous avions un or liquide dont les effets furent plus d’une fois désastreux : le calvados.
Le choc le plus rude par rapport à nos mœurs austères ou du moins réservées et discrètes en matière de sexualité, ce fut la découverte d’un débridement sexuel pas du tout discret.
Sous des formes brutales. Il y eut des viols, des agressions, avec les troupes de choc cantonnant et circulant un peu partout, il n’était pas prudent pour une femme ou une fille de se hasarder seule dans des endroits isolés39Il est bien difficile de quantifier les brutalités commises par les troupes alliées à l’encontre des Normands. D’une part, toutes les victimes ne portent pas plainte et d’autre part ces affaires judiciaires sont parfois étouffées, or les autorités recensent uniquement les cas sanctionnés par les tribunaux. Michel Boivin avance dans ses travaux, pour le département de la Manche et sur toute la période de la guerre, le nombre de 208 viols, et environ 30 meurtres, commis par des membres des troupes américaines sur la population normande. . J’en fis un jour l’expérience plutôt comique, après coup. Sur le chemin entre l’église et le château, j’aperçois un Américain en tenue d’aviateur, veste de cuir doublée de mouton. Il paraît s’affairer autour d’une bicyclette posée contre un arbre. Il m’interpelle et, sans se retourner, me fait signe d’approcher. Tenant ma chienne en laisse, car elle peut parfois être agressive, je m’approche pensant que l’homme a besoin d’un renseignement. Aussitôt, il fait volte-face et m’exhibe son sexe. Mais à l’instant même, ma diablesse de chienne bondit vers l’objet tous crocs dehors avec un aboiement féroce, une vraie furie ! J’ai tout juste le temps de tirer sur la laisse pour qu’elle ne morde pas à « l’appât », qu’elle a bien failli happer dans son élan. Et je me sauve aussi vite que je peux, malgré mon sacré animal qui continue d’aboyer, décidément très excité par la chose que l’autre s’est pourtant empressé de rengainer.
Découverte d’un autre genre ! Voilà qu’un matin, une voisine, la vieille Hortense, arrive chez nous toute bouleversée. Elle vient de voir sa bique, sa pauvre bique, se faire violer plusieurs fois de suite par un groupe de soldats : « La pauv’ bête elle en est restée toute saoule et toute assotie40Assoter ou assotir : verbe rare et familier désignant l’action de rendre sot. » dit Hortense, et elle ajoute outrée : « Et c’était même pas des noirs ! » Mot terriblement révélateur d’un racisme inconscient dont j’eus maintes fois l’occasion de constater l’existence : seuls des noirs pouvaient faire des choses comme ça. On leur collait sur le dos tous les méfaits de la troupe. Racisme que pouvait renforcer d’ailleurs celui, brutalement conscient, de certains G.I [’s] blancs, comme ceux qui, un jour, de leur Jeep, accablèrent d’injures deux infirmiers noirs avec lesquels je bavardais à la barrière de l’école.
La licence des mœurs adoptait aussi des formes moins brutales, plus classiques, si j’ose dire. En attendant que des « professionnelles » leur arrivent des grandes villes, ces messieurs chassent dans nos campagnes. Un jour, une ambulance américaine s’arrête devant le bistrot de la mère Poussard. Comme elle ne comprend pas ce qu’ils veulent, elle leur fait signe de s’adresser à moi qui suis dehors à bavarder avec une de ses filles. Ils m’expliquent qu’ils cherchent des « femmes pour le plaisir ». À part deux bonnes femmes qui ont bien servi les Allemands, je ne vois rien à Neuville qui puisse les satisfaire. Ils insistent : peu leur importe de prendre la succession des Allemands ! Ils m’obligent à leur fournir un petit croquis de l’itinéraire à suivre, et comme je traîne un peu, l’un d’eux frappe du pied en me disant : « Dépêchez-vous, ça presse ! » Je crois que j’en ai rougi jusqu’à la racine des cheveux.
Inutile de dire que ces « libertés »[,] prises par nos libérateurs a priori sympathiques, ne pouvaient que susciter l’intérêt et la curiosité des grands gosses du coin. Je le vis bien quand, les vacances terminées, je retrouvai mes élèves (ceux du moins qui revenaient, car, pour d’aucuns, les chocolats, les cigarettes, le café, le cinéma des Américains étaient bougrement plus attrayants que la règle de trois41Règle de mathématiques. D’après la définition du Robert, il s’agit d’une « méthode par laquelle on cherche le quatrième terme d’une proportion quand les trois autres sont connus. » et l’orthographe d’usage). Certains avaient vite fait de détecter dans la campagne les bergeries isolées, les cabanons en planches couverts de tôles qui, faute de mieux, faisaient office de bordels à soldats. Et mes loustics, à pas de loups, d’aller coller leur œil à l’interstice des planches pour... voir. Une conversation entre deux d’entre eux, surprise dans les cabinets, me révéla qu’ils avaient vu beaucoup de choses et que leur éducation sexuelle, si l’on peut dire, en avait été drôlement enrichie.
Une autre fois, à l’heure de la récréation, je vois des gamins qui soufflent à qui mieux mieux dans des sortes de ballons. C’étaient des capotes anglaises. Il en traînait un peu partout dans les champs ainsi que diverses pièces des panoplies « préservatives ». J’ordonne aux souffleurs de jeter leurs ballons et je leur raconte que ça peut leur éclater à la figure et les rendre aveugles. Les petits écoutent mon boniment et me croient. Mais je vois le grand Lucas qui prend un air rigolard. Pour éviter la contradiction, où je risque d’être embarrassée, je l’expédie vigoureusement avec une paire de claques.
Ainsi s’estompait au fil des jours l’enthousiasme avec lequel j’avais accueilli la Libération. Ainsi s’effritait peu à peu mon petit code de valeurs morales, un peu naïf, il est vrai, un peu fleur d’oranger. Certains jours, tout me semblait pourri, perverti. Mais c’était sans doute pour moi le passage à la maturité. La guerre, avec tout son cortège de désordres et de terreurs[,] me faisait connaître l’humanité telle qu’elle est, pire ou meilleure qu’elle n’apparaît. J’ai vu un fier-à-bras du village, très fort en gueule, abandonner femme et enfants sous le bombardement et détaler comme un lièvre couard si vite qu’il en perdait ses sabots. Mais j’ai vu aussi ma vieille tante Rosalie qui avait passé sa vie à avoir peur de tout et de rien, et qui ne supportait même pas la vue d’un couteau pointu, se placer vaillamment devant moi pour me couvrir de son corps à un moment où le mitraillage de l’école était particulièrement inquiétant. Il y a des situations où les instincts les plus refoulés se débrident et [des situations] où les qualités les mieux cachées se dévoilent : chez des gens apparemment tout ordinaires, [se dévoilent] d’incroyables générosités ou les plus basses cupidités et lâchetés. [Il y a des] situations qui démasquent les déserteurs et font surgir les héros.
- 1. Surnom attribué aux soldats allemands, en référence à la couleur de l’uniforme de la Wehrmacht.
- 2. L’auteur fait ici référence au discours radiophonique du maréchal Pétain qui le 17 juin 1940 annonce, trois jours seulement après l’entrée des Allemands dans Paris, que le gouvernement, formé la nuit précédente, va demander l’armistice. La célèbre allocution, « c’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat », sera suivie, quelques heures après, de l’appel lancé par le général de Gaulle, le 18 juin 1940.
- 3. Diffusé sur les ondes de la B.B.C. le 18 juin 1940 depuis Londres, l’appel lancé par le général de Gaulle n’est que très peu écouté le jour même à la radio. Le bouche à oreille et la presse permettront de diffuser plus largement le message à la population française.
- 4. Cherbourg subit un bombardement de la flotte britannique dans la nuit du 10 au 11 octobre 1940.
- 5. Le 24 juillet et le 30 septembre 1941, la ville est touchée par les bombes anglaises, causant la mort de nombreux Cherbourgeois et détruisant certains bâtiments, notamment dans la rue Tour Carrée le 30 septembre.
- 6. Femmes, enfants et personnes âgées sont touchés par ces mesures d’évacuation qui entrent en vigueur en 1943.
- 7. Une zone interdite (zone côtière s’étalant sur une dizaine de kilomètres) est instaurée par les autorités allemandes, notamment sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique. Après avoir fait évacuer les femmes, enfants et personnes âgées de l’agglomération de Cherbourg, c’est l’ensemble de la population jugée non-utile pour les Allemands qui sera évacuée dès le mois de mars 1944. Ces « inutiles », comme on les surnomme à l’époque, seront par la suite rejoints par une large part de la population qui était restée dans la ville, craignant les bombardements qui s’intensifient au cours du printemps 1944.
- 8. Le 2 novembre 1942, les Britanniques l’emportent sur les armées allemandes et italiennes à El-Alamein.
- 9. Ces Géorgiens, servant comme auxiliaires dans l’armée allemande, forment le 795e bataillon de la 709e division d’infanterie. Ce bataillon a notamment en charge la défense d’une des plages de Sainte-Marie-du-Mont, située à quelques kilomètres de Neuville-au-Plain.
- 10. Ce nom d’« asperges de Rommel » ou « asperges à Rommel » est donné par la population locale qui, requise par les autorités allemandes, se voit donc contrainte de hérisser des pieux, sur des terrains susceptibles d’être employés comme zone d’atterrissage par les Alliés.
- 11. Les batteries côtières situées sur la commune de Saint-Martin-de-Varreville (quatre canons) subiront plusieurs attaques, notamment la veille du Débarquement, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
- 12. Avant même le début des grandes opérations militaires en Normandie, les Allemands, conscients de l’importance des écoutes, notamment celle de la B.B.C. par les résistants, ordonnent que tous les postes de T.S.F. (Téléphonie sans fil) soient déposés en mairie. Ainsi, dès mars 1944, les civils se voient dans l’obligation de remettre leurs postes.
- 13. Le rassemblement de la France Libre naît autour du général de Gaulle dès juin 1940. Les membres de l’organisation, dont le centre névralgique est établi à Londres, s’organisent dans l’optique d’aider les Alliés au combat. Ainsi, ils se joindront à ces troupes en Afrique, en Italie puis en Normandie lors du Débarquement.
- 14. Terme utilisé à la fois par les Anglais, Américains et Allemands pour évoquer les opérations militaires du 6 juin.
- 15. La 82e aéroportée et la 101e aéroportée américaines seront parachutées près de Sainte-Mère-Église, Saint-Côme-du-Mont, Picauville. 13.000 hommes sont ainsi embarqués dans 832 appareils afin de s’emparer de routes clés (telle la Route Nationale 13), détruire les ponts, faire sauter la voie ferrée allant vers Carentan et annihiler quelques batteries côtières. Ceci dans le but d’empêcher les renforts allemands d’arriver et de sécuriser la zone de débarquement. En 1969, le département des Basses-Pyrénées change de nom pour devenir le département des Pyrénées Atlantiques.
- 16. Les parachutages furent d’une grande imprécision en raison notamment du mauvais temps qui sévissait sur la région et de la prudence des pilotes. Certains parachutés se retrouvèrent parfois à une trentaine de kilomètres de la zone d’atterrissage prévue.
- 17. Dénomination péjorative désignant l’Allemand. Ce mot, employé dès la seconde moitié du XIXe siècle, est difficilement explicable d’un point de vue étymologique. Possible aphérèse d’« alboche », mot plus ancien précédé du préfixe « al- » pour Allemand. L’expression « tête de boche », utilisée dans l’argot du XIXe siècle, désigne une personne à la tête dure, en référence à cette boule de bois, la boche, que l’on jette dans certains jeux de quilles notamment. « Boche » pourrait être aussi le diminutif de « caboche », désignant la tête.
- 18. Sainte Thérèse de Lisieux (Alençon, 1873 – Lisieux, 1897) : Sœur carmélite béatifiée en 1923, puis canonisée en 1925 par le Pape Pie XI, proclamée en mai 1944, patronne secondaire de la France par Pie XII. En Normandie, sa terre natale, Sainte Thérèse bénéficie d’une remarquable dévotion.
- 19. « Moi, je voulais qu’on reste là pour garder la boutique et pas nous faire piller mais les filles avaient la frousse et Michel (son fils) était déjà parti. Je leur disais : mettez-vous à l’abri sous le billard, et priez la petite sœur Thérèse. Mais elles ne voulaient pas rester. Alors on est partis à la ferme à Dancourt. Quand on a traversé le clos du presbytère, il y avait des Allemands d’un côté dans la tranchée et des Américains de l’autre côté derrière la haie. Sûrement qu’ils ne se voyaient pas les uns les autres. Alors nous, on est passés dans le beau milieu du clos en levant les bras en l’air et en criant : “Civils, civils”. »
- 20. La presqu’île du Cotentin sera en effet coupée le 18 juin lorsque les parachutistes arrivent sur la côte ouest.
- 21. Cherbourg ne sera libérée que le 26 juin.
- 22. « Pensez, c’était un petit canon gros comme rien. Ils étaient plus d’une douzaine à s’affoler autour. Entre deux de le faire péter, ils venaient chercher des verres. J’avais beau leur dire de rapporter les verres vides, sinon Agnès, elle ne voudra pas m’en redonner d’autres. Ils ne m’entendaient même pas. Ils se sauvaient comme s’ils avaient le feu au derrière, sans même ramasser leur monnaie. C’était pourtant pas avec leur mauvais petit canon de rien du tout qu’ils pouvaient gagner la guerre. »
- 23. « Ils avaient eu le temps parce que les autres, ils n’ont pas foutu la maison à bas du premier coup… »
- 24. Transcription inexacte de l’adverbe d’affirmation allemand « ja ».
- 25. « À combien de mètres°? »
- 26. « Qu’est-ce que c’est ? »
- 27. Blessé.
- 28. En abondance.
- 29. Défense contre avions.
- 30. « Taisez vous, ils vont vous entendre ! »
- 31. « Dire qu’ils viennent tous faire dans mon pot ! Ç a va sentir mauvais… Ils pourraient tout de même bien aller faire leur affaire dehors… Où je vais faire moi, quand mon seau va être plein ? »
- 32. Selon l’Oxford English Dictionary, il s’agit de l’abréviation de G overnment (or G eneral) I ssue : nom générique donné aux soldats américains.
- 33. Bas-côté de la route, en patois normand, d’après le Dictionnaire du français régional de Basse-Normandie de René Lepelley.
- 34. Sur la route de Cherbourg, Montebourg revêt un rôle primordial dans la bataille pour accéder au Nord Cotentin. Plusieurs bombardements frappent la bourgade, notamment les 8, 10 et 12 juin. Bombes au phosphore et obus de marine font de Montebourg un brasier. Si quelques habitants se réfugient dans l’abbaye, beaucoup quittent leurs caves pour trouver le chemin de l’exode.
- 35. Trois bombardements les 6, 7 et 8 juin anéantissent Valognes, le « petit Versailles normand ». Les charmes de la ville sont réduits en poussière. Près de 300 morts seront à dénombrer.
- 36. Nom de code donné à la première plage de débarquement vers l’ouest.
- 37. Les Américains arrivent sur les hauteurs de Cherbourg dès le 23 juin. Deux jours plus tard, le 25, des combats se déroulent en ville. Le général von Schlieben et l’amiral Hennecke capitulent le 26, sans ordonner à leurs troupes, retranchées, un cessez-le-feu général. L’arsenal résistera jusqu’au lendemain.
- 38. « Dire qu’il a les pieds raides ce con-là ! J’arrive pas à le déchausser. »
- 39. Il est bien difficile de quantifier les brutalités commises par les troupes alliées à l’encontre des Normands. D’une part, toutes les victimes ne portent pas plainte et d’autre part ces affaires judiciaires sont parfois étouffées, or les autorités recensent uniquement les cas sanctionnés par les tribunaux. Michel Boivin avance dans ses travaux, pour le département de la Manche et sur toute la période de la guerre, le nombre de 208 viols, et environ 30 meurtres, commis par des membres des troupes américaines sur la population normande.
- 40. Assoter ou assotir : verbe rare et familier désignant l’action de rendre sot.
- 41. Règle de mathématiques. D’après la définition du Robert, il s’agit d’une « méthode par laquelle on cherche le quatrième terme d’une proportion quand les trois autres sont connus. »
- Numéro: TE277
- Lieu: Mémorial de Caen