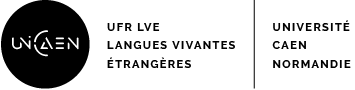Souvenirs oraux d'un soldat-paysan de Toscane (1941-1947)
Avertissement
L’interview de Natale Agostini a été enregistrée sur caméra vidéo par Urbano Cipriani le lundi 10 octobre 2005 à Avena, village de la commune de Poppi dans la vallée du Casentino (province d’Arezzo). La transcription de l’interview en toscan, puis son adaptation en italien régional parlé ont été réalisées par Viviana Agostini-Ouafi qui a proposé aussi le titre général du récit. La division en deux parties est déjà présente dans l’enregistrement. Par contre, les chapitres qui subdivisent le récit ont été introduits dans la transcription pour faciliter une lecture chronologico-thématique du texte narratif : ils indiquent les changements de situations, de lieux et de moments dans ce qui est en fait un récit-fleuve d’une heure quarante, interrompu très rarement par l’intervieweur. Les interventions de celui-ci, Urbano Cipriani, souvent d’ordre phatique, sont toujours en italique. Dans la transcription du récit, on trouvera entre parenthèses et en italique, des descriptions de gestes qui accompagnent le récit de l’interviewé et viennent compléter un discours qui, sans cette précision, serait parfois trop elliptique. Les notes en bas de page apportent des informations complémentaires de différentes sortes. Elles signalent parfois les imprécisions chronologiques, plus ou moins importantes, concernant des événements historiques éloignés, et inévitables dans une narration exclusivement orale.
Nous rappelons qu’il existe de ce récit une version originale en toscan nord-oriental1Cette version accompagne la vidéo de l’interview dans la section de ce site web consacrée aux témoignages audio. Lors de la transcription, nous avons cherché à respecter le plus fidèlement possible les aspects phoniques et rythmiques, lexicaux et syntaxiques de la langue parlée du locuteur.. Son adaptation en italien régional parlé a pour but, d’une part, de faciliter la compréhension de l’interview (dans la vidéo et dans la transcription originale) et, d’autre part, d’augmenter la lisibilité des traductions faites en plusieurs langues étrangères : d’abord en français — pour les relations culturelles privilégiées liant notamment la Toscane et la Normandie —, mais aussi en croate, en allemand et en anglais, c’est-à-dire dans les langues des forces civiles et militaires rencontrées par le témoin-narrateur au cours de ses errances de guerre en Europe.
Natale Agostini, né le 24 avril 1923, est décédé le 2 novembre 2005 à l’âge de 82 ans, à la suite d’un accident de la route. Cette unique interview, réalisée par Urbano Cipriani quelques jours avant sa mort, a permis de donner une forme durable, orale et écrite, à la voix et aux inflexions de ce conteur expert, de transmettre ses souvenirs — témoignages incroyables et exemplaires de guerre et de fraternité — et de conserver un échantillon de langue parlée toscane qu’aucun de ses enfants, nés et scolarisés après la Seconde Guerre mondiale, ne pourra transmettre aussi pur et savoureux aux générations futures.
PREMIERE PARTIE
Visite d’incorporation et enrôlement2Début février 1941. À plusieurs reprises au cours de l’interview (cf. le deuxième chapitre) le témoin donnera la date du 8 février 1941, comme jour où il est enrôlé dans l’aviation et où il commence à fréquenter les cours de l’école militaire.
Natale AGOSTINI – Je me suis présenté à la visite d’incorporation à Arezzo. À cette époque, le centre de recrutement était à Arezzo. Et comme j’ai été l’un des premiers à être appelé, soit parce qu’ils appelaient par ordre alphabétique, soit pour une raison que j’ignore, j’ai été appelé dans les douze premiers. J’en suis sorti très rapidement, reconnu apte au service. Si je me souviens bien, je n’ai pas demandé où ils me mettaient. Une fois dehors, qui je rencontre, l’abbé Guerri, qui était originaire d’ici, d’Avena.
Urbano CIPRIANI – Ah, je l’ai bien connu !3Les interventions de l’intervieweur, en italique, seront dorénavant indiquées par les initiales de son prénom et de son nom : U. C.
C’était un grand, grand ami de ma famille.
« Oh ! Natalino ! » qu’il me dit4Natalino, diminutif du prénom Natale..
« Eh ! — je lui dis — je viens de passer la visite, ça s’est bien passé mais est-ce qu’il n’y aurait pas moyen de savoir où ils m’ont mis ? » Je savais qu’il connaissait tout le monde à Arezzo et que c’était quelqu’un qui avait ses entrées partout.
Il me dit : « Attends un peu, je vais voir. »
Au bout de dix minutes, il redescend : « J’ai la réponse, on t’a mis dans le 6e Bersagliers à Palerme. »
« Sainte Vierge ! je dis, dans le 6e Bersagliers à Palerme, est-ce qu’on peut faire quelque chose ? Moi, dans trois mois je me retrouve en Afrique. Si vous pouviez voir un peu si… si on ne pourrait pas me changer de place, que j’aille là ou ailleurs, moi, je suis bien partout. »
Il est remonté voir. En redescendant, il me dit : « Non, il n’y a rien à faire, ils ont fait le compte exact du nombre de ceux qu’ils doivent envoyer. »
« Sainte Vierge, ça ne me dit rien d’aller là. »
Il me dit alors : « Viens avec moi, on va aller à l’aéroport : je sais qu’on enrôle des volontaires pour l’aviation. »
On va à l’aéroport. Il y avait un capitaine, les deux hommes se tutoyaient, comme deux frères : « Eh non, cette demande n’est pas possible… L’enrôlement est définitivement clos, mais je sais qu’à Rome, toutes les visites ne sont pas terminées. »
Car la visite pour les spécialistes de l’aviation n’était pas celle que l’on faisait ici. On allait à Rome, et c’était une visite très différente. Le capitaine alors ajoute : « On va faire une chose, dit-il, tu vas aller chez toi, tu vas aller à la mairie et tu vas te faire remplir ces papiers — les papiers qui étaient nécessaires pour se rendre à cette visite — et demain, tu reviens ici, je les mets tous dans une enveloppe et je t’envoie directement à l’endroit où l’on passe cette visite. Ils en ont encore beaucoup à faire passer. »
Je rentre à la maison et je vais à la mairie. À la mairie, il y avait ce pauvre Elia, la Marietta, et Lanini… Comment s’appelait-il, Franco ? Non, tu sais, Lanini, celui qui avait épousé la sœur de Toni, de Ponte a Poppi. Bref, ils étaient là tous les trois. Je suis arrivé juste dans les temps, car j’avais réussi à prendre le train à Arezzo à onze heures. À midi, le bureau de la mairie était encore ouvert. Fosco ! Fosco Lanini : ça y est, je me rappelle son nom.
Ils m’ont dit, aussi bien Fosco que Elia et Marietta : « Viens demain à huit heures, huit heures et demie, parce que Simoni doit les signer »… c’était… pas le maire, attends, à cette époque ce n’était pas un maire, on lui donnait un autre nom...
U. C. – C’était un podestat.
Le podestat Simoni.
Le lendemain matin, j’arrive à la mairie à l’heure indiquée, tout est prêt, on me donne les papiers, je prends le train de dix heures et demie, j’arrive à Arezzo, à la gare je trouve l’abbé Guerri qui m’attend. On va à l’aéroport, on retrouve le capitaine qui met tous les documents dans une grande enveloppe et il écrit l’adresse : 31, Ripa grande à Rome.
Il me dit : « Ça, c’est l’endroit où on fait la visite. Il y en a encore beaucoup à passer. »
J’y vais. Le capitaine m’avait dit : « Quand tu arrives là-bas, tu remets cette lettre au planton. »
Je lui remets la lettre, il l’ouvre, y jette un coup d’œil, puis il me dit : « Très bien, tu vas là-bas » et la lettre il l’envoie là-bas aussi.
Je résume. Ils devaient m’appeler moi aussi, mais en fait ce soir-là on ne m’a pas appelé. C’est seulement le lendemain qu’on m’a appelé : j’ai passé la visite, ce sont des visites un peu compliquées, il y a l’épreuve de la trappe5Au sens propre du terme : l’une des épreuves consistait justement à tomber à l’improviste par une trappe dans un espace au-dessous sans perdre l’équilibre, en gardant la capacité d’exécuter immédiatement des ordres., il faut résoudre des tas d’épreuves, ensuite il y a plein de tests. Je vais t’en dire un mot… par exemple une feuille grande comme une demi-page de journal avec plein de questions. Toi, tu dois répondre à toutes les questions puis, quoi encore ?… On te présente une boîte qui contient trente ou quarante morceaux, archi-pleine, on la vide et toi tu dois la re-remplir de la même manière, toujours dans un temps limité, ensuite… il y a toutes sortes de petites plaques, toutes rondes… une de dix grammes, une de onze, et ainsi de suite…, il y en avait trente, même quarante, tu dois les empiler toutes progressivement par poids, quoi encore… une autre série à empiler, trente autres petites plaques, non là, il n’y en avait que vingt, vingt plaquettes de couleur rouge, mais d’un rouge de plus en plus vif, que tu devais remettre toutes dans le bon ordre. Bref, des tas de questions et des tas d’épreuves.
Après toutes ces questions et toutes ces épreuves, beaucoup de types étaient écartés, d’un côté on mettait ceux qui avaient été jugés aptes et habiles, et les autres étaient renvoyés chez eux. Au bout de quatre jours, l’examen était terminé et on nous emmène dans une salle très grande où il y avait entre deux cent cinquante et deux cent soixante personnes. On nous met là, et on appelle chacun par ordre alphabétique. On m’a appelé assez vite. Après deux ou trois Abbondanza, deux ou trois Acciai, ce fut mon tour : Agostini. Ils se mettent à contrôler tous les papiers, tous les documents et puis on dit :« Mais celui-ci, qui nous l’a envoyé ? ! Il vient du cours moyen ! »
Moi, en fait, je n’avais suivi régulièrement que le cours élémentaire, mais avant de partir soldat j’avais passé le certificat de fin d’études, en candidat libre6Natalino n’a donc effectivement suivi, des cinq années de l’école primaire, que les trois premières. Il a obtenu le certificat de fin d’études en se présentant aux examens en candidat libre..
J’entends : « Ce gars-là, envoie-le là-bas ! Ce gars-là, il faut le renvoyer chez lui ! »
Et ils passent mon dossier, plus loin, à une autre table où il y avait un lieutenant qui re-contrôlait tous les documents. Après moi, c’était le vingtième ou le trentième, un certain Benedetti Giuseppe de Tuscania, dans la province de Viterbe… non de Grosseto : « Ce gars-là aussi, qui nous l’a envoyé ? ! Eh ! envoie-le là. » Et ces documents, les documents de Benedetti, furent envoyés plus loin au même officier. Arrivés au fond : « Eh ! regarde ceux-là, on les renvoie chez eux. »
En fait, on ne pouvait pas entrer dans ces écoles, si on n’avait pas au minimum le niveau quatrième. À cette époque il y avait la formation commerciale… et il y avait deux sortes de quatrièmes.
U. C. – Oui, les filières...
Les filières… il suffisait de sortir d’une des deux7Apres l’école primaire, le cycle scolaire qui suit, celui du collège, dure en Italie trois ans..
Alors quelqu’un a dit : « Ces deux-là il faut les renvoyer chez eux. »
À quoi servaient tous ces tests, le saut dans la trappe, toi qui devais lire aussitôt après le saut tout ce qu’on te demandait, tu devais marquer, appuyer sur les boutons qu’on te disait. En somme, je te l’ai dit : on avait passé quatre jours à subir ces épreuves, ces examens.
Alors le lieutenant a dit : « Moi, ces deux garçons, je les enverrais suivre le cours. Ils ont des capacités. Sur les quatre cents recrues du départ, il est difficile d’en trouver dix qui ont leurs capacités physiques » et il ajoute : « De toutes façons, il y a l’examen tous les deux mois. »
À l’école, tous les deux mois, il y avait un examen, et ceux qui ne le réussissaient pas étaient renvoyés chez eux ! Tu comprends ?
U. C. –Ainsi il y avait moyen…
Eh ! oui, il y avait moyen… « Mais… » disent les autres alors.
Le lieutenant alors : « Allez ! on va les envoyer là-bas. » Et on nous a envoyés suivre le cours.
École militaire et escadrille de chasseurs bombardiers88 février 1941 – 8 septembre 1943.
Le premier cours s’est tenu à Ascoli Piceno, sous la direction de l’ingénieur Cesari. Il a duré une année. Le second cours, entièrement de travaux pratiques, une autre année.
On a suivi le cours, les deux premiers mois, mais on ne nous a pas fait passer d’examen, ni à moi, ni à Benedetti, parce que le programme partait d’une telle hauteur que nous deux on n’y comprenait rien, je t’assure. Après le collège, si tu envoies quelqu’un au lycée, il est capable de suivre, mais si c’est un gars qui n’a fait que le cours moyen et que tu l’envoies au lycée, tu comprendras que… Pourtant tous les deux — on nous avait mis ensemble au même pupitre — on bûchait à fond, vraiment à fond, tu peux me croire !
Tous les soirs, le directeur du cours venait dans la salle d’études. Parce que nous, on partait le matin à huit heures et on revenait à midi, on repartait à deux heures et on rentrait à six heures. Après six heures, à partir de sept, on avait deux heures d’étude obligatoire, avec un sous-officier qui nous surveillait. À la fin des deux heures, si tu voulais rester, tu pouvais, et si tu voulais aller te coucher, tu y allais. Mais nous deux, on était de ceux qui restaient, parce qu’étudier, on aimait ça.
C’est parfois étonnant quand on étudie, de découvrir les choses, la réalité, surtout en électromécanique… — C’était ça notre branche, on était le groupe seize des connections électromécaniques, c’était ça notre branche principale et c’était intéressant. On avait aussi une heure, non, deux heures par semaine du corps humain, une le mardi et une le samedi. Mais moi, quand je faisais cette heure du corps humain, la nuit suivante je restais pour étudier, sans aller au lit car dans les écoles militaires, si quelqu’un a envie d’étudier, il peut étudier autant qu’il veut !
Pendant les heures où on restait, sans être obligés, mais parce qu’on le voulait, après les deux heures obligatoires, le directeur du cours passait toujours.
Il disait : « Je vais interroger l’un d’entre vous. » Avant, je t’explique : à l’école, si un élève prenait dix sur vingt, il n’avait rien. Non. Dix sur vingt : une nuit en cellule ; onze sur vingt : pas de cellule, pas de prime ; jusqu’à quinze sur vingt, même chose ; seize sur vingt : une sortie du soir, parce que la sortie libre, on n’y avait droit que le dimanche, tu comprends. Les autres jours, il n’y avait pas de sortie libre ; dix-sept sur vingt : deux sorties du soir ; dix-huit sur vingt : trois sorties du soir.
Un vingt sur vingt, personne ne l’obtenait, mais j’ai eu dix-huit plusieurs fois. Finalement, au bout de quatre mois, ils nous font aussi passer l’examen. Les deux premiers mois, cinquante ou soixante avaient déjà été renvoyés : ceux qui avaient la tête vide n’avaient pas obtenu la moyenne, aucun d’eux. Bref, à quatre mois, nous deux, moi et Benedetti, on a eu la moyenne. À six mois, même chose. Si bien qu’à six mois, avant même la fin des six mois, j’ai eu droit à une ou deux sorties à la suite de l’interrogation, l’interrogation de ceux qui se trouvaient là. Le directeur demandait : « Qui, parmi vous, sait cela ? » Il suffisait que quelqu’un le dise et il avait droit à une sortie du soir. Mais pendant qu’il interrogeait le gars, en fait il interrogeait aussi les autres, car si le gars ne savait pas répondre à la question, il le demandait à la troupe et il y avait toujours quelqu’un qui pouvait répondre.
Que dire de plus : moi par exemple, il m’arrivait de — aujourd’hui ça m’arrive moins — de suer beaucoup des pieds, et mes chaussettes, à force de les laver moi-même, en moins de deux, elles étaient devenues des chiffons. Et chaque fois…, la première fois je ne savais pas comment faire, j’ai été au rapport, j’ai demandé à aller au rapport chez le commandant. Je suis allé trouver le commandant, je lui ai dit : « Mon capitaine, j’ai ce défaut et voilà ce qui m’arrive… »
« Pas de problème. » Il m’a fait un billet : « Va au magasin. Cinq paires, ça te suffit ? Quand tu les as finies, tu m’en reparles, et t’y retournes. » En somme, j’avais obtenu déjà quelques facilités.
Et puis, pour dormir, comme tu sais, on dormait dans des lits superposés. Il y avait deux lits. Voilà qu’un jour, un certain Màngani voulait venir absolument dans mon lit, enfin dans le lit au-dessus du mien, car c’était un garçon qui avait envie d’étudier, envie de bien faire, mais il n’avait pas de mémoire.
Il me dit : « Si je viens, comme ça même la nuit quand j’y pense, je te le demande, et toi tu me le dis. » Ça aussi, c’était quelque chose de remarquable.
Il me parlait de lui, il me disait : « Mon père est mort, ma mère est toute seule, si on me renvoie… — car ceux qui étaient renvoyés, ils nous écrivaient ensuite du front, là où ils étaient — ma mère elle meurt aussi, aide-moi ! »
Je l’ai aidé, et d’autres encore ! J’ai même aidé ceux qui les premiers temps m’appelaient « lu Zollone », le Terreux9Terme péjoratif indiquant un paysan : les « zolle » sont les mottes de terre compactes et dures que le laboureur retourne avec la charrue.En français également, les surnoms dont les soldats moqueurs d’origine citadine affublent les paysans sont nombreux : Pedzouille, Pécrat, Cul terreux, Terreux, Écrase-mottes, etc., relevés par A. Dauzat au cours de la Première Guerre mondiale [NdT]., parce qu’à l’école, tu vois, c’était tous des fils de professions libérales !
U. C. — Ah ! Ah ! Ah !
« Eh Terreux ! !» Eh bien, ces Romains, il y en avait plusieurs qui venaient me demander de leur expliquer. Pour conclure, on arrive à la fin du cours, non, pas à la fin du cours, car le cours de premier niveau finissait en février : le 22. Quand le directeur venait, et qu’il disait : « Je veux un volontaire », personne ne voulait être volontaire. Alors il prenait la liste et il appelait toujours ceux qui avaient un certain bagage, car il y avait des comptables, il y avait aussi des géomètres, ce n’était pas quelqu’un qui appelait ou forçait un élève qui n’avait fait que le cours moyen.
En deux mots, le 20 ou le 21 décembre, il vient et pose la même question. Il s’appelait le capitaine Pasinati, il était de Pise. Il demande : « Je veux un volontaire. »
Je me lève, car il fallait se lever et dire : « Agostini Natale ! » (En prononçant cette phrase, le narrateur lève le bras bien haut.)
« Approche ! Toi au moins tu es un Toscan, et nous deux, on se comprend. »
Je m’approche et il me fait : « Aujourd’hui, je ne vous demande pas les choses de l’école, je vais vous demander ce que je veux, et vous allez me répondre ce que vous pouvez, et si vous ne répondez rien, il n’y aura pas de punition, mais si votre réponse mérite une permission, vous l’aurez : soyez sûrs que je vous la donnerai. »
Il m’appelle donc, et me pose plein de questions. Moi, calmement, mais du mieux que je pouvais, je lui ai répondu.
Après m’avoir posé une dizaine de questions, il m’a dit : « Écoute, je vais t’en poser encore une autre. Je vois que tu m’as répondu et que pas une seule des réponses que tu m’as données n’est à côté des questions, pas une seule en dehors. Maintenant je t’en pose une autre. Voilà : comment fais-tu pour répondre… comment t’as fait pour me donner la bonne réponse quand je vois que tu as le niveau cours moyen ? »
Alors, je n’ai pas eu peur de lui dire : « C’est vrai, mais le cours moyen je l’ai étudié tout seul, à l’école je n’ai suivi que le cours élémentaire. »
« Et dans tes réponses, tu n’as jamais répondu à côté. »
« Mais, lui ai-je répondu, ceux qui ont défini ces lois, ces règles, pour les résumer en quelques mots à l’essentiel, sont des personnes qui ont étudié, et qui ont un cerveau bien organisé. Moi, je n’ai pas un cerveau comme le leur, j’en suis loin, et je n’ai pas fait du tout d’études : je suis incapable de les expliquer comme eux. Alors, je cherche à donner au maximum l’idée d’avoir compris, en partie, le sujet. »
« Je vais te poser une autre question, me dit-il, et si tu me réponds bien, tu auras une récompense. »
Tu parles si j’écoutais : encore une question. « Ça fait combien de temps que tu n’as pas été chez toi ? »
« Eh ! Depuis que je suis arrivé ici, depuis le 8 février. »
« Et ça te ferait plaisir d’y aller ? »
« Ni un professeur, ni un savant ne pourrait répondre mieux que moi. Bien sûr que ça me ferait plaisir ! »
« Demain, tu viens au bureau : tu auras cinq jours de permission, plus le voyage. »
La seule permission en récompense, la seule, parce que jusqu’à la fin du cours, il n’y avait pas de permission : la seule, c’est moi qui l’ai eue. Là-dessus je suis allé chez moi… À la fin du mois de juin, il y a eu les examens : j’ai été reçu douzième.
U. C. – À la fin de juin de quelle année ?
Juin… 1942. Pour le premier cours, pas pour le second, on est bien d’accord !
U. C. – Oui.
Benedetti fut classé vingtième, tu comprends ? Je me souviens de ceux qui… Cardani, Pucci… Tu sais, il y avait aussi des fils de colonels, il y avait aussi des fils de chefs, de gens importants… Après ça, on part pour le deuxième cours, et on nous a envoyés à Capodichino.
À Capodichino, en dessous de Naples, on devait y rester un an. Au bout de dix jours, on nous a transférés, et envoyés à Portorose, au-delà de Trieste, c’est-à-dire en Slovénie ! Pourquoi ? Parce que pendant ces dix jours que l’on était restés à Capodichino, on n’a pas pu aller un seul jour à l’école. Il y avait des bombardements tous les jours, tu comprends… comme si c’était la fin du monde.
On est arrivés à Portorose. À Portorose, on devait avoir une année de cours. Au bout de six mois, à la fin de juin, on nous a versés dans les escadrilles. Voilà, et moi on m’a mis dans la 36e escadrille des chasseurs-bombardiers, à Altura di Pola. Mais à Altura di Pola, c’était une escadrille d’hydravions : la 36e escadrille, c’était des hydravions. Alors, un peu avant le début de septembre, les jours je ne m’en souviens plus, mais c’était à la fin du mois d’août, on a reçu un message radio, on devait aller escorter des navires qui étaient partis de Piombino et qui allaient en Sicile porter des renforts, car, à ce moment-là, les Alliés n’avaient pas encore débarqué10 Événement à situer au maximum fin juin 1943, ou début juillet, car les Alliés débarquent en Sicile le 10 juillet..
On était douze appareils, et quand on avait dépassé l’île d’Elbe… — on devait être à une centaine de kilomètres après l’île d’Elbe — des avions américains, des américains et des anglais sont arrivés, il y en avait au moins cent ! Conclusion : sur les douze appareils on est rentrés à sept, cinq ont fini à la mer. Tu vois le travail !
U. C. – C’est ce qu’on appelle un beau baptême du feu !
Tu parles, ils nous ont abattus. Ensuite on est restés là-haut dans le Nord, puis ce fut le 8 septembre118 septembre 1943. À la suite du débarquement allié à Reggio de Calabre, le gouvernement du maréchal Pietro Badoglio signe le 3 septembre l’armistice de Cassibile entre l’armée italienne et l’armée alliée. L’annonce en est faite aux Italiens le 8 septembre à la radio, tandis que les Alliés prennent pied à Salerne, près de Naples, et le gouvernement, Pietro Badoglio et le roi se mettent à l’abri à Brindisi sous la protection des Anglo-Américains. L’armistice ne trouve pas du tout les forces armées italiennes préparées pour faire face à la nouvelle situation..
Le 8 septembre 1943 et la captivité en Yougoslavie12 8 septembre – début novembre 1943.
Quand arriva le 8 septembre, nous, on ne mouillait pas toujours au même endroit, car si tu regardes géographiquement la carte, à partir de Trieste, la côte slave semble toute droite, on dirait qu’elle suit une seule direction… Au contraire, de Trieste pour aller à Zara, car Zara aussi était italienne, il y a bien une centaine d’îles, oui, une centaine, et aussi une centaine de golfes. Nous on ne mouillait pas toujours à Altura di Pola, pour ne pas être pris, tu comprends ? Ce sont des choses qui ne… Ce n’est pas moi qui décidais, c’étaient les officiers.
Le soir du 7 septembre, on a mouillé à quatre ou cinq kilomètres de Zara, toujours en territoire italien, parce que Zara, Zagreb, Lubiana… Fiume, Pola c’était l’Italie. Une région qu’on avait prise en 1915-191813 L’Italie entre en guerre le 24 mai 1915 [NdT]., oui, entièrement italienne, une région qui était aussi grande que la Toscane. Au matin, on a commencé à entendre des bruits autour de nous : on a compris quand le jour s’est levé que les sentinelles, celles de l’escadrille, avaient bien vu qu’on était encerclés, par des bateaux, tous leurs bateaux. On a tous été faits prisonniers. S’échapper, quelques-uns ont rejoint leur avion, mais avec un avion on ne peut pas s’enfuir si on n’a pas refait le plein, et on ne l’avait pas fait…
En plus de ça, au matin, vers huit heures et demie, alors qu’on était encore là, un journal radio transmettait un message très court. C’était le général Badoglio : « Italiens, l’ennemi commun c’est l’Allemand. Pour nous l’ennemi commun c’est l’Allemand. »
Si bien qu’on n’a pas fait de résistance. Résister, d’ailleurs, comment résister, on ne pouvait rien faire en face de leurs mitrailleuses. On a été emmenés. On nous a emmenés au sommet d’une montagne, qui se trouve entre Zara et Sarajevo. On ne devait pas être très loin ni de l’une ni de l’autre, mais on en était au moins à une cinquantaine de kilomètres. Ils ont emporté là-haut tout ce que contenaient nos magasins, tout ce qu’on avait, jusqu’aux écrous, tout ce qu’on avait comme nourriture. Là-haut on a construit une baraque, rends-toi compte, une baraque, à mille huit cents mètres d’altitude. Elle était longue d’une soixantaine de mètres, même de soixante-dix et bien large. C’est là qu’on dormait…
U. C. – Combien étiez-vous ?
Quand on est montés, on était environ deux cents.
U. C. – Mais ceux qui vous ont faits prisonniers, qui étaient-ils ?
C’étaient les partisans de Tito14Les partisans communistes du maréchal Tito.. Mais les Titistes — aujourd’hui ça paraît bizarre, mais à l’époque ce n’était pas bizarre du tout — ils se disputaient entre eux. On s’est aperçus que c’étaient des fauves avant d’arriver là-haut… parce que tous, tous voulaient nous capturer car on avait beaucoup de choses, on avait aussi des vivres, des boîtes, tout plein de produits : ils avaient tout emporté là-haut. Les trois ou quatre premiers jours, quand arrivait l’heure du repas, ils nous donnaient aussi quelque chose à manger. Puis, au bout de huit jours, à nous, ils ne nous donnaient plus rien. Eux non plus n’avaient pas grand-chose. Tout a été fini rapidement, surtout la nourriture, car ce n’est pas seulement le groupe qui nous avait faits prisonniers qui s’en était emparé, mais aussi les autres. Ils s’étaient un peu disputés, mais la nourriture ils l’avaient partagée entre eux. De toute façons, nous, on n’était pas allés voir ce qu’ils faisaient.
Au bout de vingt-cinq jours, il ne restait plus rien, tout avait été mangé, et même eux n’en avaient plus. Ils descendaient alors un peu plus bas, là où il y avait des bergers, et ils remontaient à chaque fois deux ou trois brebis. Ils avaient installé un grand chaudron comme ceci (il écarte les bras) : dedans, on pouvait en mettre deux. Ils avaient planté trois poteaux gros comme cela (il ouvre symétriquement les index et les pouces), hauts de deux mètres trente, attachés en haut, avec un fil d’acier tout rond qui redescendait au centre, avec un crochet en bas, un gros crochet, pour y accrocher le chaudron, le feu en dessous, et ils la faisaient bouillir… pas moins de sept ou huit heures ; puis, quand ça avait bouilli le temps suffisant, ils prenaient une bâche assez grande, et à un endroit où c’était plat, ils renversaient tout sur la bâche, puis ils retiraient toute la viande. Quant aux os…, il y avait des ravins là-haut, il y avait des loups, ils jetaient les os dans ces ravins.
Je résistais assez bien : je vais t’expliquer pourquoi. Là-haut, c’était que du maquis et j’ai commencé, quand j’avais faim, à manger des baies d’églantier. Il y avait des baies rouges, et certaines petites rondes et noires, qui contenaient des pépins avec des poils mais j’avais de bonnes dents, et je les mangeais, je les grignotais… Aujourd’hui encore, que j’ai quatre-vingt-trois ans, je ne me suis jamais purgé, et à l’époque j’avais l’estomac autrement solide. Mais certains commencèrent à s’écrouler d’inanition. En plus, la soif… la soif est pire que la faim. Quand la soif te prend, que tu ne peux pas… là-haut il n’y avait pas d’eau. Il y en avait plus loin. Mais on n’avait pas le droit de s’éloigner de plus de dix mètres. De temps en temps quelqu’un y allait. Un jour, à cette petite source, il y avait tout un groupe qui prenait de l’eau comme ça dans la main. Sept ou huit d’entre eux sont arrivés — pas question de fuir, car ils avaient une mitraillette — et ils ont tous été égorgés. Entre eux aussi, d’ailleurs, je les ai vus s’égorger : entre factions rivales. Tu vois Monte Còrniolo, tu le situes bien, Monte Civitella se trouve à deux cents mètres à vol d’oiseau. Eh bien, à Monte Còrniolo, il y avait une faction et à Civitella une autre. Quand ils se rencontraient, quand ils se disputaient, ils s’égorgeaient : ils s’attrapaient comme ça (il bloque sa tête de sa main droite et avec sa gauche il fait le geste rapide de se trancher le cou), puis un coup de baïonnette, l’autre commençait à râler, il tombe par terre, mais ça ne durait pas longtemps. Et c’était fini.
Bon, ensuite, qu’est-ce qui m’arrive ? Ce qui m’arrive, c’est que, jour après jour, il a fallu que j’élargisse mes recherches, car dans le maquis, les baies d’églantier, je les avais toutes cueillies, et le lendemain il n’y en avait plus ! Il fallait bien aller plus loin ! Un jour, j’étais à peu près à vingt-cinq mètres, et derrière un rocher, je me trouve en face d’un gars qui pointe son fusil vers moi.
« Arrête ! (paume ouverte, il fait le geste vers son interlocuteur) Tu ne vas pas me tirer dessus ! Je ne t’ai rien fait, moi ! Regarde, je n’ai rien (il secoue les pans de sa veste). Moi, du mal je n’ai pas l’intention de t’en faire, c’est sûr. Je n’ai pas besoin de te le dire, car tu as bien vu avant de me tirer dessus, de pointer sur moi ton fusil, que je suis en train de chercher des baies. À manger, vous n’en avez même pas pour vous, et à nous, vous ne nous donnez rien, alors si je mange les baies c’est parce que je ne veux pas mourir ici, car chez moi, j’ai un père et une mère et six frères et sœurs, tous plus jeunes que moi. Toi aussi, je suis sûr que tu as un père et une mère, j’en suis certain, et tu serais heureux toi aussi de rentrer chez toi. Mais ceux qui commandent, moi ils m’ont mis de ce côté, et toi ils t’ont mis de l’autre. Toi tu ne peux pas aller en bas, car là-bas il y a les Allemands. Et ce que tu pourrais me faire, eux ils le font à toi, si bien que… » Bref, j’ai commencé à argumenter.
Aujourd’hui, je ne suis plus comme avant, maintenant je ne suis plus rien, je ne vaux plus rien, mais quand j’étais jeune, je savais réagir. Sans m’effrayer, dans les situations les plus étranges, je ne perdais jamais mes moyens. Je maîtrisais toujours la situation. Alors, à force d’argumenter, il a fini par abaisser son fusil. Alors je lui ai dit : « Je te remercie de ne pas m’avoir descendu, mais toi, tu dois aussi me remercier, car si tu m’avais descendu, tu te serais toujours souvenu toute ta vie d’avoir descendu un garçon du même âge que toi, à peu de chose près. Tu es de quelle classe, je lui ai demandé (on avait deux mois de différence), un garçon qui ne t’a rien fait, il est là parce qu’on l’a envoyé là, et toi tu le tues… Si tu réfléchis bien, tu ne peux que ressentir du remords toute ta vie. Si au contraire tu m’as épargné, comme tu m’épargnes en ce moment, chaque fois que tu repenseras à ça, tu n’auras que du bonheur ! »
Regarde, (il s’adresse à Urbano) moi, aujourd’hui encore, il y a tous ces extra-communautaires qui arrivent, tout le monde proteste… mais moi, je les aide, tous ! Pourquoi ? Parce que c’est une dette que j’ai avec le monde entier : je les aide tous ! Pourquoi ? Parce qu’un jour on m’a tendu la main.
Je lui ai dit aussi [au Slave] : « J’ai bien l’intention de me tirer d’ici. Écoute une chose. Moi, d’ici, au sommet de cette montagne… » Il y avait une longue pente, qui de mille huit cents mètres descendait jusqu’à deux cents environ, où on voyait des petites routes fréquentées.
« J’ai prévu de m’enfuir une nuit, d’aller me constituer prisonnier auprès des Allemands, car ici — je lui dis — tu vois bien, tu le sais bien, nous on était deux cents, et nous ne sommes plus qu’une cinquantaine encore vivants. »
La plupart ont été assassinés et plusieurs sont morts… morts : oui morts. Depuis deux mois, on était à la Toussaint, juste après la Toussaint, car du 8 septembre à la Toussaint, il y a deux mois, septembre et octobre. Et sans manger, on meurt. Tu sais, le matin, tous ne se levaient pas, tu m’as compris… bref, je lui dis : « Tu vois, si je me retrouve dans le fossé par là, à gauche, et que je reviens par ici, à droite, puis dans le fossé de droite et que je reviens par là à gauche, je vais finir par arriver là-bas sur les petites routes qu’on aperçoit, et où on voit passer des véhicules : ce sont sûrement les Allemands. »
« Oui ! oui ! — me dit-il — ce sont des Allemands. »
« Avant de mourir ici, je préfère me constituer prisonnier. »
« Tu as raison, me dit-il. Écoute alors, tu vas faire comme ça. » Et il ajoute : « Si je t’avais vu la nuit descendre ici, je te tirais dessus sans rien te dire, et un autre ferait pareil. Moi ce soir, je finis ma garde à dix heures, je suis monté à deux heures, et on fait huit heures. Après dix heures, je ne suis plus là, c’est un autre. »
Les Slaves, ils étaient nés italiens. Leurs parents, non, mais eux ils étaient nés après 1918, et à partir de 1918, ils étaient allés à l’école italienne, et ils parlaient italien comme nous. Ils parlaient aussi leur langue slave, mais aussi l’italien et avec nous ils parlaient italien.
Il me dit alors : « Tu vois, je suis ici, jusqu’à dix heures. Tu repères bien l’endroit, et tu repasses par ici, et moi, je ne te tire pas dessus ! Compris ? » Bref, quand on s’est quittés, et que je lui ai tendu la main, c’est lui qui le premier m’a embrassé ! Comme si on était deux frères ! Eh, oui !
Comme en novembre, à cinq heures, cinq heures et demie, il fait nuit, moi, vers six heures, quand c’était bien noir, je me mets en route, je descends, descends, je repasse par là, il m’attendait derrière son rocher, comme quand il m’avait vu dans la journée, et il me dit en chuchotant : « Tu descends toujours tout droit. »
Seulement, à cette époque de l’année, il avait neigé et pendant quatre ou cinq kilomètres, il fallait marcher dans la neige. Et de la neige, il y en avait haut, elle était épaisse. Et tout ça, dans la nuit, sans lune15Selon le calendrier lunaire consulté « en ligne », le 1er novembre, jour de la Toussaint 1943, est un lundi avec un premier croissant de lune montante : le premier quart est le vendredi 5. La fuite a, par conséquent, eu probablement lieu le 2 ou le 3 novembre>.. Je n’arrêtais pas de trébucher. Malgré les difficultés, au matin, avant que le jour se lève, j’avais fait une dizaine de kilomètres, on peut même dire quinze. Une fois en bas sur la petite route, quand j’ai entendu une voiture arriver, c’était une tout-terrain, je me mets au bord de la route, en pressant mes poignets l’un contre l’autre, comme ça en disant : « Moi Italien, prisonnier des Slaves. »
C’était deux Allemands, ils ne comprenaient pas ce que je disais, mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que j’avais encore ma tenue de vol, mon blouson de vol. Ils ont vu que j’étais italien, ils l’ont vu à mon uniforme. « Vous, emmener moi. » Ils m’ont regardé un instant, puis ils m’ont fait monter dans leur bahut.
Déportation en Allemagne et vie chez les paysans16Mi-novembre 1943 – début juin 1944. Le témoin affirmera à plusieurs reprises qu’il est arrivé en Allemagne au début novembre ou au plus tard à la mi-novembre. Plusieurs recherches, amicalement faites pour nous par Alessandro Tuzza, sur le départ des convois de déportés civils et militaires de la gare de Trieste en novembre 1943 sembleraient reporter ces départs vers la fin du mois. On pourra peut-être avoir des précisions sur la date d’arrivée du témoin en Allemagne et surtout sur la petite ville où il a été déporté, si la WAST de Berlin, que nous avons sollicitée, est en mesure de retrouver, dans ses archives de la Seconde Guerre mondiale, le permis de séjour de prisonnier-travailleur délivré en Allemagne à Natale Agostini. En ce qui concerne sa fuite et son retour en Italie, pour des raisons que nous préciserons plus loin, les événements doivent être déplacés au minimum à la fin de juin 1944.
En deux jours, ce jour-là et le lendemain, on a fini par arriver à Trieste. À Trieste, c’est là qu’ils remplissaient les wagons, tu sais, les wagons à bestiaux qu’on ferme en bas avec des volants. Mais à ce moment-là, il n’y avait pas seulement des soldats, il y avait des enfants, des femmes, des hommes, il y avait, comment dit-on ? il devait-y avoir aussi les Israéliens17Le témoin ici veut évidemment dire « israélites ».. Dans chaque wagon, toute une foule, serrée comme des sardines. Par terre, parfois, quelqu’un tombait, pour un malaise, pour une raison ou pour une autre, mais sinon il n’y avait pas de place, il était plus facile de le maintenir debout. Au bout de trois jours, trois jours et deux nuits, je ne me souviens plus exactement du nombre d’heures, on est arrivés un matin de bonne heure. Il faisait encore presque nuit. Ce wagon, cette espèce de train, on l’avait arrêté sur une voie désaffectée. Au bout d’un instant, presque aussitôt, on les entendait parler, voilà les Allemands. Ils avaient une charrette, une charrette à bras avec un petit plateau dessus, une charrette à deux roues. Sur le plateau, il y avait des pains rectangulaires, de la forme des lingots d’or, pleins de moisi. Dans un pain ils coupaient six petits morceaux. Ils ouvraient les wagons et à chacun ils donnaient un petit morceau de pain. Les morts, on les retirait un à un et on les jetait dehors. Il y en avait des morts : des enfants, des vieillards, des femmes, il y en avait de toutes sortes. Au moment où ils ouvrent le wagon où je suis — je me souviens que j’étais près de l’ouverture, et j’ai été le premier à attraper un morceau de pain — là, en face de moi, je vois un vieil homme, un homme âgé, habillé en civil, qui parlait avec les Allemands (il avait soixante-quinze ans, qu’est-ce que c’est aujourd’hui soixante-quinze ans, mais soixante-quinze ans en 1943 : les gens étaient usés, vraiment vieux). Alors moi, je vois ce vieux qui parle avec les Allemands tandis que je commence à mordre dans mon bout de pain. Un des soldats, un de ces Allemands, s’en va jusqu’à la gare, pas très loin et il revient quelques minutes après. Le voilà qui revient et qui dit, en italien, comme on le parle, pas avec l’accent napolitain, ou milanais, mais comme on le parle ici dans le centre de l’Italie :
« Y a-t-il quelqu’un, parmi vous, qui chez lui était paysan ? Cet homme-là est un propriétaire terrien, ses fils sont soldats, et il a besoin d’hommes pour travailler sa terre. »
J’ai levé aussitôt la main, j’étais le premier. J’ai tout de suite été remarqué, à la fois par cet homme et par les Allemands18Le terme « allemand » ne sera jamais utilisé par le narrateur pour désigner dans le récit des civils mais toujours des militaires de l’armée allemande.. Ensuite, plein d’autres l’ont levée ! Moi, ils m’ont appelé en premier. Cet homme en a choisi cinq.
Puis le soldat dit : « Maintenant, il va vous emmener travailler, et ce soir, il vous ramène dormir ici, au quartier général de la gare. »
Nous voilà partis. Ensuite, on est arrivés là-bas, pas très longtemps après, car de la gare, à pied, ce n’était pas très long. Entre la gare et la maison de ce type19L’expression « la maison de ce type » est ici répétée deux fois. Le narrateur n’exprime pas toutefois un sentiment de mépris envers le vieux propriétaire terrien en l’appelant « ce type » (en italien : « questo coso », mot à mot « ce machin »), il exprime plutôt l’incertitude qu’il éprouve pour en définir le statut identitaire, à ses yeux pas bien identifié : il choisira après, en refusant le terme négatif « allemand », les désignations de « vieux », « colon » et paysan., il devait y avoir un kilomètre, un kilomètre et demi. Sa maison était de l’autre côté de la rivière (en deçà, il y avait le train), et on passait un pont. Au-delà de la rivière s’étend une plaine dont on ne voit pas le bout. Tous les trois cents ou quatre cents mètres, il y a une ferme où habitent ces fermiers20 Dans une autre conversation avec Urbano Cipriani le 6 septembre 2005, Natale affirme qu’il s’agit de Bremen sur le Danube. Mais dans la grande ville industrielle de Bremen (Brême en français), située au nord-ouest de l’Allemagne, le Danube ne passe pas. Le témoin s’est-il trompé ? À vrai dire, dans le sud-ouest du pays, près de la Suisse alémanique, il y a une petite ville appelée Hohentengen-Bremen située sur un petit affluent du Danube. Elle forme un nœud ferroviaire peut-être stratégique du Bade-Würtemberg, proche des mines de charbon, et son paysage rural semble correspondre à celui décrit par Natale..
On arrive là-bas, il nous conduit au champ. Un quart d’heure après, le jour était levé, on attelle le cheval, et sa femme arrive avec une grosse soupière pleine de haricots bien cuits. Ils n’étaient pas à l’huile d’olive, mais si tu savais comme ils étaient bons ! Tu peux me croire ! À midi, elle nous ramène encore à manger. Que je te dise : des haricots, des pommes de terre, il y en avait… Les premiers jours, on n’a pas mangé de viande : ils avaient des lapins, des poules, ils avaient des oies, des oies énormes, noires avec un long cou... Pour en revenir à l’arrivée, à chacun il donne un outil : il a donné le cheval avec la charrue à deux manches, pour labourer, à l’un des autres ; à moi, il m’a donné une sorte de large pioche à deux pointes, avec l’axe au milieu du manche et deux pivots : avec ça on ne travaille pas bien, on n’est pas habitué. Mais je faisais ce que je pouvais, je devais me pencher pour arracher, bref je faisais ce que je pouvais. À l’un de nous, l’homme avait donné une sorte de pelle, à un autre une espèce de grosse fourche. Ensuite le bonhomme nous a regardés faire.
Le lendemain, celui qui travaillait avec la charrue — si tu ne sais pas travailler la terre avec la charrue, tu la laisses toute compacte — celui qui travaillait à la charrue ne savait pas y faire, il la laissait à moitié travaillée et à moitié compacte : un merdier ! Et je lui disais au bonhomme — j’ai commencé dès le premier jour — je lui donnais une petite tape sur l’épaule et je lui disais : « Moi, moi, je trace des sillons droits (il fait le geste, en se touchant la poitrine avec ses deux index qu’il fait ensuite avancer en parallèles de bas en haut). Je n’avais pas les mots pour expliquer, je lui montrais comme ça. Rien à faire : moi j’avais la pioche, l’autre la charrue.
Le lendemain, vers 10 heures, 10 heures et demie, voilà la sous-ventrière qui se casse, la ceinture qu’on met au cheval. Le bonhomme, je le vois désespéré ! Je lui fais comprendre alors par gestes : « Du calme ! du calme », avec mes paumes ouvertes. Je suis allé à l’écurie. J’ai trouvé un sac de jute. Je l’ai ramassé, je suis revenu, et j’ai rapproché les deux morceaux de cuir et je les ai entourés avec ce sac, en le tournant quatre ou cinq fois. Et j’ai dit au bonhomme : « Toi, trouve… (il écarte les mains en faisant le geste de tenir une ficelle ou une corde.) »
Eh bien, il a compris ! Il m’a apporté une longue cordelette, très fine. J’ai pris cette cordelette, je suis allé à la porte de l’écurie, sur le seuil, qui était en bois, il y avait des gros clous, gros comme cela (de son index gauche posé sur le dos de sa main droite il montre la taille des clous), et tout doucement j’en ai retiré un. Puis j’ai ramassé une pierre et je suis retourné là-bas : j’ai commencé, avec ce clou j’ai fait un trou, j’ai passé dedans la cordelette, ensuite à côté, encore à côté, et ainsi de suite, un long bout de cordelette, et puis j’ai continué, (il montre comment il a opéré sur le bras large et plat du fauteuil où il est assis). Jusqu’au bout. Alors quand il a vu ce que je faisais, il est allé me chercher un autre long bout de cordelette. Ensuite il m’a apporté un truc, une sorte d’alène, que je ne savais pas trop utiliser, mais ça allait plus vite qu’avec le clou. J’ai tout recousu, avec des points très très serrés, un bout long comme ça (il montre le bras du fauteuil).
Après ça, on réattelle le cheval. En le réattelant j’ai demandé au bonhomme, en lui touchant l’épaule, puis par gestes (il tape sur le bras du fauteuil, avec ses index il se désigne puis ébauche une ligne droite), et au lieu de donner le cheval à celui qui l’avait eu jusqu’alors, c’est à moi qu’il l’a donné. Moi, ma pioche, je l’ai donnée à l’autre. C’était le deuxième jour. J’ai commencé tard à travailler, et à la fin, j’avais fait seulement trois ou quatre sillons, mais chacun long d’un kilomètre, tu sais. Chaque sillon faisait un kilomètre. Pendant ce temps, le bonhomme continuait à montrer aux autres comment faire. Bref, je l’ai vu qui me regardait de loin : « Eeeh ! Eeeh ! Eeeh ! » Bon Dieu ! Comprendre, comment comprendre, deux jours seulement que tu es là : je ne comprenais rien à ce qu’il criait. Puis on est rentrés. Quand j’arrive à la ferme, voilà ce que je fais. La veille, quand on était rentrés, le cheval était tout en sueur, il était plein d’écume, et quand le bonhomme lui avait dit de le rentrer, l’autre l’avait attaché puis il était parti. Moi, quand je suis rentré ce soir là, il m’a demandé de le rentrer, moi, je lui ai dit : « Non, attends ! » (il fait le geste de sa paume ouverte.) J’ai attaché le cheval à un anneau qui était près de la porte, j’ai ramassé ce qui restait du sac de jute, je me suis mis à côté du cheval et je l’ai bien étrillé partout. Le vieux me regardait tout content. Ensuite (il fait le geste du paysan qui lui ordonne de rentrer le cheval, et le geste de sa réponse qui dit) : « Non. Attends. »
Je suis entré dans l’écurie, j’ai pris la fourche, j’ai nettoyé la litière, j’ai pris un seau d’eau et je l’ai porté au cheval. Puis, j’ai vu dans un coin qu’il y avait un sac plein, je me suis approché, c’était du fourrage. Il y avait une gamelle, que j’ai remplie de fourrage et que je lui ai portée aussi. Quand j’ai nettoyé et refait la litière, j’ai retiré vers l’arrière la paille souillée et j’ai mis de la paille propre devant. J’ai pris un peu de paille propre, que j’ai tordue, pour en faire une torsade, longue comme la moitié de mon bras (il fait le geste) et je l’ai bien liée avec la ficelle du sac pour qu’elle ne se défasse pas. Pendant que je faisais tout ça, le cheval était resté dehors. Je suis sorti et je l’ai frotté de nouveau avec mon espèce de tresse, puis je me suis écarté. Bon dieu, le vieux me regardait ! Ensuite on a rentré le cheval, je l’ai attaché, et cet homme nous a reconduits au camp.
Le lendemain, quand il est revenu, au lieu de cinq, il en a pris trois. En ce qui me concerne, j’ai bien vu qu’il me cherchait. On est arrivés au champ, j’allais commencer à travailler avec le cheval mais il m’a dit : « Non ! Non ! » Il a pris le cheval par la bride et il l’a conduit au début du champ, là où l’autre avait travaillé.
U. C. — Pour tout refaire !
Je suis reparti de là : quel travail ! Ooh ! Je voyais que le bonhomme était heureux comme un roi ! La nourriture, toujours pareil. Ce jour-là, au lieu de cinq, on était trois. Toujours autant à manger. Et le soir, pareil, il nous ramène au camp. Au matin, il revient nous chercher, il n’en prend que deux : moi et un autre. Le troisième, il ne l’a pas repris. Au bout de cinq ou six jours, il ne prenait plus que moi. Et il n’arrêtait pas de me parler, mais je ne comprenais rien… comment veux-tu que je comprenne !
Puis un soir, au moment où il m’a reconduit, il ne m’a pas quitté, il est resté avec moi et il a recommencé à parler avec les Allemands. C’était l’entrée du camp de regroupement, tout le monde dans un grand baraquement, et il a recommencé à parler avec ces Allemands. L’un d’entre eux s’est éloigné. Cinq minutes après je l’ai vu revenir du quartier général de la gare avec cet employé de la gare, le soldat qui parlait italien. Quand je l’ai vu revenir avec cet Italien, j’ai été bien content car j’ai pensé : c’est sûrement quelque chose pour moi.
L’autre s’approche et me dit : « Écoutez, ce monsieur dit que vous savez très bien travailler la terre, et aussi soigner le cheval. Vous vous débrouillez bien ! Si vous vouliez rester avec lui, il vous installe un lit de camp dans le couloir entre son habitation et son écurie, et vous restez avec lui. Vous allez me donner votre plaque… » — (s’adressant à Urbano) Toi, tu n’as pas été soldat, mais nous les soldats, ici sur le revers du col, on a une petite plaque qui nous sert de pièce d’identité — « … et dans quelques jours, cet homme viendra la reprendre avec une sorte de carte d’identité, vous pourrez circuler en ville, et avec ce document, personne ne vous fera d’ennuis, personne ne vous dira rien. »
Quand le vieux m’a ramené chez lui, il m’a installé un lit de camp dans le couloir en question. Un lit qui s’ouvrait en deux, mais comme on était en novembre, vers le quinze novembre, là-haut, il fait très froid. Alors, sous moi il a mis deux ou trois couvertures, et deux ou trois autres pour me couvrir. J’ai dormi là trois ou quatre jours, trois ou quatre nuits.
Le soir suivant — comme j’avais appris gutte naque21Bonne nuit : « gute Nacht ». La langue allemande de Natalino est très approximative et, au plan phonétique, caractérisée par une nette influence de son parler toscan (par exemple il ajoute souvent une voyelle à la fin des mots monosyllabiques toniques, et des oxytons qui en allemand se terminent en consonne : Nacht > naque)., ça veut dire bonne nuit — après le souper, j’ai dit gutte naque et je me préparais à partir…
« Nae ! Nae ! Nae ! Nae ! » 22Il s’agit de la négation non : « Nein ». Il m’a attrapé par la manche de la veste, une habitude qu’il avait, et il m’a conduit dans la chambre de ses fils. Et c’est là que j’ai dormi après, dans le lit ! J’étais bien !
Alors, cet homme, qui avait soixante-quinze ans, toussait un peu, il avait un peu de bronchite, un peu d’asthme. Il n’arrêtait pas de tousser. Au bout de quelques jours, comme je commençais à parler (travailler arbaitte23Travail : « Arbeit »., dormir snaque24Ce verbe, avec deux autres variantes : « nappe » et « snappe » correspond au terme allemand « schlafen », dormir.), un soir je lui ai dit : « Nae ! Nae ! Di moga nappe : nics sveg arbaitte25« Nein ! Nein ! Du morgen schlafen : nicht weg, nicht arbeiten », c’est-à-dire : « Non, non ! Tu demain dormir : rester ici, pas travailler ».. Toi, demain tu restes au lit, (il incline légèrement sa tête sur sa paume ouverte) toi snappe, aïte neff stundé, à huit heures neuf heures, tu viens m’apporter à manger26« Schlafen, um acht, neun aufstehen » : « Dormir, à huit, neuf se lever».. Isch arbaitte, isch arbaitte ! »27« Ich arbeite, ich arbeite », c’est-à-dire : « Je travaille, je travaille »., parce que le matin, moi je me levais de bonne heure. Quand je lui ai dit cela, sa femme — sa femme avait soixante-dix ans — sa femme m’a donné un œuf : « Moga nappe fif sekse stundé »28« Morgen schlafen fünf, sechs aufstehen » : « Demain dormir, cinq, six se lever ».. Et ça voulait dire : « C’est pour toi, pour le gober (il porte ses doigts unis à sa bouche) à cinq, six heures quand tu vas te lever. » Après cela, pas très longtemps après, à Noël, je dirais qu’il y avait peut-être cinquante jours que j’étais avec eux : eh bien, on se comprenait déjà ! Au bout de trois ou quatre mois, je les comprenais parfaitement et tout ce que je disais, eux aussi. J’ai été là jusqu’au vingt, peut-être vingt-quatre ou vingt-cinq juin, de l’année 1944.
Ensuite, voilà ce qui s’est passé. Le bonhomme avait un frère — plus jeune que lui, il avait dix ou douze ans de moins — qui travaillait, à la gare, mais dans un bureau… Une fois par semaine au moins, et même deux fois, il venait trouver son frère. De l’argent il en avait, il avait son salaire, mais, regarde comme c’était dur, même en Allemagne ils n’avaient rien à manger. Il venait, c’est certain, pour voir son frère, mais quand il repartait, on lui donnait quelques œufs, une moitié de lapin… Parce que nous, moi j’ai toujours été bien, j’ai toujours bien mangé, car il y avait de tout : des lapins, des poules, de belles oies, bien grasses. Une oie ça faisait sept ou huit kilos, et quand on tuait une oie on avait de quoi manger pendant plusieurs jours, même si on mangeait…
Le frère et moi, on était devenus amis ! Il aimait bien bavarder et moi aussi ! Il me posait des questions sur l’Italie, il me demandait comment on y vivait, on bavardait… on était devenus amis ! À la fin de juin, le vingt-quatre ou le vingt-cinq juin 1944… le vingt-quatre ou le vingt-cinq mai, pas juin, je me trompais. J’étais arrivé au début de novembre (comptant sur ses doigts) : novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça faisait sept mois : janvier, février, mars, avril, mai, cinq en 1944 et deux en 1943. Il m’a dit : « Natalino, tu sais que si tu avais un peu de courage, il y aurait moyen pour toi de retourner en Italie ! »
Je lui ai répondu : « Angiolo29Variante toscane du nom italien Angelo, donc le narrateur « toscanise » le prénom allemand de son ami Engel., du courage pour retourner en Italie, moi j’en ai des tonnes à revendre ! »
« Écoute alors, me dit-il, un convoi doit partir, il va y avoir une expédition de wagons ouverts, pleins de charbon jusqu’à Florence. C’est moi qui dois aller voir si tout fonctionne, les freins, les batteries, la veille du départ. Si tu veux, comme j’emporte toujours une pelle quand j’y vais, je te fais un trou, dans un des wagons éloignés au fond de la gare. Je te fais un trou. On a le temps, il part vers 11 heures, minuit. Avant je viens te chercher, je te recouvre. » Et c’est ce qu’il a fait. Il est venu me chercher, il m’a recouvert. Le charbon brut est en gros blocs, pour respirer il n’y a pas de problèmes… J’ai seulement cru mourir dans le tunnel entre Bologne et Florence, car ce n’était pas un train électrique mais un train à vapeur. J’ai dû respirer dans ce petit espace, tout le temps, mais j’ai résisté : j’avais vingt ans, à quelques mois près, en fait j’avais un peu plus de vingt ans : vingt et un, et je n’avais pas souffert de la faim, j’avais été bien nourri, j’étais costaud, et voilà.
Retour à Florence et front de guerre dans le Casentino30Début juin 1944. En réalité, ce n’est pas fin mai-début juin, mais au minimum à la fin du mois de juin que l’évasion a lieu. D’autre part, au cours de la conversation déjà citée du 6 septembre 2005 avec Urbano, Natalino affirme qu’il est resté en Allemagne huit mois (au lieu de sept), information qu’un départ plus tardif ne peut que confirmer. Arrivé à la gare Santa Maria Novella de Florence au début juillet, il trouve la ville encore occupée par les Allemands (Arezzo, 80 kilomètres plus au sud, tombera aux mains des Anglo-Américains le 16 juillet seulement). Le front de guerre devient alors toujours plus actif dans le Casentino (où les Alliés, remontant après Arezzo la vallée de l’Arno, libèrent Subbiano, et pénètrent dans la zone entre Rassina et Bibbiena : c’est la raison pour laquelle, le 10 août, les Allemands ont déjà déplacé leurs cuisines de Rassina à Monte, près de la Mausolea. Le pays natal du témoin-narrateur, Avena, est évacué par la police allemande et les gendarmes, parce qu’il est situé trop proche de la Ligne Gothique. Cette évacuation se déroule après celle de Banzena qui a eu lieu le 5 août. La Ligne Gothique est constituée d’une série de fortifications défensives bâties par la Todt le long des 320 kilomètres de la dorsale des Apennins qui vont de Massa-Carrara à Pesaro, à savoir de la Versilia aux Marches. La Ligne Gothique, voulue par Hitler et par le maréchal Kesselring, visait à une tenue à outrance de l’armée allemande sur les Apennins séparant la Toscane de l’Émilie Romagne. Son objectif était de bloquer, après la prise du Mont Cassin et la successive libération de Rome, survenue le 4 juin 1944, l’avancée des armées anglo-américaines vers le nord de l’Italie..
J’y suis arrivé, malgré toutes les difficultés. À Florence, j’ai sauté le mur de la via Luigi Alamanni. Là, il y avait une femme qui s’appelait Marcella, une Romagnole, que je connaissais parce qu’en 1938, jusqu’au début de 1939, j’avais été livreur de lait là-bas et je la connaissais comme cliente. Je suis allé frapper à sa porte, je lui ai dit que j’étais tout noir parce que j’étais rentré dans un wagon plein de charbon. Elle m’a ouvert, j’ai pris un bain, elle m’a donné un short de son mari, et une chemisette comme celle que je porte. Ensuite, j’ai pris le car de la SITA, qui m’a ramené chez moi31 La SITA est le nom de la compagnie des cars qui sillonnent la Toscane [NdT]..
Quand je suis arrivé ici, il n’y avait aucun des miens. Ils avaient tous été emmenés, et j’ai fini par savoir qu’on les avait conduits à la Musolea32Le nom précis de cette ferme appartenant aux moines de Camaldoli, située entre Partina et Soci, est la Mausolea mais nombreux habitants du Casentino, y compris Don Antonio Buffadini dans son journal de guerre, simplifient le hiatus « à-u » en « ù ». Il faut signaler que, avec une ellipse chronologique remarquable, le narrateur saute un mois de travail forcé sur la Ligne Gothique comme ouvrier de la Todt (organisation de la Wehrmacht) et sa fuite du front montagnard jusqu’à Avena à l’annonce des évacuations et des déportations forcées de la population, parmi laquelle se trouve sa famille.. Alors, je suis allé à la Musolea. Ils avaient été emmenés le 8 ou le 9, et ils y étaient encore. On m’a laissé entrer quand j’ai dit : « Mon père est ici, et ma mère aussi ! » Mais après, ils ne voulaient plus me laisser passer pour repartir ! Pour m’échapper, après, j’ai dit à mes parents : « Moi, je ne veux pas retourner en Allemagne ! Vous, ils vont vous évacuer. » En effet, ils ont été emmenés à Santa Sofia, puis jusqu’à Reggio Emilia. Ils ne sont revenus qu’en décembre, et ils étaient partis dans les premiers jours de juin. Moi, j’ai réussi à m’échapper par le conduit d’évacuation des eaux de la cabine électrique, il y en avait une à la Musolea. Un tube de quatre-vingt où coulait un peu d’eau. J’ai atterri en bas au milieu des champs. Et c’est à travers champs que j’ai franchi la ligne de front. J’ai franchi l’Arno. De l’autre côté de l’Arno, il y avait les Anglais.
DEUXIÈME PARTIE
Solidarité humaine et lutte pour la vie
J’ai le sentiment d’avoir eu beaucoup de chance. Et si j’ai toujours voulu aider les extra-communautaires, c’est parce qu’en Yougoslavie, me retrouvant au milieu de gens qui par leurs lois et leurs usages se comportaient comme des fauves, j’en ai trouvé un qui m’a sauvé la vie. Il aurait dû me tuer, et il ne l’a pas fait, il m’a aidé, en me donnant des conseils et en me confirmant que la route que je voulais prendre était la bonne. Il m’a dit : « Prends-la ce soir, car demain… si tu la prends après dix heures du soir, je ne serai plus là, ce sera un autre qui, s’il te voit dans la nuit, te tuera, c’est sûr. » Voilà pourquoi je pense qu’il faut aider tout le monde.
U. C. — À propos d’aider les autres : tu as été et tu es toujours donneur de sang !
J’ai donné mon sang seize fois pendant les six ans que j’ai été militaire ! Ensuite, j’ai toujours continué. On a commencé par me donner la médaille de bronze, puis la médaille d’argent, puis la médaille d’or, et même après que j’ai reçu la médaille d’or j’ai continué ! La dernière fois que je l’ai donné, c’était par erreur, parce qu’ils m’avaient convoqué par erreur, alors que j’avais soixante-six ans. Mais je leur ai dit : « Allez-y, prenez-le, je suis en bonne santé, je peux vous le donner encore une fois. » J’ai donné aussi mon sang en extrême urgence, en 1961, le 2 septembre, à l’hôpital de Poppi, à la femme de mon frère, Ilva, une parente à toi, oui… Ilva [Cipriani], du hameau des Greppi, qui faisait une hémorragie. Le 28 du même mois, elle était toujours à l’hôpital de Poppi, elle a refait une hémorragie, et ils ont téléphoné ici. Moi, mon sang je peux le donner à tout le monde. Je suis parti aussitôt et c’était toujours le docteur Fiorini, celui qui m’avait prélevé le sang le 2. Il a dit aussitôt : « Non, pas toi ! » « Pas de problème, allez-y, je suis en forme. Commençons tout de suite. » Par transfusion directe (il montre la pliure de son bras), je lui ai donné mon sang jusqu’à ce qu’elle rouvre les yeux. (Il met sa main sur son cœur) Je l’ai fait avec amour pour tout le monde ! Pas seulement pour ma belle-sœur. Je suis allé aussi à Florence bien des fois pour le donner, je suis allé à Sienne, je l’ai donné avec plaisir et volontairement à tout le monde.
Pour en revenir à ma décision d’aider tout le monde, si j’ai été conduit à le faire c’est parce que, si je n’avais pas été moi-même aidé, je ne serais pas revenu !
J’ai été un peu plus de sept mois en Allemagne, mais j’y étais comme avec un papa et une maman ! Ces deux vieux, ils m’aimaient comme si j’étais pour eux un fils ! ! J’en ai rencontré d’autres qui m’aimaient bien aussi. Les terrains où on travaillait, le propriétaire en avait une bande de trois cents mètres le long de la rivière et un kilomètre de longueur, et entre chaque propriétaire, il y avait un grand chemin que chacun pouvait utiliser. Quand on travaillait, il arrivait qu’on se rencontrait, ceux d’en bas et ceux d’en haut. Moi, je soignais bien mon cheval, et je le bouchonnais bien : le matin pendant deux heures, même un peu plus, et il ne suait pas. Les autres, au contraire, rien que des femmes — car, à cette époque, à ce moment précis, en Allemagne, il n’y avait pas d’hommes de dix-sept à soixante-cinq ans : ils étaient tous mobilisés — voyaient que leurs chevaux étaient tout de suite en sueur, qu’ils n’en pouvaient plus et elles en parlaient avec mon bonhomme. « Qu’est-ce que vous faites à vos chevaux — demandaient-elles — pour qu’ils ne soient pas tout de suite en sueur ? » Il expliquait alors la manière dont je m’y prenais.
Voilà qu’un beau jour, le soir, je venais de rentrer le cheval, le vieux me dit d’aller chez les gens d’en bas — d’une ferme à l’autre, il y avait un bout de route de trois cents mètres — pour nettoyer leur cheval et leur montrer comment faire. C’était une femme, il n’y avait pas d’homme. Eh ! je vais essayer, il m’explique où c’est : « Tu vois, là-bas, la maison là-bas ! » On l’apercevait au loin qui attendait, elle était dehors. À peine je m’étais mis en route, au bout de cinquante mètres, voilà deux chiens qui s’avancent vers moi. Dans ces fermes, chacun avait un et même deux chiens, que des chiens bergers. Mon vieux, lui, était rentré à la maison. Je reviens sur mes pas, en courant et je dis : « Nae ! Nae ! Nae ! moi : Non, Aoumh ! Aoumh ! » pour lui faire comprendre qu’il y avait ces chiens. Il est venu alors, il m’a pris par le bras et il a appelé la femme au loin. Elle est arrivée. Il a lâché mon bras et c’est elle qui m’a emmené bras dessus bras dessous. On est allés à l’écurie, j’ai fait au cheval tout ce que je faisais au mien. Pendant ce temps elle me parlait en souriant, je le voyais bien, mais je ne comprenais rien ! Au bout d’un moment j’ai essayé de lui expliquer et je lui ai dit : « Toi ahm, ahm (il ouvre la bouche plusieurs fois en montrant son interlocuteur), moi rien comprendre (il se touche les oreilles), moi ahm, ahm (il se touche la poitrine en ouvrant bien la bouche), toi rien comprendre (il montre son interlocuteur et se touche les oreilles) ! Moi, au cheval — je lui explique alors — tu vois, je fais comme cela (il fait le geste de caresser le dos du cheval). » Je lui montre comment j’avais soigné le cheval. Et j’ajoute : « Aux femmes, je fais comme ça. » (et en disant ces mots il se caresse les joues avec ses deux mains) Je lui ai donc caressé le visage. Et elle s’est jetée sur moi : j’ai bien cru qu’elle voulait me manger ! ! Je n’en dirai pas plus. Ce qui est arrivé, c’est facile à deviner.
Quelques jours plus tard, trois ou quatre jours après Noël, un soir elle est venue pour me dire de l’accompagner... Elle voulait m’emmener voir... Je ne voulais pas, les autres m’ont dit d’y aller, j’y suis allé. Après avoir franchi le pont de la rivière, sur la gauche, vingt mètres plus bas, il y avait une petite salle. Il y avait là des religieuses avec des enfants, de dix à quinze ans, qui jouaient une sorte de comédie. Mais avant d’aller là, elle m’a emmené d’abord chez une sœur à elle, qui devait venir avec nous. La sœur est venue avec nous et c’est comme ça qu’on a fait connaissance.
Une quinzaine de jours plus tard, peut-être dix-huit, on était à la mi-janvier, elle me redemande de venir avec elle voir une autre chose. Mais elle a précisé : « Nics aïte stounde, secs stunde33« Nicht um acht, um sechs », c’est-à-dire : « Pas à huit heures, mais à six heures ». La traduction du témoin est donc inexacte.. » Pas à huit heures, à sept heures parce que « ische — elle a ajouté — ische papié »34« Ich… ich… Papier » : «moi… moi… patron »., j’ai compris qu’elle devait aller prendre des mesures pour un vêtement, elle savait très bien se faire comprendre. Là-dessus on est partis. Elle m’a dit alors qu’elle me conduisait chez sa sœur, et que pendant qu’elle irait chercher son vêtement, je devais l’attendre là jusqu’à huit heures. Quand elle est partie, l’autre m’a expliqué qu’elle était seule, dans la maison : « Aïne35« Ich alleine ».… moi toute seule. » Elle me montre une pièce au rez-de-chaussée : « Aïne. » Elle m’emmène dans sa chambre : « Aïne. » Bref. Ça s’est passé comme ça s’était passé chez sa sœur.
Bon dieu ! pendant les huit mois que j’ai été là, je n’ai manqué de rien ! !
C’est ça que j’ai décidé de raconter !
U. C. — Je voudrais que tu me redises ce que tu m’avais dit un jour, quand tu mourais de faim, là-haut en montagne, entre Sarajevo et Zagreb, à propos des os qu’on jetait dans les fossés.
Ah ! oui, je les mangeais. Et j’ai bien fait. Quand ils jetaient les os des moutons dans ce ravin — au début ils étaient encore brûlants — mais en quelques minutes ils refroidissaient, car il y avait la neige là-haut. J’attendais un quart d’heure, puis je descendais dans le ravin, je prenais deux cailloux : une pierre plate et solide, et une autre plus petite. Je posais les os sur cette pierre et avec l’autre je cassais l’os et je suçais la moelle. Je ne dis pas que cette moelle était bonne, mais elle avait de la substance. Quand je suis parti de la Yougoslavie, en dehors des baies et de cette moelle… on ne nous donnait plus rien à manger, rien de rien ! Et quand je me suis échappé, j’ai marché au moins quinze kilomètres dans la nuit, au milieu des broussailles, et à partir de mille huit cents mètres, je suis descendu entre deux cents et cent cinquante mètres d’altitude. On ne peut pas dire que j’étais faible, j’étais plutôt costaud, et j’étais en bonne santé.
Fuite du camp de regroupement et passage du front.
U. C. — Raconte-nous comment tu t’es échappé de la Musolea par ce fameux tube.
À la Musolea, je ne pouvais pas y rester. À cette époque, je connaissais bien l’endroit, j’avais servi d’intermédiaire dans quelques affaires avec le fermier, qui s’appelait Vannini. Il m’avait fait visiter et je savais qu’il y avait cette cabine : « Tu vois, ici c’est la centrale électrique. L’eau arrive de là-haut, puis, par ce tube… » Le tube en question était gros, au moins un de quatre-vingt ou de quatre-vingt-dix de large, un gros conduit par où l’eau descendait. C’est par ce conduit que je…
U. C. — Et il était long ?
Environ cinquante mètres, peut-être soixante.
U. C. — Où est-ce qu’il finissait, dans un fossé ?
Au milieu d’un champ en dessous.
U. C. — C’est par là que tu repars ?
Oui. Après j’ai traversé l’Arno.
U. C. — On est en juin 1944 ?
Oui. J’ai traversé l’Arno, on était aux alentours du quinze, parce qu’il me semble que je suis rentré, en revenant de là-bas, le dix ou le onze. Ma famille…
U. C. — Juin ou juillet ?
Juin, juin. Avena, et pas seulement ma famille.
U. C. — Oui, je sais : j’y étais !
On avait emmené deux jours avant tous les habitants d’Avena36En dehors du fait que nous ne sommes pas en juin mais bien en août, la succession des événements, telle que le témoin la raconte, est très probable. Les habitants d’Avena sont en effet évacués de force, à pied, après le 5 août, à la Mausolea (par le torrent Sova, puis par Ragginopoli et Soci) et le 10 août le front s’est déjà déplacé le long de l’Arno dans la zone située entre Rassina et Bibbiena..
U. C. — C’est exact : j’ai vu Avena complètement évacuée.
En allant là, je savais qu’ils y étaient ; et en arrivant, j’ai dit : « Je viens ici, parce qu’en rentrant chez moi, je n’ai pas trouvé ma famille, je sais qu’elle est ici. » Et on m’a laissé entrer, sans rien me demander. Mais une fois dedans, j’ai dit aux miens : « Je ne peux pas rester avec vous. » Et je me suis échappé par ces gros tubes.
Prisonnier des Anglo-Américains et écrivain de « poésies » de tradition orale.
Quand j’ai traversé le front, et que j’ai passé l’Arno, j’ai rencontré une patrouille anglaise. Ces Anglais m’ont emmené à Subbiano, où il y avait un poste de commandement important. En m’emmenant là-bas, ils se demandaient sûrement si je n’étais pas un espion allemand. Le matin, le commandant n’était pas là. Ils m’ont enfermé. Quand on arrive à Subbiano, du moins à cette époque, il y avait sur la gauche une maison de l’équipement37 Ces maisons (en italien : le case cantoniere), appartenant au service de l’Équipement, sont situées le long des routes : elles servent de bureau et d’atelier aux responsables de l’entretien [NdT]. — elle doit encore exister — ils m’ont conduit là et ils m’ont enfermé dans une grande pièce. Un interprète est venu qui m’a dit : « Ce soir, à son retour, le commandant vous interrogera. »
Alors, pour passer le temps, je n’avais rien à faire, j’avais un crayon dans ma poche, il y avait là du papier et, comme dans ma jeunesse j’écrivais des poésies, j’essayais en tout cas, j’en ai écrit une. J’y ai passé la journée. Je m’en souviens encore :
Mes chers et adorés parents
Je vous envoie mes tendres baisers
Sans raison, je suis prisonnier
Mais joyeuses je veux mes pensées
Mes intentions vous les savez
Mais je veux encore les donner
Les Alliés je les attendais
Pour de tous ces crimes nous venger
Je reviens un peu en arrière : ici, à Avena, et aussi à la Musolea, j’avais parlé avec les gens du pays, et je savais que sur le Montanino, il y avait des canons qui tiraient sur Poppi, que des gens avaient été tués à Poppi. C’est pour cela que j’ai écrit :
Mes intentions vous les savez
Mais je veux encore les donner
Les Alliés je les attendais
Pour de tous ces crimes nous venger
Quand de chez nous ils se sont rapprochés
Fier et sans peur, le front j’ai traversé
Et en soldat honorable et vaillant
J’ai demandé à parler des Allemands
On m’a conduit d’abord à Salutìo
Puis chez un commandant de Subbiano
On m’a questionné très longtemps
Pour savoir où étaient les Allemands
Le canon de Sasso alla Lippa38Au Sasso alla Lippa de Montanino, ainsi qu’à Cerreta près de Camaldoli, il y avait les canons de la Ligne Gothique qui tiraient sur la vallée du Casentino et sur Poppi en particulier.
Et cet autre qui tonne à Cerreta
En vérité je vous le dis
Ils seront au matin détruits
Ainsi Poppi dorénavant
Calme et tranquille sera demain
Libéré des vilains méchants
Qui voulaient à tout prix sa fin
Tout doucement le monde entier
Devrait retrouver la paix
Chacun dans son cœur se réjouira
Quand tous les siens embrassera
Je pense à vous tous en famille
À maman et au petit Bruno
— il avait trois ans, Bruno —
À tous ces jours, ces mois et ces années
Sans avoir pu vous embrasser.
À vingt ans, oui, j’en ai écrit des poésies ! J’en avais même écrit une, quand je m’en étais tiré, que sur dix avions on n’est revenus qu’à sept. Le lendemain j’étais de service, et deux jours plus tard je devais retourner au même endroit. Je n’y suis pas allé, au lieu d’y aller je me suis inscrit pour l’infirmerie. « Pourquoi ? » « Parce que j’ai mal à la tête — que j’ai dit au lieutenant — je suis un des rescapés de la Croix-Blanche39Organisme d’assistance médicale des blessés et des malades., sur dix avions on est revenus à sept… mardi soir. Et je devrais y retourner vendredi ? Pas question ! »
Lui me dit : « Prends ce litre… et bois un verre d’huile ! »
Je lui ai répondu : « Vous pouvez m’envoyer à Gaète40Prison militaire. L’huile est de l’huile de ricin, l’instrument purgatif et punitif utilisé par le régime fasciste., mais de l’huile, ma mère ne m’en a jamais donné, et vous n’allez pas m’en donner non plus. Si vous avez un peu de conscience, vous allez me donner un jour de repos. Sinon, faites comme vous voulez, vous pouvez m’envoyer à Gaète ! »
Il m’a dit alors : « Va te reposer ! » J’y suis allé, mais j’ai dû rester sans bouger toute la journée, et cette fois-là aussi j’ai eu de l’inspiration. J’en ai écrit des poésies, à mes petites amies, à mes sœurs, à mes cousines, à toutes. Celle-ci disait :
Je suis de repos aujourd’hui et je n’ai rien à faire
En bonne santé je suis et vous le fais savoir
Vous aussi allez bien, c’est mon plus cher espoir,
Et que tous en famille vous pensez bien à moi
Je pense très fort à vous, je n’ai rien d’autre à faire
Juste une heure chaque jour, quand on va au bain de mer
Avec mes camarades, on n’a que ça à faire.
Et tristement ainsi nous passons nos journées,
Les journées et les mois, les mois et les années,
Ainsi vivent aujourd’hui les jeunes de vingt ans.
Ça, c’est une deuxième !
U. C. – C’était de notre temps…
Dans l’aviation américaine : les forteresses volantes41Juillet 1944 – mai 1946. L’enrôlement dans l’aviation U.S. est à déplacer vers la mi-août 1944.
Le soir, quand le commandant est arrivé pour m’interroger, je lui ai dit ce que j’avais fait, où j’avais été etc., et il m’a dit : « Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vous donnerai demain une lettre. » Au matin, il avait téléphoné et fait le nécessaire. Il m’a dit : « Je n’ai plus qu’à vous écrire le petit mot pour le ministère de l’Aéronautique. Le ministère de l’Aéronautique était à Orvieto, pas à Rome. Il me donne les papiers pour me rendre au ministère où j’ai retrouvé plusieurs soldats dispersés comme moi. Deux jours après, un capitaine italien est arrivé en compagnie de deux officiers américains pour demander parmi nous qui était volontaire pour entrer dans l’aviation américaine, et qu’on nous donnerait la même paye qu’à leurs soldats : bien sûr, il fallait des spécialistes, ceux des équipes volantes.
Je suis parti aussitôt. De là, je suis allé à Pescara. À Pescara j’ai retrouvé Alberto Rabagliati42Alberto Rabagliati était un chanteur célèbre de l’époque, il s’était précédemment réfugié dans la bourgade de Lierna, près de Poppi., qui était dans la 82e escadrille des forteresses volantes, qui était alors à Pescara. Puis au bout d’une dizaine de jours, on est partis à Osimo, à la gare de Osimo, dans les Marches. Puis quand les Américains ont débarqué à Rimini, et que les Allemands se sont retirés, on est allés dans le département de Gorizia, à Grado. Je suis resté là seize mois avec l’aviation américaine43Si l’on suit le récit qu’il fait dans les lignes suivantes, il s’agit en fait de vingt-deux mois environ, d’août 1944 à mai 1946. Rappelons que les Alliés ont libéré Rimini le 21 septembre 1944., pas quelques jours seulement, jusqu’au moment où j’ai fait ma demande pour être démobilisé. Un engagement c’était six ans pour nous, on avait signé pour six ans.
U. C. — Qu’est-ce que tu as fait pendant ces seize mois dans l’aviation américaine ? Tu es resté toujours à terre ?
Au bout de quinze jours, tous les jours, on allait comme eux bombarder en Allemagne.
U. C. — Heureusement que la DCA allemande avait été presque détruite…
Archi-détruite ! Mais le seul danger, je vais te le dire : en juillet 1944, certains jours, il pouvait y avoir jusqu’à trente mille forteresses volantes au-dessus de l’Allemagne. Il n’y avait plus de DCA. Le seul danger, c’était en l’air, de la place il y en avait mais de temps en temps, il suffisait de se toucher avec l’extrémité des… d’un bout de quelque chose, et alors, c’était difficile de s’en tirer.
U. C. — Parce que vous voliez en formation ?
Les ailes, les fuselages ce sont tous des réservoirs d’essence ! Spécialement au décollage. Mais moi, je dis que les bombes qui sont tombées sur l’Allemagne, personne ne saura jamais combien. Ensuite, en juin, dès la fin de mai 1946, j’ai fait ma demande pour être démobilisé.
Passage dans l’aviation italienne44Juin 1946.
J’ai fait alors ma demande de démobilisation, et de l’aviation américaine, on m’a reversé dans l’aviation italienne. L’aviation italienne était à Padoue. Je n’étais pas exactement à Padoue, mais à Villa Oste45Plus précisément : Villa Osti, centre météorologique de l’Aéronautique militaire italienne., qui se trouve à quelques kilomètres. J’y ai été peu de temps, un mois, peut-être un mois et demi. Ensuite, ceux qui demandaient leur mise en congé devaient tous repasser à l’école de pilotage, à Galatina au sud de Lecce, dans les Pouilles. Là-bas je tombe sur le colonel Teucci ! Oui, de Poppi. Je suis allé le voir. Et j’ai passé toute cette période avec lui ! Moi j’étais dans la 1re escadrille, lui dans la 4e, mais ce n’était pas un problème. Quand il téléphonait… — Galatina est distante de vingt-trois ou vingt-quatre kilomètres de Lecce et de trente-cinq kilomètres environ de Gallipoli. Gallipoli est du côté de Tarente. Les officiers pouvaient sortir en permission tous les soirs, les sous-officiers c’était rare — j’ai été démobilisé comme sergent d’active, versé dans la réserve comme aviateur de première classe. Lui et les autres officiers sortaient tous les soirs et ils m’emmenaient avec eux, ils voulaient que j’aille avec eux.
Et là aussi, là aussi… les choses ne se présentent pas toujours ainsi : il faut un peu de courage et aussi un peu de culot. Je n’avais pas tellement le droit de sortir avec eux, avec les officiers, lui c’était un colonel. J’avais su par un officier de mon escadrille que la 4e escadrille était dirigée par un colonel de Poppi.
« De Poppi ? — je lui demande — et comment s’appelle-t-il ? »
Le lendemain il me dit : « Teucci .»
« Ça alors — je lui dis — je connais très bien son frère. » C’était parfaitement vrai que je connaissais son frère car ce frère, qui habitait à Poppi avec leur maman, venait à la chasse avec Gigino Matini, un fermier, et ils venaient tous les deux chasser dans nos champs46Natale est à cette époque un métayer de la famille Brami de Bibbiena.. Un matin, ils sont restés à manger, ils ont mangé la polenta avec nous. Tu parles si je le connaissais bien. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse sa connaissance, il faut que je m’arrange pour le rencontrer… Lui c’est un colonel de la 4e escadrille, toi tu es de la 1re escadrille, ce n’est pas possible. Il faut trouver un intermédiaire. Je retourne dans tous les sens le problème dans ma tête, ce n’était pas facile : mais je finis par y retourner. J’avais préparé ce que j’allais dire : « Oui, je sais que je ne peux pas lui parler, mais vous pourriez peut-être lui faire passer un petit message », dis-je au planton de service.
« Que dois-je lui dire ? »
« Je dois lui dire… vous devez lui dire qu’un certain Agostini de Poppi, qui revient de permission, est un ami de son frère et de sa mère et qu’il est allé leur rendre visite. Et qu’en parlant avec eux, il leur a dit qu’il était militaire à Lecce, à l’école de pilotage et que sa maman lui a dit : “En voilà une surprise ! mon fils aussi est là-bas. Si je m’attendais… Quand est-ce que vous repartez ?” J’ai répondu : “Je repars demain.” Elle a ajouté : “Si j’avais su, je lui aurais acheté quelques paires de chaussettes, celles qu’il lui faut.” Mais j’ai dit : “Hélas, je dois repartir demain.” Alors, vous lui demandez s’il veut bien parler avec ce garçon de Poppi qui a été chez lui voir son frère et sa maman. »
Quand l’autre a été lui demander : « Bien sûr, viens si tu as besoin ! » J’y suis allé, je ne lui ai pas raconté des histoires, je lui ai dit la vérité, que son frère venait chasser chez nous, et donné des nouvelles du pays. Et pendant les quatre mois que je suis resté là-bas, je n’étais plus un aviateur de première classe, j’étais un officier, toujours en balade avec lui, de toutes les distractions ! Tous les soirs en permission ! Voilà ! Voilà comment ça s’est passé !
Retour à la vie civile et paysanne47Fin janvier 1947. Le seul document en notre possession (catalogue du ministère royal de l’Aéronautique N° 130, rôle des équipages) indique que Agostini Natale, matricule N° 320164, est libéré de l’astreinte spéciale de 30 mois et mis en congé illimité le 10-12-1946. Une deuxième écriture ajoute, toujours à la plume, mais sans date, que libéré de l’astreinte, il passe dans la catégorie gouvernementale. Quelle que soit la manière dont les choses se sont passées, la mémoire de Natale Agostini repousse simplement à la fin du mois de l’année suivante le début de sa nouvelle vie. Les autres informations contenues dans le catalogue, relatives aux changements matriculaires de l’aviateur Agostini Natale, sont malheureusement, à notre grande déception, bien moins fiables que la mémoire du témoin lui-même : une même main, différente des deux précédentes, écrit que le 8 septembre 1942, il est pris comme aviateur volontaire « en qualité d’élève électricien » et le même jour « envoyé en permission extraordinaire sans solde en attente du début du cours ». Puis, la même main écrit que, le 23 octobre 1942, il a été rappelé de la permission susdite et « envoyé à Ascoli Piceno pour y fréquenter le cours électriciens » et le même jour, écrit la même main, il est « mobilisé en territoire déclaré en état de guerre et zone d’opérations ».
De là, je suis rentré à la maison.
Je suis rentré, une fois démobilisé, parce que mon pauvre papa était malade. Qui est-ce qui prenait en charge les dépenses ? Je touchais, à l’époque, quand je suis rentré, en 1947, tu sais combien je gagnais, combien par mois, avec toutes mes indemnités ? Je touchais trente-sept ou trente-huit mille lires par mois !
U. C. — C’était bien ?
Comment ! Si c’était bien ? C’était une grosse somme !
U. C. — Pourtant tu y as renoncé…
Oui, j’ai dû renoncer. Je suis rentré, et mes deux plus jeunes frères c’est moi qui ai payé leurs études, aussi bien Bruno que Chiara.
U. C. — C’était toi, l’aîné.
J’ai fait la même chose avec mes enfants. Certes il y a Roberto qui a un bac de comptabilité, c’est tout, mais s’il avait voulu aller à l’université, il y allait lui aussi. Antonio est directeur de banque, depuis bien des années, et il est estimé dans son domaine. Une fille enseigne à l’université en France, en somme, ils ne sont pas restés au niveau école primaire comme moi !
U. C. — Oui, mais je disais, les Américains au moment où tu les as quittés, tu as bien dû toucher quelque chose, une prime de départ ?
Si j’ai touché quelque chose ? Pas la prime de départ. Ils nous ont dit qu’ils nous donnaient la même paye qu’à leurs soldats, mais seulement pour le temps du service…
U. C. — Les Américains ?
Les Américains. Ils nous donnaient l’indemnité de vol, l’avancement au bout de deux ans — après les deux premières années, il y a un avancement, et aussi après — ils nous donnaient tout, comme pour un engagement dans l’aviation italienne. Deux mois après que j’étais revenu — je suis rentré à la fin de janvier 1947 — on était en mars, ils m’ont convoqué au quartier général de Rome et ils m’ont donné cent cinquante mille lires : c’était la différence entre la paye que l’on avait dans l’aviation italienne et celle dans l’aviation américaine. Rien que de les mettre dans ma poche, j’avais peur !
U. C. — Qu’est-ce qu’on achetait avec cette somme ?
On pouvait en acheter des choses. Écoute pour soixante-trois mille lires, j’ai acheté un trousseau complet pour mes deux sœurs Bruna et Rina, qui se sont mariées en 1947. Elles n’avaient rien, rien de rien ! On est allés à Bibbiena… Non, on n’a pas acheté un trousseau de luxe, mais un bon trousseau : pas élégant, mais utile, le nécessaire, ce qu’il fallait !
Et puis, avec le reste des sous, j’ai commencé à en gagner d’autres ! Mais seulement... tu sais que l’on dit : « Pour travailler, il faut avoir été habitués à travailler. » Oui, mais pour travailler, il faut surtout avoir envie de travailler ! ! Tu sais qu’en 1947, j’ai gagné soixante-cinq mille lires à moissonner le blé ! D’abord j’ai moissonné mon foin, ensuite, une fois que c’était fait, le 2 ou le 3 juin, je suis allé avec d’autres à Pian di Ripoli48Le Pian di Ripoli est situé sur la rive gauche de l’Arno à l’extrémité sud-orientale de la plaine de Florence.. On a moissonné une dizaine de jours à Pian di Ripoli. Après cela, un paysan qui s’était installé à Pian di Ripoli, alors qu’il était de Montiloro, près des Sieci49Localités au sud-est de Florence, situées sur la droite de l’Arno., avait une exploitation à moissonner là-haut à Montiloro. Les autres voulaient s’en aller : pour finir, deux sont rentrés chez eux, mais moi et un autre parmi les quatre qu’on était on est allés à Montiloro, on a moissonné encore dix ou douze jours, même treize jours. Quand on est revenus, on s’est partagé à deux l’argent — on avait moissonné en tout environ vingt-cinq jours…
U. C. — Moissonner, comment ?
Le foin, le blé, ça se moissonne comme ça (il fait le geste horizontal du moissonneur qui tient une faux).
U. C. — À la main ?
À la main ! Que diable !
Bon dieu ! Nous on travaillait jusqu’à 11 heures, et parfois jusqu’à minuit. Parce qu’après, on liait, dans le noir. Au petit matin, vers deux heures deux heures et demie, quand on se levait, nos pantalons étaient encore tout chauds sur nos chaises ! Mais on a gagné chacun soixante-cinq mille lires !
Avec ces soixante-cinq mille lires, je suis rentré à la maison, j’ai acheté chez Ottavio Cremoli de Corsignano une portée de porcs, douze en tout. Ils étaient pas donnés. Ils étaient beaux, mais c’était pas donné ! Je les ai achetés soixante-cinq mille lires, lui en voulait plus, alors à la fin je lui ai dit : « J’ai été faire la moisson, d’abord à Pian di Ripoli, puis à Montiloro. J’ai moissonné pendant une trentaine de jours et j’ai ramené à la maison soixante-cinq mille lires, pas davantage, je ne peux pas vous donner plus ! » Alors, il m’a dit : « Attends, on m’a proposé la même chose il y a quelques jours, mais toi tu es jeune et tu me plais : ils sont à toi ! » Deux mois plus tard, de soixante-cinq, j’en ai tiré environ cent mille parce qu’ils avaient bien profité ! Et depuis ce temps-là, moi, j’ai toujours fait du commerce. J’étais un paysan, mais j’ai toujours fait du commerce pour mon compte : j’ai acheté, vendu des tas de choses… des semences, des tas de choses !
Et voilà, maintenant on est ici !
U. C. — On est ici et nous sommes le 10 octobre 2005. Il est midi et quart, la cassette est arrivée au bout mais pas nous. On ne fait que suspendre.
Mon dieu ! Mon dieu ! On n’a pas arrêté de bavarder !
- 1. Cette version accompagne la vidéo de l’interview dans la section de ce site web consacrée aux témoignages audio. Lors de la transcription, nous avons cherché à respecter le plus fidèlement possible les aspects phoniques et rythmiques, lexicaux et syntaxiques de la langue parlée du locuteur.
- 2. Début février 1941. À plusieurs reprises au cours de l’interview (cf. le deuxième chapitre) le témoin donnera la date du 8 février 1941, comme jour où il est enrôlé dans l’aviation et où il commence à fréquenter les cours de l’école militaire.
- 3. Les interventions de l’intervieweur, en italique, seront dorénavant indiquées par les initiales de son prénom et de son nom : U. C.
- 4. Natalino, diminutif du prénom Natale.
- 5. Au sens propre du terme : l’une des épreuves consistait justement à tomber à l’improviste par une trappe dans un espace au-dessous sans perdre l’équilibre, en gardant la capacité d’exécuter immédiatement des ordres.
- 6. Natalino n’a donc effectivement suivi, des cinq années de l’école primaire, que les trois premières. Il a obtenu le certificat de fin d’études en se présentant aux examens en candidat libre.
- 7. Apres l’école primaire, le cycle scolaire qui suit, celui du collège, dure en Italie trois ans.
- 8. 8 février 1941 – 8 septembre 1943.
- 9. Terme péjoratif indiquant un paysan : les « zolle » sont les mottes de terre compactes et dures que le laboureur retourne avec la charrue.En français également, les surnoms dont les soldats moqueurs d’origine citadine affublent les paysans sont nombreux : Pedzouille, Pécrat, Cul terreux, Terreux, Écrase-mottes, etc., relevés par A. Dauzat au cours de la Première Guerre mondiale [NdT].
- 10. Événement à situer au maximum fin juin 1943, ou début juillet, car les Alliés débarquent en Sicile le 10 juillet.
- 11. 8 septembre 1943. À la suite du débarquement allié à Reggio de Calabre, le gouvernement du maréchal Pietro Badoglio signe le 3 septembre l’armistice de Cassibile entre l’armée italienne et l’armée alliée. L’annonce en est faite aux Italiens le 8 septembre à la radio, tandis que les Alliés prennent pied à Salerne, près de Naples, et le gouvernement, Pietro Badoglio et le roi se mettent à l’abri à Brindisi sous la protection des Anglo-Américains. L’armistice ne trouve pas du tout les forces armées italiennes préparées pour faire face à la nouvelle situation.
- 12. 8 septembre – début novembre 1943.
- 13. L’Italie entre en guerre le 24 mai 1915 [NdT].
- 14. Les partisans communistes du maréchal Tito.
- 15. Selon le calendrier lunaire consulté « en ligne », le 1er novembre, jour de la Toussaint 1943, est un lundi avec un premier croissant de lune montante : le premier quart est le vendredi 5. La fuite a, par conséquent, eu probablement lieu le 2 ou le 3 novembre>.
- 16. Mi-novembre 1943 – début juin 1944. Le témoin affirmera à plusieurs reprises qu’il est arrivé en Allemagne au début novembre ou au plus tard à la mi-novembre. Plusieurs recherches, amicalement faites pour nous par Alessandro Tuzza, sur le départ des convois de déportés civils et militaires de la gare de Trieste en novembre 1943 sembleraient reporter ces départs vers la fin du mois. On pourra peut-être avoir des précisions sur la date d’arrivée du témoin en Allemagne et surtout sur la petite ville où il a été déporté, si la WAST de Berlin, que nous avons sollicitée, est en mesure de retrouver, dans ses archives de la Seconde Guerre mondiale, le permis de séjour de prisonnier-travailleur délivré en Allemagne à Natale Agostini. En ce qui concerne sa fuite et son retour en Italie, pour des raisons que nous préciserons plus loin, les événements doivent être déplacés au minimum à la fin de juin 1944.
- 17. Le témoin ici veut évidemment dire « israélites ».
- 18. Le terme « allemand » ne sera jamais utilisé par le narrateur pour désigner dans le récit des civils mais toujours des militaires de l’armée allemande.
- 19. L’expression « la maison de ce type » est ici répétée deux fois. Le narrateur n’exprime pas toutefois un sentiment de mépris envers le vieux propriétaire terrien en l’appelant « ce type » (en italien : « questo coso », mot à mot « ce machin »), il exprime plutôt l’incertitude qu’il éprouve pour en définir le statut identitaire, à ses yeux pas bien identifié : il choisira après, en refusant le terme négatif « allemand », les désignations de « vieux », « colon » et paysan.
- 20. Dans une autre conversation avec Urbano Cipriani le 6 septembre 2005, Natale affirme qu’il s’agit de Bremen sur le Danube. Mais dans la grande ville industrielle de Bremen (Brême en français), située au nord-ouest de l’Allemagne, le Danube ne passe pas. Le témoin s’est-il trompé ? À vrai dire, dans le sud-ouest du pays, près de la Suisse alémanique, il y a une petite ville appelée Hohentengen-Bremen située sur un petit affluent du Danube. Elle forme un nœud ferroviaire peut-être stratégique du Bade-Würtemberg, proche des mines de charbon, et son paysage rural semble correspondre à celui décrit par Natale.
- 21. Bonne nuit : « gute Nacht ». La langue allemande de Natalino est très approximative et, au plan phonétique, caractérisée par une nette influence de son parler toscan (par exemple il ajoute souvent une voyelle à la fin des mots monosyllabiques toniques, et des oxytons qui en allemand se terminent en consonne : Nacht > naque).
- 22. Il s’agit de la négation non : « Nein ».
- 23. Travail : « Arbeit ».
- 24. Ce verbe, avec deux autres variantes : « nappe » et « snappe » correspond au terme allemand « schlafen », dormir.
- 25. « Nein ! Nein ! Du morgen schlafen : nicht weg, nicht arbeiten », c’est-à-dire : « Non, non ! Tu demain dormir : rester ici, pas travailler ».
- 26. « Schlafen, um acht, neun aufstehen » : « Dormir, à huit, neuf se lever».
- 27. « Ich arbeite, ich arbeite », c’est-à-dire : « Je travaille, je travaille ».
- 28. « Morgen schlafen fünf, sechs aufstehen » : « Demain dormir, cinq, six se lever ».
- 29. Variante toscane du nom italien Angelo, donc le narrateur « toscanise » le prénom allemand de son ami Engel.
- 30. Début juin 1944. En réalité, ce n’est pas fin mai-début juin, mais au minimum à la fin du mois de juin que l’évasion a lieu. D’autre part, au cours de la conversation déjà citée du 6 septembre 2005 avec Urbano, Natalino affirme qu’il est resté en Allemagne huit mois (au lieu de sept), information qu’un départ plus tardif ne peut que confirmer. Arrivé à la gare Santa Maria Novella de Florence au début juillet, il trouve la ville encore occupée par les Allemands (Arezzo, 80 kilomètres plus au sud, tombera aux mains des Anglo-Américains le 16 juillet seulement). Le front de guerre devient alors toujours plus actif dans le Casentino (où les Alliés, remontant après Arezzo la vallée de l’Arno, libèrent Subbiano, et pénètrent dans la zone entre Rassina et Bibbiena : c’est la raison pour laquelle, le 10 août, les Allemands ont déjà déplacé leurs cuisines de Rassina à Monte, près de la Mausolea. Le pays natal du témoin-narrateur, Avena, est évacué par la police allemande et les gendarmes, parce qu’il est situé trop proche de la Ligne Gothique. Cette évacuation se déroule après celle de Banzena qui a eu lieu le 5 août. La Ligne Gothique est constituée d’une série de fortifications défensives bâties par la Todt le long des 320 kilomètres de la dorsale des Apennins qui vont de Massa-Carrara à Pesaro, à savoir de la Versilia aux Marches. La Ligne Gothique, voulue par Hitler et par le maréchal Kesselring, visait à une tenue à outrance de l’armée allemande sur les Apennins séparant la Toscane de l’Émilie Romagne. Son objectif était de bloquer, après la prise du Mont Cassin et la successive libération de Rome, survenue le 4 juin 1944, l’avancée des armées anglo-américaines vers le nord de l’Italie.
- 31. La SITA est le nom de la compagnie des cars qui sillonnent la Toscane [NdT].
- 32. Le nom précis de cette ferme appartenant aux moines de Camaldoli, située entre Partina et Soci, est la Mausolea mais nombreux habitants du Casentino, y compris Don Antonio Buffadini dans son journal de guerre, simplifient le hiatus « à-u » en « ù ». Il faut signaler que, avec une ellipse chronologique remarquable, le narrateur saute un mois de travail forcé sur la Ligne Gothique comme ouvrier de la Todt (organisation de la Wehrmacht) et sa fuite du front montagnard jusqu’à Avena à l’annonce des évacuations et des déportations forcées de la population, parmi laquelle se trouve sa famille.
- 33. « Nicht um acht, um sechs », c’est-à-dire : « Pas à huit heures, mais à six heures ». La traduction du témoin est donc inexacte.
- 34. « Ich… ich… Papier » : «moi… moi… patron ».
- 35. « Ich alleine ».
- 36. En dehors du fait que nous ne sommes pas en juin mais bien en août, la succession des événements, telle que le témoin la raconte, est très probable. Les habitants d’Avena sont en effet évacués de force, à pied, après le 5 août, à la Mausolea (par le torrent Sova, puis par Ragginopoli et Soci) et le 10 août le front s’est déjà déplacé le long de l’Arno dans la zone située entre Rassina et Bibbiena.
- 37. Ces maisons (en italien : le case cantoniere), appartenant au service de l’Équipement, sont situées le long des routes : elles servent de bureau et d’atelier aux responsables de l’entretien [NdT].
- 38. Au Sasso alla Lippa de Montanino, ainsi qu’à Cerreta près de Camaldoli, il y avait les canons de la Ligne Gothique qui tiraient sur la vallée du Casentino et sur Poppi en particulier.
- 39. Organisme d’assistance médicale des blessés et des malades.
- 40. Prison militaire. L’huile est de l’huile de ricin, l’instrument purgatif et punitif utilisé par le régime fasciste.
- 41. Juillet 1944 – mai 1946. L’enrôlement dans l’aviation U.S. est à déplacer vers la mi-août 1944.
- 42. Alberto Rabagliati était un chanteur célèbre de l’époque, il s’était précédemment réfugié dans la bourgade de Lierna, près de Poppi.
- 43. Si l’on suit le récit qu’il fait dans les lignes suivantes, il s’agit en fait de vingt-deux mois environ, d’août 1944 à mai 1946. Rappelons que les Alliés ont libéré Rimini le 21 septembre 1944.
- 44. Juin 1946.
- 45. Plus précisément : Villa Osti, centre météorologique de l’Aéronautique militaire italienne.
- 46. Natale est à cette époque un métayer de la famille Brami de Bibbiena.
- 47. Fin janvier 1947. Le seul document en notre possession (catalogue du ministère royal de l’Aéronautique N° 130, rôle des équipages) indique que Agostini Natale, matricule N° 320164, est libéré de l’astreinte spéciale de 30 mois et mis en congé illimité le 10-12-1946. Une deuxième écriture ajoute, toujours à la plume, mais sans date, que libéré de l’astreinte, il passe dans la catégorie gouvernementale. Quelle que soit la manière dont les choses se sont passées, la mémoire de Natale Agostini repousse simplement à la fin du mois de l’année suivante le début de sa nouvelle vie. Les autres informations contenues dans le catalogue, relatives aux changements matriculaires de l’aviateur Agostini Natale, sont malheureusement, à notre grande déception, bien moins fiables que la mémoire du témoin lui-même : une même main, différente des deux précédentes, écrit que le 8 septembre 1942, il est pris comme aviateur volontaire « en qualité d’élève électricien » et le même jour « envoyé en permission extraordinaire sans solde en attente du début du cours ». Puis, la même main écrit que, le 23 octobre 1942, il a été rappelé de la permission susdite et « envoyé à Ascoli Piceno pour y fréquenter le cours électriciens » et le même jour, écrit la même main, il est « mobilisé en territoire déclaré en état de guerre et zone d’opérations ».
- 48. Le Pian di Ripoli est situé sur la rive gauche de l’Arno à l’extrémité sud-orientale de la plaine de Florence.
- 49. Localités au sud-est de Florence, situées sur la droite de l’Arno.
- Numéro: MR001
- Lieu: Centro documentazione guerra e resistenza Biblioteca Rilli-Vettori, Poppi, Arezzo